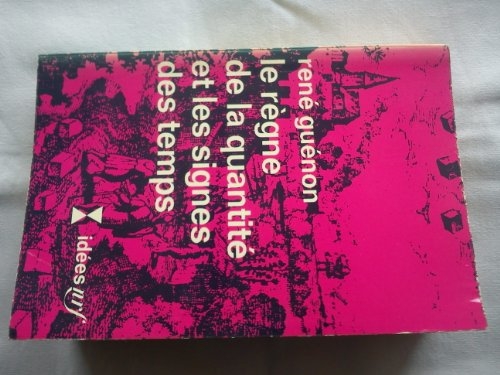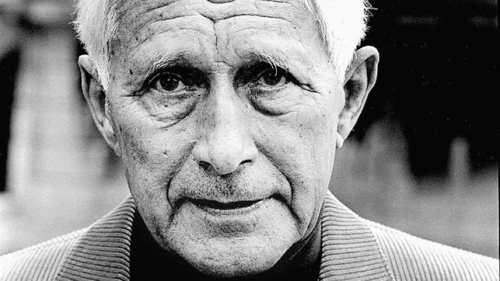lundi, 16 novembre 2020
Le peuplier à taille d’ogive

Luc-Olivier d’Algange:
Le peuplier à taille d’ogive
« Pour l’aurore, la disgrâce, c’est le jour qui va venir ; pour le crépuscule c’est la nuit qui engloutit. Il se trouva jadis des gens d’aurore. A cette heure de tombée, peut-être, nous voici. Mais pourquoi huppés comme des alouettes ? »
René Char
A Jacques Delort
Si la poésie est bien, selon la formule de René Char, de toutes les eaux claires celle qui s’attarde le moins au reflet de ses ponts, le commentateur, si pontifical qu’il se veuille, se trouve d’emblée récusé, à moins de se risquer à répondre à la mise en demeure matutinale, présocratique, de la pensée européenne, celle des « gens d’aurore », des « alouettes huppées » qui volent vers la pointe du jour, vers la source dont nous parle la rivière aimée, cette Sorgue héraclitéenne « rivière où l’éclair finit et où commence ma maison, qui roule aux marches d’oubli la rocaille de ma raison ». La rivière féconde les paysages où elle passe, - comme les mots eux-mêmes éveillent notre pensée, ravivée par leurs étymologies, leurs palimpsestes généalogiques, leurs figures héraldiques accordées aux pierres, aux arbres, aux essaims et aux éclairs.
 De cette aurore de la pensée européenne, René Char fut le témoin, à l’égal d’Hölderlin, de Nietzsche ou d’Heidegger. Pour lointaine qu’elle soit, cette aurore nous dit cependant une proximité extrême, une souveraineté sise dans l’instant, dans l’éclair : « Nous sommes ingouvernables. Le seul maître qui nous soit propice, c’est l’Eclair, qui tantôt nous illumine et tantôt nous pourfend ». L’œuvre de René Char ne s’apparente pas seulement aux présocratiques par la vitesse, la concision et l’intensité aphoristique « Luire et s’élancer – prompt couteau, lente étoile » mais aussi par le refus de l’abstraction, de la logique linéaire ou binaire qui caricature l’éthique en « moraline » et nous livre, harassés et soumis, à la banalité mauvaise de la « pensée calculante » dont parle Heidegger.
De cette aurore de la pensée européenne, René Char fut le témoin, à l’égal d’Hölderlin, de Nietzsche ou d’Heidegger. Pour lointaine qu’elle soit, cette aurore nous dit cependant une proximité extrême, une souveraineté sise dans l’instant, dans l’éclair : « Nous sommes ingouvernables. Le seul maître qui nous soit propice, c’est l’Eclair, qui tantôt nous illumine et tantôt nous pourfend ». L’œuvre de René Char ne s’apparente pas seulement aux présocratiques par la vitesse, la concision et l’intensité aphoristique « Luire et s’élancer – prompt couteau, lente étoile » mais aussi par le refus de l’abstraction, de la logique linéaire ou binaire qui caricature l’éthique en « moraline » et nous livre, harassés et soumis, à la banalité mauvaise de la « pensée calculante » dont parle Heidegger.
Retour amont. Le titre de René Char, il faut l’entendre comme un mot d’ordre, non sans violence, ni précision. Ce n’est pas vers une origine vague que se tourne la pensée de René Char mais vers ce point (qui, pour quelques-uns n’a jamais cessé d’être) où le Mythe et le Logos n’étaient pas encore séparés, où le Tragique n’étant pas encore enseveli sous la fugace féerie publicitaire, les mots venaient à nous, « légers mots immortels, jamais endeuillés » pour exalter la beauté d’un devenir commun, d’une « commune présence ».
Ce qui s’est perdu perdure, l’aube oubliée, terrassée, s’accentue et délivre, le soir venu, sa vérité inaperçue dans le naufrage de la civilisation. La société peut triompher de la civilisation, les œuvres demeurent, et cet « en amont » dont elles surgissent : « Quand le navire s’engloutit, sa voilure se sauve à l’intérieur de nous. Elle mâte sur notre sang. Sa neuve impatience se concentre pour d’autres obstinés voyages. N’est-ce pas vous qui êtes aveugles sur la mer ? Vous qui vacillez dans tout ce bleu, ô tristesse dressée aux vagues les plus loin ? ».
De tous les poètes français de son temps, René Char fut sans doute celui qui demeura au plus près de sa conversation originaire avec Hölderlin. C’est « en touchant la main éolienne d’Hölderlin » qu’il devance en le récusant, en nous léguant sa « parole en archipel », un avenir où le Logos et le Mythe, disjoints, s’étioleront dans leur vaine spécificité, l’un ratiocinant dans son exil, son absence au beau cosmos miroitant, et l’autre glissant vers la pénombre des mondes virtuels. Or, pour René Char, s’il est un « au-delà nuptial », il ne peut être que parmi les choses du monde, dans les bruissements et les silences de la nature, dans son immanence irisée : « Ne permettons pas qu’on nous enlève la part de la nature que nous enfermons. N’en perdons pas une étamine, n’en cédons pas un gravier d’eau. »
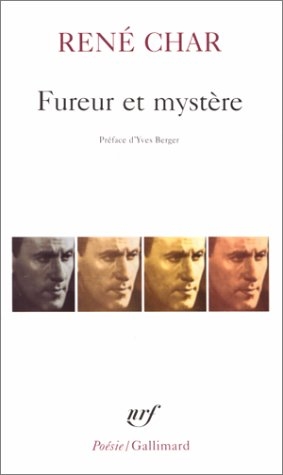 Accordé l’un à l’autre, le Logos et le Mythe, la certitude de la raison d’être et les images qui la voilent et la révèle, disent une amitié, une entente sacrée entre la terre, le ciel, les hommes et les dieux : « Notre amitié est le nuage blanc préféré du soleil. Notre amitié est une écorce libre. Elle ne se détache pas des promesses de notre cœur ». Pour René Char, le discord entre le Logos et le Mythe ne persiste que par notre soumission à ce qu’il nomme « l’âge bas » qui nous incline à passer à côté de toutes les preuves étincelantes de l’être. Mais du scintillement, que l’ombre des ponts ne peut atteindre, la rivière, tradition et devenir, porte, en son courant, les inextinguibles vertus : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau… »
Accordé l’un à l’autre, le Logos et le Mythe, la certitude de la raison d’être et les images qui la voilent et la révèle, disent une amitié, une entente sacrée entre la terre, le ciel, les hommes et les dieux : « Notre amitié est le nuage blanc préféré du soleil. Notre amitié est une écorce libre. Elle ne se détache pas des promesses de notre cœur ». Pour René Char, le discord entre le Logos et le Mythe ne persiste que par notre soumission à ce qu’il nomme « l’âge bas » qui nous incline à passer à côté de toutes les preuves étincelantes de l’être. Mais du scintillement, que l’ombre des ponts ne peut atteindre, la rivière, tradition et devenir, porte, en son courant, les inextinguibles vertus : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau… »
Ce rebelle, dont on voit mal ce que lui trouvent de si aimable les commémorations officielles, trouve son bien, son beau et son vrai, tantôt dans la douceur, tantôt dans l’anathème et ne cesse de s’interroger là où d’autres ne répondent plus de rien : « La lumière a un âge. La nuit n’en a pas. Mais quel fut l’instant de cette source entière ? ». Si, pour René Char, rompant avec le chauvinisme temporel qui nous fait apologistes mécaniques du siècle où nous vivons, l’homme fut, au vingtième siècle au plus bas, ce pessimisme toutefois, forgé par le tragique, n’ôte rien à la beauté de l’instant, bien au contraire : « La graduelle présence du soleil désaltère la tragédie ». L’amitié, l’amour, l’entente sacrée ne cèdent pas : « Où l’esprit ne déracine plus mais replante et soigne, je nais. Où commence l’enfance du peuple, j’aime »
Sans méconnaître les vertus éminentes de la stylistique et d’autres science du langage, force est de reconnaître (et nous préciserons de quelle nature est cette « force ») que loin d’être seulement le résultat d’un « travail du texte », d’un jeu de vocables et de syntaxe plus ou moins harmonieux ou original, le poème est le témoin d’une vue du monde et qu’il forge le poète au moins autant que le poète le compose. Le poète est le témoin de son poème, parfois son martyr, il doit en répondre ; d’où cette force, ce mouvement, qui, si bref qu’il soit, confond sa signature avec la signature des choses elles-mêmes. Entre le Dire et la chose à dire, entre la chose à dire et la chose dite, il n’y point d’espace, sinon d’un point : « Mon métier, écrit René Char, est un métier de pointe ». Point d’avant ni d’après, point d’écart entre le symbole et le symbolisé. L’un et l’autre adviennent en même temps, à la fine pointe du mot qui est pure éclosion. Mieux qu’à l’opinion, mieux qu’à la philosophie, mieux qu’aux divers préceptes de l’art littéraire, la poésie de Char s’accorde à la rose « sans pourquoi » d’Angélus Silésius.
Pour René Char dont la pensée, il faut y revenir, sans peine se hausse aux horizons présocratiques, horizons qui nous restituent aux embruns d’un « l’ici même », que nous persistons à ne pas déserter, le monde est un et chaque chose, en son irréductible singularité, en son écorce rugueuse, en son pollen impondérable, témoigne de cette unité compacte, resserrée, violente. Poème de résistance, autant que de désillusion, le poème de Char laisse revenir sur nous ces immémoriales houles européennes de la tragédie dans un monde qui s’évertue, par tous les moyens, à nier le Tragique, à nous emprisonner dans une dérisoire féerie publicitaire. Or, toute singularité est tragique, et l’on ne peut nier le Tragique qu’en inventant un règne d’hommes sans visages, un monde d’objets de série, dissocié des dieux et des morts. Pour René Char, toute conquête n’est que reconquête de ce qui est. Et c’est au cœur du temps que l’énigme heureuse nous empoigne. « L’Etre et le Temps » : la connivence de René Char avec Heidegger s’explique par ce mouvement de retour vers la source du temps, vers cette intelligence sensible du temps : « les tendres preuves du printemps » sont préférées aux « buts lointains».
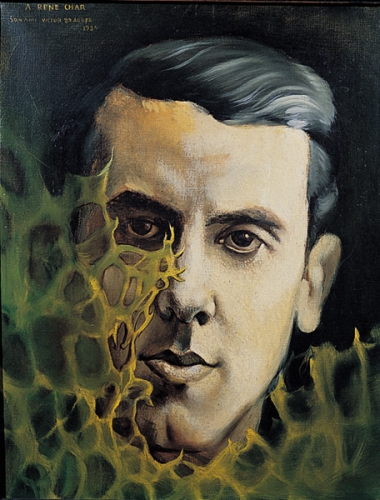
Nous évoquions une « vue du monde ». Celle de René Char, tournée vers les frémissements du temps, les abysses, les palimpsestes, se distinguera radicalement de cette autre vue du monde qui aspire, par exemple, à la maîtrise de l’espace. Si l’homme du tradere est un homme qui ordonne et sanctifie le temps, le Moderne est l’homme de la maîtrise de l’espace. « L’homme de l’espace, écrit René Char en 1959, dont c’est le jour natal sera un milliard de fois moins lumineux et révèlera un milliard de fois moins de choses cachées que l’homme granité, reclus et recouché de Lascaux, au dur membre débourbé de la mort ». Toutes les phrases écrites par René Char (on serait tenté de dire gravées, comme des runes, sur des pierres offertes aux érosions du vent, du sel et de l’océan) témoignent de cette volonté farouche de sauvegarder la singularité immémoriale des êtres et des choses. Le poème est à ce service, s’il n’est pas un poème « engagé », au sens rhétorique ou idéologique, ni servile. Mais d’un combat à mener, la conscience aiguë, presque lancinante, poursuit le poème, le frappe, comme d’un sceau, voire comme d’une masse d’arme. Pour René Char, d’une certaine façon, la littérature et la philosophie doivent rendre l’âme pour que cette âme puisse rétablir le lien entre l’être et la vie : « Pourquoi poème pulvérisé ? Parce qu’au terme de son voyage vers le Pays, après l’obscurité pré-natale et la dureté terrestre, la finitude du poème est lumière, apport de l’être à la vie. »
Toute la poétique de René Char se joue dans ce rapport direct, immédiat, de l’être à la vie qui est à la fois la chose la plus ingénue du monde, la plus certaine, et la plus rare. Or de cette rencontre nuptiale de l’être et de la vie, tout nous détourne, à commencer par ces lieux communs philosophiques qui, par exemple, nous veulent persuader que le moment présent, aussitôt détruit que perçu, n’existe pas et que nul ne saurait y établir sa demeure. Tout nous détourne du resplendissement de l’être : ces morales serves qui prétendent que la fin justifie les moyens, ce temps linéaire, pure fiction, mais despotique, qui nous subjugue aux seules logiques de la production et de la reproduction. Pour René Char, l’existence ne précède point l’être, elle est pure disparition dans le contact éperdu de l’être et de la vie. « Obéissez à vos porcs qui existent. Je me soumets à mes dieux qui n’existent pas. Nous restons gens d’inclémence ». Mais ces dieux qui n’existent pas vivent et reviennent : « Les dieux sont de retour, compagnons. Ils viennent à l’instant de pénétrer dans cette vie ; mais la parole qui révoque, sous la parole qui déploie, est réapparue, elle aussi, pour ensemble nous faire souffrir ».
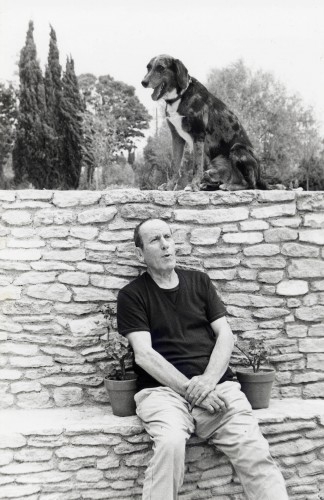 « A l’instant », cela n’est rien, cela n’existe pas encore, les porcs n’en sauront rien, mais c’est, déjà et à jamais, un monde, exactement présent et prodigieusement hors d’atteinte : « L’âge du renne, c’est-à-dire l’âge du souffle. O vitre, ô givre, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite ». De l’avers et de l’envers, de la floraison et de la destruction, le poète dit l’entre-deux. « Faire un poème, c’est prendre possession d’un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très-rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort. » A ne point vouloir se défaire du Tragique comme le « dernier des hommes » dont parle Nietzsche, mais, au contraire à le renouer en soi jusqu’à la douleur exquise, le poème sauvegarde ce qui n’est, en aucune façon, interchangeable, cette seconde pure, cet instant où les dieux apparaissent, cet instant qui se tient, cet instant d’âge immense, soleil : « frais soleil dont je suis la liane ».
« A l’instant », cela n’est rien, cela n’existe pas encore, les porcs n’en sauront rien, mais c’est, déjà et à jamais, un monde, exactement présent et prodigieusement hors d’atteinte : « L’âge du renne, c’est-à-dire l’âge du souffle. O vitre, ô givre, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite ». De l’avers et de l’envers, de la floraison et de la destruction, le poète dit l’entre-deux. « Faire un poème, c’est prendre possession d’un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très-rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort. » A ne point vouloir se défaire du Tragique comme le « dernier des hommes » dont parle Nietzsche, mais, au contraire à le renouer en soi jusqu’à la douleur exquise, le poème sauvegarde ce qui n’est, en aucune façon, interchangeable, cette seconde pure, cet instant où les dieux apparaissent, cet instant qui se tient, cet instant d’âge immense, soleil : « frais soleil dont je suis la liane ».
On répute les poèmes de René Char difficiles ou obscurs comme s’il fallait au lecteur des clefs extérieures au poème ou au monde, une science particulière, réservée. Il n’en est rien, sauf à prendre cette « science réservée » comme un privilège de la pauvreté, une simplicité d’âme et d’accueil qui consent à l’approfondissement de l’heure. C’est à ne pas approfondir le temps, qui est le temps du cosmos non moins que celui de notre âme à fleur de peau, que le poème de Char nous demeure scellé. Pour l’entendre et le voir, il faut s’attarder, non point jusqu’à l’hypnose ou la manie interprétative, non point au détriment de l’élan et de l’essor, mais juste le temps de rendre aux mots leur dignité concrète, de les laisser s’épanouir, choisir leurs courants intimes, leurs rapports de forces singuliers, leurs destinées florales, pierreuses ou brumeuses. Les mots sont là, avec leur halo, leur rugosité, leur éclat. Le poème de René Char n’exige de nous rien d’autre que ce consentement au temps qui laisse affleurer les étymologies, les analogies, et cette irréductible compacité de la chose dont le mot se revêt pour dire son immatérialité et peut-être, sa divinité. Cette divinité confond en une seule requête l’aurore et l’orée. Il vient un moment où le mot, redevenu l’égal de la chose qu’il nomme, comme un idéogramme ou un hiéroglyphe, nous précipite vers une connaissance première : « Seule est émouvante l’orée de la connaissance. » Le poème de Char est bien pur poème et non pas « poème philosophique » comme certains l’ont dit, dans la mesure où il apporte les réponses avant les questions : « Aucun oiseau n’a le cœur de chanter dans un buisson de questions ».
Si les dieux reviennent, ainsi que l’écrit René Char, c’est par les mots rendus à leur densité physique, à leur immanence enchantée. Tel est le beau paradoxe du poème que de nous offrir la transcendance du Sens, son ciel le plus haut à partir du mot revenu, après un long périple, à son immanence, à sa force de chose et de cause. Telle est exactement la « Recherche de la base et du sommet ». Point d’espace entre l’être et la vie, sinon celui de nos abandons, de nos craintes, de nos atermoiements, de nos illusions communicatives, de nos enrichissements factices. Le recueil de René Char, Pauvreté et privilège, dont le titre à lui seul est un manifeste, puisque tout privilège essentiel se paye désormais de pauvreté (comme le savait aussi Charles Péguy disant « l’éminente pauvreté des dignes »), s’ouvre sur une dédicace qui suffit à écarter d’emblée des meutes de tricheurs : « Pauvreté et privilège est dédié à tous les désenchantés silencieux, mais qui, à cause de quelque revers, ne sont pas devenus pour autant inactifs. Ils sont le pont. Ferme devant la meute rageuse des tricheurs, au-dessus du vide et proche de la terre commune, ils voient le dernier et signalent le premier rayon. ».
 Aussitôt faut-il préciser que l’ontologie de René Char n’a rien de quiétiste, qu’elle n’ouvre pas à l’indifférence, à ce « pareil au même » qui, quelquefois, se prétend sagesse ! Ontologie guerroyante, impérative, ne résorbant pas le Tragique dans l’effusion vague mais le rendant à la guerre d’où il vient, à laquelle nous ne pouvons nous dérober, l’ontologie poétique de René Char s’accomplit dans la fidélité au foyer secret des mots et des choses, rendant caduque la querelle théologique du nominalisme et du réalisme. Entre le dernier rayon et premier, toute la nostalgie se change en pressentiment. Toutefois, René Char n’ignore pas que nous vivons un « cycle bas » où « l’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant ».
Aussitôt faut-il préciser que l’ontologie de René Char n’a rien de quiétiste, qu’elle n’ouvre pas à l’indifférence, à ce « pareil au même » qui, quelquefois, se prétend sagesse ! Ontologie guerroyante, impérative, ne résorbant pas le Tragique dans l’effusion vague mais le rendant à la guerre d’où il vient, à laquelle nous ne pouvons nous dérober, l’ontologie poétique de René Char s’accomplit dans la fidélité au foyer secret des mots et des choses, rendant caduque la querelle théologique du nominalisme et du réalisme. Entre le dernier rayon et premier, toute la nostalgie se change en pressentiment. Toutefois, René Char n’ignore pas que nous vivons un « cycle bas » où « l’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant ».
« J’ai, de naissance, la respiration agressive. » Ce Résistant, qui ne fut ni de pacotille ni de dernière minute, tenait en réserve, dans sa fidélité inconsolée, ce regain de lucidité qui permet au pessimisme d’être actif sans se tromper : « Ce monde contemporain nous a déjà retiré le dialogue, la liberté et l’espérance, les jeux et le bonheur ; il s’apprête à descendre au centre de même de notre vie pour éteindre le dernier foyer, celui de la Rencontre. » Célébrer l’être et la vie en leurs resplendissements divers, ce n’est point alors se départir de la puissance du refus, ni de la brûlure de la lucidité, mais en ressaisir le chance imparable. Ce monde contemporain, moderne ou post-moderne, est illégitime. Son espace, en ce cycle bas, est strictement équivalent à ce qui nous fut arraché, dérobé, à ce qui fut souillé et pillé, à ce qui fut profané et détruit. Ce monde immonde dont le mouvement fondamental est l’expropriation de toute légitimité supérieure, René Char ne se contente pas de le déplorer, il lui oppose un autre monde, une cohérence ignorée, mais vivante encore, renaissante à la pointe du dernier rayon qui est peut-être aussi le premier : « Je me révolte donc je me ramifie. Ainsi devraient parler les hommes au bûcher qui élève leur rébellion » et ceci encore : « Nous sommes forts. Toutes les forces sont liguées contre nous. Nous sommes vulnérables. Beaucoup moins que nos agresseurs qui, eux, s’ils ont le crime, n’ont pas le second souffle. »
Donc, un combat fait rage, dont la plupart ne savent rien, et dont, méprisants, ils ne se soucient : « Pour un être de mépris, toutes les sources sont polluées et à sa charge, encore que leurs abords soient propices à son jeu ». Hostile au Tragique comme à la joie, l’être de mépris domine le monde en proclamant la relativité de tout, qui elle-même travaille à l’indifférenciation et à la planification. Or, Pour René Char, vivre en poète, c’est vivre au diapason des vertus irréductibles des êtres et des choses, de leurs singularités exaltées, sensibles autant que « talismaniques ». Le « multiple » dont parle René Char, est sacré, il est une manifestation dont les hommes ne peuvent disposer à leur guise, et dont le poète reconnaît la précellence : « De si loin que je me souvienne, je me distingue penché sur les végétaux du jardin désordonné de mon père, attentif aux sèves, baisant des yeux formes et couleurs que le vent semi-nocturne irriguait mieux que la main infirme des hommes. » Depuis, combien de paysages massacrés, d’arbres coupés au bon vouloir des êtres de mépris, pour satisfaire à leur inclination à jouer aux abords en ignorant la reconnaissance ? « Moi qui jouis du privilège de sentir tout ensemble accablement et confiance, défection et courage, je n’ai retenu personne sinon l’angle fusant d’une rencontre. »

Mais est-il encore possible de rencontrer quelqu’un, lorsque dans une société devenue la première ennemie de la civilisation, les êtres humains ne se rencontrent plus que par l’entremise de représentations abstraites ? Tout nous donne à penser que l’homme n’est plus au monde, que dissocié de son paysage sensible et intelligible, sa valeur, sa réalité même se réduisent à ce qu’il représente. Entre accablement et confiance brûle donc la lucidité qui honore le passé et l’exil : « Jadis l’herbe, à l’heure où les routes de la terre s’accordaient dans leur déclin, élevait tendrement ses tiges et allumait ses clartés. Les cavaliers du jour naissaient au regard de leur amour et les châteaux de leurs bien-aimées comptaient autant de fenêtres que l’abîme porte d’orages légers… » Ce passé, certes, on ne saurait le réduire à un passé historique ou, pire encore, sociologique. Passé, pour reprendre le mot de Heidegger, « historial » et poétique, il est cet « autre temps », cette temporalité féconde, ce « vent semi-nocturne » qui irrigue le paysage réel que l’aujourd’hui idéologique veut à tout prix ignorer. La résistance de René Char ne s’explique sans doute pas autrement ; il est l’homme d’un pays, c’est à dire qu’il consent à appartenir à une multiplicité vivante, à un cours parfois tumultueux, celui de la Sorgue : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau ». Nous sommes encore quelques uns à penser que la prière qu’un homme adresse à sa rivière est plus importante, pour nous tous, que l’accélération du TGV ou la fabrication faramineuse d’autres engins ou édifices titanesques, où la navrante impuissance des modernes sur leur propre destin croit trouver une sorte de compensation. Les dieux reviennent ; nous en acceptons l’augure s’ils viennent à se loger dans ces rivières, ces pierres, ces arbres qui nous tiennent à cœur. L’œuvre de Char nous montre qu’un homme qui rompt, se rebelle, s’obstine et va vers son risque avec bienveillance est aussi un homme de prière : « Rivière au cœur jamais détruit dans ce monde fou de prison, garde-nous violent et ami des abeilles de l’horizon. »

Le propre du monde des titans et de la technique est de tout dévaster puis de nous dire, au cœur du désastre, lorsque nous ne sommes plus nulle part (mais qui est partout !) comme il est bon d’être convivial et pacifique ! Ceux qui n’y consentent, bien sûr, seront nommés « réactionnaires », ou « passéistes », encore serait-il plus juste de les dire poètes, tout simplement, amis des sentes forestières : « Jadis l’herbe était bonne aux fous et hostile aux bourreaux. Elle convolait avec le seuil de toujours. Les jeux qu’elle inventait avaient des ailes à leurs sourires (jeux absous et également fugitifs). Elle n’était dure pour aucun de ceux qui perdant leur chemin souhaitent le perdre à jamais. ». Cet « à jamais » et ce « toujours » s’opposeront à la permanente obsolescence des « nouveautés » que les Modernes adulent en les jetant les unes après les autres. Ils s’opposeront de toute la force de la prière qui épouse « le ralenti du lierre à l’assaut de l’éternité ». Ils s’opposeront, sous l’apparence du « peuplier à taille d’ogive », du peuplier des pays de France, arbre divaguant au ciel profond, à « la laideur qui décompose sa proie ».
Luc-Olivier d’Algange
00:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : luc-olivier d'algange, poésie, rené char, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 novembre 2020
Victor Hugo et le retour des « Âges éclatants »

Luc-Olivier d’Algange:
Victor Hugo et le retour des « Âges éclatants »
Notes pour desservir à une commémoration
Nous vivons en des temps commémoratifs et quelque peu funéraires. Le présent nous échappe, faute de réelle présence au monde, l'avenir nous semble incertain et le passé incompréhensible. Ce qui fut autrefois tradition, c'est-à-dire transmission de vivant à vivant des formes, des sagesses et des visions, sous le signe de la reconnaissance et de la « métamorphose » (selon le mot d'André Malraux) n'est plus qu'une répétition morne, un ressassement cauchemardesque de disque rayé.
Nos commémorations ne sont plus des hommages, qui impliqueraient que nous relevions à notre tour quelque défi essentiel, mais des autopsies. Nos critiques littéraires, lorsqu'ils n'empruntent pas la rhétorique du procureur ou de l'avocat adoptent la méthodologie de la médecine légale. Tout se passe comme s'il s'agissait de s'assurer que nos défunts le demeurent, qu'ils ne risquent plus, par leurs œuvres, d'animer nos ardeurs, de susciter de nouvelles flambées de poésie et de songe dans nos âmes dévastées. Nous recyclons ces cadavres augustes et nous les nommons, avec une outrecuidance infinie, « nos précurseurs ».
Je doute fort que nous fassions honneur à nos hommes illustres en les retournant ainsi dans leurs tombes, à intervalles réguliers, selon la logique, chronologiquement rigoureuse mais philosophiquement hasardeuse, des anniversaires, dont on peut dire qu'ils sont, pour paraphraser Lautréamont, la rencontre sur une pièce montée, du scalpel du dissecteur et de la clef à molette du ferrailleur. Entre la nouvelle critique et le nouveau journalisme, chacun peut y aller de bon cœur dans le charcutage ou dans la récupération...
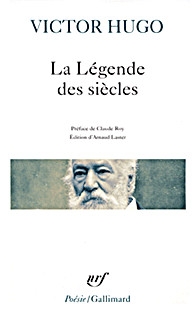 Prenez ces quelques lignes comme un refus de souffler les bougies d'un poète qui allume encore dans la nuit de nos cœurs des flambeaux. Non, Victor Hugo n'est pas ce poète « moderne », « démocrate », « progressiste », précurseur de la monnaie unique et du monde mondialisé ! Victor Hugo n'est pas davantage ce paillard sympathique, ce républicain jacobin où d'autres trouvent leur miel et leur fiel. Victor Hugo, s'il vous en souvient, est l'auteur de La Légende des Siècles.
Prenez ces quelques lignes comme un refus de souffler les bougies d'un poète qui allume encore dans la nuit de nos cœurs des flambeaux. Non, Victor Hugo n'est pas ce poète « moderne », « démocrate », « progressiste », précurseur de la monnaie unique et du monde mondialisé ! Victor Hugo n'est pas davantage ce paillard sympathique, ce républicain jacobin où d'autres trouvent leur miel et leur fiel. Victor Hugo, s'il vous en souvient, est l'auteur de La Légende des Siècles.
Tout ce que le monde moderne abomine se trouve dans Victor Hugo: le chant patriotique, la célébration des héros, la vision légendaire et épique, les cosmogonies et les théogonies, le sens du tragique et de l'amour sublime, l'âpreté de la nature et des combats, la vision impériale... Est-il même nécessaire de préciser, en passant, que Les Misérables sont bien plus proche de Léon Bloy que de l'idéologie social-démocrate ? Certes, quelques esprits chagrins, de tendance intégriste, peuvent encore considérer Hugo comme un hérésiarque, mais il n'échappera à personne que, dans sa poésie, Hugo ne parle que de Dieu.
Ce Dieu est en toute chose et en même temps en dehors de toute chose. Les ombres et les nombres, qui riment infiniment dans la poésie hugolienne, les brins d'herbe, les pierres, les arbres, les cieux sereins ou en folie, la geste des paladins, l'Océan et les profondes forêts de nos songes font, dans les poèmes de Victor Hugo, honneur au Dieu qui les créa. Ce n'est point Saint-François ni Maître Eckhart qui contrediront Hugo, mais l'agnostique moderne, avec sa tiédeur pseudo-sceptique.

Hugo trouve Dieu partout: dans les hauteurs du Ciel comme dans les profondeurs de la mer. Ennemi acharné de la platitude, qu'il voyait triompher dans la monarchie bourgeoise, Hugo ne cessa de nous mettre en demeure de partager sa vision verticale et vertigineuse de l'âme humaine et du monde. La « république » d’Hugo est héroïque et panthéiste, et sa « démocratie » est cosmique. Loin d'opposer aux despotes et aux tyrans l'idéologie procustéenne, qui en est à la fois la cause et la conséquence, Hugo invoque les puissances secrètement détenues dans la vision des Mages et des Prophètes. Hugo célèbre la magnanimité de l'Aède et la subtile, mais imparable, ambassade du Symbole:
« Qu'on pense ou qu'on aime
Sans cesse agité,
Vers un but suprême
Tout vole emporté;
L'esquif cherche le môle,
L'abeille un vieux saule,
La boussole un pôle
Moi la vérité. »
En ces quelques vers rimbaldiens Hugo précise son dessein: ce ne sont point le relatif ou l'éphémère, ces idoles modernes, qu'il courtise, mais le pôle de l'être, « Vérité profonde/ Granit éprouvé. ». Logocrate, comme Steiner le disait de Pierre Boutang, Hugo se livre à une herméneutique générale du monde. Pour lui tout est signe et intersigne. Le monde, écriture divine, se laisse déchiffrer. Le visible est l'empreinte de l'Invisible. Le poème hugolien participe d'une théologie du Verbe incarné. Le monde sensible est un livre ouvert au poète qui sait le contempler:
« Saint livre où la voile
Qui flotte en tous lieux
Saint livre où l'étoile
Qui rayonne aux yeux
Ne trace, ô mystère !
Qu'un nom solitaire
Qu'un nom sur la terre
Qu'un nom dans les cieux... »
On nous répète qu’Hugo est « novateur » en idéologie. Nous le voyons surtout novateur en poésie: certain de ses vers semblent frappés par Mallarmé, d'autres, nous l'avons vu, semblent forgés dans la forge philosophale de Rimbaud. Le Surréalisme est beaucoup moins surréaliste qu’Hugo. A les comparer à Dieu et à La fin de Satan, les cadavres exquis font figure d'une tempête dans un verre d'eau. La Bouche d'Ombre n'est point exquise, elle est grandiose. Toute l'œuvre d’Hugo se place sous le signe de la grandeur.

Ce qui n'est point grand toujours l'offusque; ce qui est grand presque invariablement le ravit. Hugo est le poète qui veut introduire d'autres ordres de grandeur dans l'intelligence humaine, ou, plus exactement, œuvrer à leur recouvrance. Pour Victor Hugo, radicalement antimoderne à cet égard, la grandeur et l'éclat sont à l'origine de notre cycle historique. Comme Hésiode, dont La Légende des siècles semble l'interprétation magnifique, Hugo croit au déclin des puissances, selon une logique que l'on pourrait presque dire « guénonienne ». Cette évidence, soigneusement occultée par les adeptes de la « modernité » n'a pas échappée à Gustave Thibon, qui savait, au sens littéral, la poésie de Victor Hugo, par cœur, et par le cœur:
« Toutes les vérités premières sont tuées.
Les heures qui ne sont que des prostituées,
Viennent chanter pour eux, montrant de vils appas
Leur offrant l'avenir sacré, qu'elles n'ont pas. »
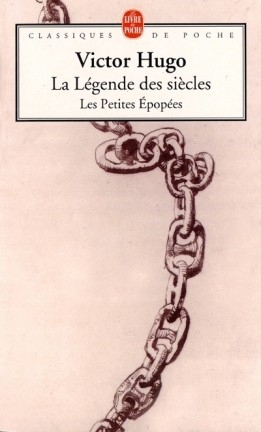 Gustave Thibon voit à juste titre dans ces quatre vers, qui résument le projet de La Légende des siècles, une condamnation radicale du progressisme. Cet « avenir sacré qu'elles n'ont pas », comment ne pas y reconnaître la fallacieuse promesse des lendemains qui chantent, internationalistes ou « mondialistes », de tous les totalitarismes progressistes ? Ce qui importe par-dessus tout c'est: « la sombre fidélité pour les choses tombées ». La victoire appartient aux heures menteuses, mais seulement pour un temps, dans l'interrègne: « Pour les vaincus la lutte est un grand bonheur triste/ Qu'il faut faire durer le plus longtemps qu'on peut ». Rien n'est plus étranger à la mentalité progressiste que ce pessimisme actif qui se transfigure en espérance platonicienne: « Qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel ? ». Suivons encore Gustave Thibon, lorsqu'il nous fait remarquer, dans ses entretiens avec Philippe Barthelet, que « tout Platon est là: des trois transcendantaux, la beauté seule a le privilège de l'apparence sensible »:
Gustave Thibon voit à juste titre dans ces quatre vers, qui résument le projet de La Légende des siècles, une condamnation radicale du progressisme. Cet « avenir sacré qu'elles n'ont pas », comment ne pas y reconnaître la fallacieuse promesse des lendemains qui chantent, internationalistes ou « mondialistes », de tous les totalitarismes progressistes ? Ce qui importe par-dessus tout c'est: « la sombre fidélité pour les choses tombées ». La victoire appartient aux heures menteuses, mais seulement pour un temps, dans l'interrègne: « Pour les vaincus la lutte est un grand bonheur triste/ Qu'il faut faire durer le plus longtemps qu'on peut ». Rien n'est plus étranger à la mentalité progressiste que ce pessimisme actif qui se transfigure en espérance platonicienne: « Qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel ? ». Suivons encore Gustave Thibon, lorsqu'il nous fait remarquer, dans ses entretiens avec Philippe Barthelet, que « tout Platon est là: des trois transcendantaux, la beauté seule a le privilège de l'apparence sensible »:
« Mon péristyle semble un précepte des cieux,
Toute loi vraie étant un rythme harmonieux...
Nul homme ne me voit sans qu'un dieu l'avertisse (...)
Je suis la vérité bâtie en marbre blanc;
Le beau c'est, ô mortels, le vrai plus ressemblant.
Si Victor Hugo est novateur, c'est précisément par ce sens de la recouvrance, qui relève le défi de l'Age Noir, par la remémoration des « âges éclatants », et la promesse que leur présence en nous laisse transparaître. Victor Hugo fut, avec Novalis, Leconte de Lisle et Schopenhauer, l'un des premiers à opérer au retour de l'hindouisme traditionnel dans la culture européenne, dans son poème Suprématie, adaptation-traduction d'une upanishad, initiant ainsi le retour au « mystérieux sanscrit de l'âme » de nos origines les plus lointaines dont parlait Novalis. « L'impossible à travers l'évidence transparaît » écrit Hugo. L'Age d'or bruit et scintille dans nos âmes avec le souvenir des « vérités premières » assassinées.
Luc-Olivier d'Algange.
11:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, victor hugo, 19ème siècle, france, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 novembre 2020
Fernando Pessoa. Un cartulaire héraldique

Luc-Olivier d’Algange:
Fernando Pessoa. Un cartulaire héraldique
A André Coyné
L'idée d'Empire domine l'œuvre diverse de Fernando Pessoa. Le désir d'embrasser la multiplicité, de ressaisir les innombrables aspects de l'âme, d'être, enfin soi-même, le masque de toute vie et de toute chose, de s'en approprier l'essence par les communions et les ruses du personnage,- tout cela témoigne d'un dessein littéraire qui commence avant la page écrite et s'achève après elle, en des oeuvres vives, ardentes et impressenties, que l'on peut dire philosophales. De l'Alchimie et, d'une manière plus générale, de la tradition hermétique et néoplatonicienne occultée par le triomphe des théories matérialistes, les poètes demeurent, en Europe, les ultimes ambassadeurs. L'œuvre de Pessoa ne fait pas exception à cette règle méconnue qui associe la grandeur poétique, l'audace visionnaire et la fidélité à la plus lointaine tradition.

Alors que la science profane travaille par déductions sur le mécanisme et les quantités du monde sensible, la science hermétique œuvre, par l'analogie, au sacrement des qualités et des essences. L'une s'interroge sur le comment, l'autre donne réponse au pourquoi. La différence est capitale, et ce n'est pas le hasard si tant de poètes modernes, enclins à la spéculation, retrouvèrent, dans la tradition hermétique, les grandes lignes de leur dessein poétique.
« Avec l'aide et l'assistance de Dieu, écrivit Pic de la Mirandole, l'Alchimie met en lumière toutes les énergies cachées de par le vaste monde. Comme le vigneron greffe le cep sur l'orme et sur l'espalier, le mage, l'Alchimiste sait unir et pour ainsi dire marier terre et ciel, énergies inférieures et énergies supérieures ». Cette coïncidence des contraires, qui dépasse également l'opposition philosophique du réalisme et du nominalisme, il est facile de comprendre en quoi elle séduisit Fernando Pessoa. La hiérogamie cosmique, le dépassement du dualisme en des noces miroitantes, impériales, apparente ici la nostalgie de la conquête et le pressentiment des retrouvailles, la poésie et l'Empire. Par le Grand-Oeuvre solaire, le regret de l'Age d'Or devient l'annonce du Retour, l'adepte se substituant au temps, et disposant du pouvoir de transfigurer la nature :« L'eau céleste et indestructible, écrit Bernard Gorceix, le feu intangible de l'empyrée, se trouvent finalement unis, par le ciel cristallin, par la sphère des astres, par la flore, la faune, par les pierres et les mines, à l'eau corporelle, lentement distillée et volatilisée, pour l'édification de ces cieux nouveaux et de cette terre nouvelle dont rêve l'Alchimiste. » Il ne s'agit donc pas seulement de repérer dans les poèmes de Pessoa des images alchimiques mais bien de montrer que le principe de l'œuvre, en ses ramifications hétéronymiques, s'identifie à la genèse et à l'accomplissement d'un secret d'or impérial, « identique à l'or de la nature, non seulement comme effet mais aussi comme cause ».
« De même, écrit Pessoa, que l'intelligence dialectique, que l'on nomme raison, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance scientifique, de même, l'intelligence analogique, qui n'a aucun nom particulier, régente et ordonne tous les éléments de la connaissance ésotérique. La perfection de l'œuvre matérielle est un tout parfaitement constitué, dans lequel chaque partie a sa place et concourt selon son mode et son grade à la formation de ce tout; la perfection de l'œuvre spirituelle est l'exacte correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et le corps. » Le Grand-Œuvre consiste alors à trouver, dans le temps, par la science analogique des astres et de la lumière, l'angle prophétique s'ouvrant sur l'au-delà du temps, qui est le cœur du temps, tel l'instant, île de cristal se tenant immobile dans la déroute universelle, sous la voûte ordonnatrice du graal-miroir.

Ainsi, par fidélité au dieu dorique de la lumière, l'alchimiste défie le règne de Kronos, afin de vaincre la durée profane et l'histoire elle-même, par le sens semblable à une lance de feu qui l'interrompt et la transcende pour la très-grande gloire de l'Esprit dont il est dit dans L'Apocalypse d'Hermès (traité anonyme du dix-septième siècle) : « Il vole vers le ciel par le monde intermédiaire. Nuage qui monte vers l'aurore, il introduit dans l'eau son feu qui brûle, dans le ciel il a sa terre clarifiée. »
Sans doute sommes nous fondés à voir dans l'intelligence analogique qui, précise Pessoa, « n'a aucun nom particulier » une exigence de la poésie en tant que moyen de connaissance et imagination créatrice, pour reprendre l'expression rendue célèbre par les magistrales études de Henry Corbin sur Ibn'Arabi, Sohravardî ou Ruzbehân de Shîraz. L'imagination créatrice, on le sait, est cet espace médiateur entre le sensible et l'intelligible, entre la multiple splendeur du monde sensible et l'unificente clarté des Idées, où s'inscrivent les signes, les Symboles, les silhouettes ou les icônes de la sagesse divine. Car l'Idée est avant tout une chose vue dans le matin profond et les promesses de l'intelligence « qui n'a encore aucun nom particulier »; elle advient comme un scintillement sur la surface des eaux, comme une vision que l'on reconnaît, l'expérience visionnaire n'étant rien d'autre que le moment de la plus haute intensité, dans l'épopée de la réminiscence.
A l'exemple des poète-philosophes néoplatoniciens, tels que Jamblique ou l'Empereur Julien, Fernando Pessoa ne juge pas exclusives l'une de l'autre la réflexion philosophique et l'expérience visionnaire. Tout au contraire, il entreprend d'éclairer l'une par l'autre afin de retrouver, en amont, l'expérience originelle de la pensée, l'ingénuité primitive de l'accord parfait, d'une sagesse qui, dans sa plénitude, renonce à s'affirmer pour telle : « Lorsque viendra le Printemps, écrit Alberto Caiero, si je suis déjà mort, les fleurs fleuriront de la même façon, et les arbres ne seront pas moins verts qu'au Printemps passé. »

De l'arbre généalogique des hétéronymes de Fernando Pessoa, Alberto Caiero serait en quelque sorte le tronc. De lui se réclament l'érudit et subtil Ricardo Reis et le sauvage et futuriste Alvaro de Campos. D'Alberto Caeiro à Alvaro de Campos, la distance est la même que celle qui sépare Héraclite et Proclus, le pré-socratique et le néoplatonicien,- le « découvreur de la nature » et le chantre de la violence « ultimiste », gnostique païen aspirant sans doute à la même « innocence des sens », pour reprendre l'expression de Nietzsche, mais devant, pour l'atteindre, passer par toutes les outrances de la révolte, de l'imprécation et de l'apostasie. En ce sens Alvaro de Campos est plus proche de nous. Son inquiétude et son tumulte sont davantage à notre ressemblance que la sérénité de Caiero, infiniment désirée mais perdue comme sont perdus pour nous, « affreusement perdus », l'Age d'Or dont parlait Hésiode et la silencieuse enfance, et l'Empire, cet idéal androgyne.
L'Idée d'Empire, en ouvrant une troisième voie entre l'isolement égotiste et le nivellement collectif, ressuscite aussi une certaine forme d'espoir « méta-politique ». Diversité ordonnée, hiérarchie au sens étymologique du terme, fondant le principe de l'Autorité sur le sacré et non plus sur le pouvoir temporel, l'Empire dont rêve Pessoa est à la ressemblance du beau cosmos miroitant, de cette « terre clarifiée ». Obscurcie par ses parodies successives, l'Idée d'Empire est devenue aujourd'hui presque incompréhensible. « Tout Empire qui n'est pas fondé sur un impérialisme spirituel est un cadavre régnant, une mort sur un trône » écrit Fernando Pessoa. Il importe ici de retrouver le sens du discernement et ne plus confondre totalité et totalitarisme, unité et uniformité, autorité et pouvoir, gloire et réussite, métaphysique et idéologie, intransigeance et fanatisme, principes et valeurs.
Alors que les valeurs et les idéologies concernent, selon la formule de Raymond Abellio « l'espèce humaine en tant qu'espèce, dans son ensemble ou ses sous-ensembles », les principes concernent l'être humain dans sa solitude et dans sa communion. Les valeurs relèvent d'une appartenance grégaire et utilitaire. Les principes obéissent à l'unique souveraineté de l'Esprit et témoignent d'une vocation héroïque, ascétique, ludique ou contemplative : « En créant notre propre civilisation spirituelle, écrit Pessoa, nous subjuguerons tous les peuples; car il n'y a pas de résistance possible contre les forces de l'Esprit et des arts, surtout lorsqu'ils sont organisés, fortifiés par des âmes de généraux de l'Esprit. »

Comment définir exactement cet impérialisme ? Pessoa propose la formule: « Un impérialisme de poètes ». En effet, écrit-il, « l'impérialisme des poètes dure et domine; celui des politiciens passe et s'oublie s'il n'est rappelé par le chant des poètes. » L'avenir du Portugal, et, par voie de conséquence, de l'Europe, sortie enfin de la pénombre de son activisme somnambulique, est déjà écrit pour qui sait lire dans les strophes de Bandarra. Cet avenir, explique Pessoa, c'est d'être tout: « Ne tolérons pas qu'un seul dieu reste à l'extérieur de nous-mêmes. Absorbons tous les dieux ! Nous avons déjà conquis la Mer; il ne nous reste qu'à conquérir le Ciel en laissant la Terre aux autres... Etre tout, de toutes les manières, parce que la vérité ne peut exister dans la carence. Créons ainsi le Paganisme Supérieur, le Polythéïsme Suprême ! »
La rimbaldienne « alchimie du Verbe » la quête de « l'étincelle d'or de la lumière nature » s'anime ainsi d'une impérieuse exigence d'étendre le domaine du Sens. Vasco de Gamma des mers et des cieux intérieur, Pessoa ne cherche point à se perdre dans les abysses de l'indéterminé ou de l'absurde, mais de conquérir. En son dessein cosmogonique et impérial, il suit l'orientation du Soleil-Logos. De même que Sohravardî voulut réactualiser la sagesse zoroastrienne de l'ancienne Perse tout en demeurant fidèle à la plus subtile herméneutique abrahamique, Pessoa nous promet le retour de Dom Sébastien, un matin de brouillard, précédant le triomphe du Cinquième Empire : « Par matin, précise Pessoa, il faut entendre le commencement de quelque chose de nouveau,- époque, phase ou quelque chose de similaire. Par brouillard, il faut entendre que le Désiré reviendra caché et que personne ne s'apercevra de son arrivée et de sa présence. »

Le retour au « paganisme » que suggérait Alvaro de Campos pour en finir avec le matérialisme « qui exprime une sensibilité étroite, une conception esthétique réduite, puisqu'il ne vit pas la vie des choses sur le plan supérieur » n'est en rien un refus de la transcendance mais un appel aux vastes polyphonies de l'Ame du monde, écharpe d'Iris et messagère des dieux : « Inventons, écrit Pessoa, un Impérialisme Androgyne réunissant qualités masculines et féminines; un impérialisme nourri de toutes les subtilités féminines et de toutes les forces de structuration masculines. Réalisons Apollon spirituellement. Non pas une fusion du christianisme et du paganisme, mais une évasion du christianisme, une simple et stricte transcendantalisation du paganisme, une reconstruction transcendantale de l'esprit païen.
« Une reconstruction transcendantale de l'esprit païen ». La formule qui n'est paradoxale qu'en apparence mérite d'être méditée. Elle nous reporte directement à cette période faste du néoplatonisme païen qui, de Plotin à Damascius, œuvre comme l'écrit Antoine Faivre « à poser une procession intégrale, une transcendance intransigeante, alliée à une immanence mystique ». Et cela tout en opérant la convergence des Arts sacrés et des religions du Mystère héritières de l'Egypte pharaonique. Il ne s'agit donc nullement ici d'une régression vers une religiosité naturaliste, ou panthéïste, mais, tout au contraire, de l'édification, selon les hiérarchies platoniciennes d'une véritable métaphysique établissant clairement la distinction entre la nature et la Surnature. Mais là encore distinction ne signifie point séparation. La dualitude est nuptiale; et si le soleil que l'on célèbre n'est point le soleil physique mais, à travers lui le soleil métaphysique du Sens, du Logos, alors l'ascendance matutinale de l'astre est l'image de l'exhaussement de la conscience humaine hors de sa gangue naturelle, son élévation glorieuse, impériale. Le projet de reconstruction de Fernando Pessoa s'éclaire ainsi des subtiles couleurs du monde antérieur.

Messages, cartulaire héraldique du drapeau portugais, égrène, pour reprendre l'expression de Armand Guibert « un rosaire où s'enchaînent les grains du Merveilleux: le roi Jean Premier, fondateur de la dynastie des Aviz y est adoubé Maître du Temple; Dona Filipa de Lancastre, son épouse, saluée Princesse du Saint-Graal; apostrophant le Saint-Connétable Nun'Alvarès, le poète évoque Excalibur, épée à l'onction sainte, que le roi Arthur te donna. » L'anamnésis, le ressouvenir de la Parole Délaissée est la seule promesse.
Luc-Olivier d’Algange
10:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, littérature, lettres, lettres portugaises, littérature portugaise, portugal, lisbonne, fernando pessoa |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 05 novembre 2020
Eloge de l'enchantement - Notes sur les Romantiques allemands

Luc-Olivier d’Algange:
Eloge de l'enchantement
Notes sur les Romantiques allemands
Le romantisme allemand fut à la fois une quête et une humeur. La quête romantique, au moins dans ses préférences, semble mieux connue que son humeur. Par des ouvrages didactiques, parfois hostiles, plus souvent hélas que par les œuvres, nous nous sommes formés, en France, une idée du Romantisme allemand comme d'une quête de l'irrationnel, d'un culte de la Nature et des forces obscures, d'un environnement de brumes et de forêts sur fond d'orchestrations wagnériennes. Nous savons de ces romantiques qu’ils écrivirent des romans d'initiation, qui s'aventurent du côté de l'orient et des arcanes du monde invisible. Les mieux informés, enfin, savent que les romantiques allemands furent aussi des philologues, des naturalistes, des mythologues qui eurent le souci de recueillir des contes et des légendes et d'esquisser une méditation sur la communauté de destin des Allemands.
La quête romantique, toutefois, ne se laisse pas distinguer de son humeur, qui ne se trouve que dans les œuvres, et relève d'une réalité plus subtile, plus impondérable que les « notions » dont la collecte peut satisfaire l'universitaire mais laisse ne suspens celui qui voudrait, lui aussi, « romantiser » avec les Romantiques, faire siennes leurs aspirations et leurs découvertes; ce qui est sans doute la seule manière de lire qui vaille mieux que l'ignorance.

Avant d'être une théorie, un système, s'il le fut jamais, le Romantisme allemand fut une façon d'être. Pour savants qu'ils eussent été, férus de toute les sciences de leur temps non moins que d'excellents humanistes, connaissant souvent non seulement le grec, le latin, les langues romanes, mais encore le sanscrit et l’hébreu, pour encyclopédiques que fussent leurs curiosités ( ne méconnaissons pas tout ce par quoi l’œuvre de Novalis, par exemple, relève encore du dix-huitième siècle), les Romantiques n’en tinrent pas moins leur modi essendi, leurs façons d’être, leur présence au monde, comme supérieures aux modi intellegendi, aux « modes de connaissance », à l’intelligence didactique ou critique.
A ces poètes-métaphysiciens, qui revendiquèrent la phrase de Goethe : « Je hais tout savoir qui ne contribue pas à rendre ma vie plus intense », toute science était vaine qui ne fût ordonnée à l’être, autrement dit à une connaissance supérieure, à une sapience à la fois sensible et intelligible qui se laisse traduire non par des systèmes et des doctrines, mais par une qualité d’élégance et d’enchantement, de noblesse et de légèreté à laquelle les esprits pompeux et lourds ne peuvent rien comprendre et qu’ils tiendront toujours, à juste titre, pour ennemie.
Novalis, qui fut bien le contraire d’un esprit chagrin, Novalis qui fut tant aimé des dieux qu’il mourut à l’âge de trente ans, reprochait précisément à la seconde partie du Wilhelm Meister de Goethe ce retour au sérieux, à la vie domestique, au savoir planifié, cette trahison de l’intensité et de la joie, qui éclate, au profit du bonheur qui dure et qui s’étale. Rien n’est plus difficile à définir qu’une humeur, elle est ce « je ne sais quoi », ce « presque rien » dont parlait Fénelon, qui nous emporte. On peut, sans trop prendre le risque de se tromper, la dire juvénile, quand bien même Jean-Paul Richter en perpétua toutes les vertus jusqu’au grand âge). On peut aussi, en hommage à Antoine Blondin, la dire vagabonde. La Lucinde de Schlegel, les Mémoires d’un propre à rien de Joseph von Eichendorf, annoncèrent la couleur : elle sera d’un bleu léger, d’une révolte sans pathos, souvent encline au libertinage, où le sens de la rencontre, du rêve et de l’ivresse avive le monde, délie les langues, dénoue les peurs, et nous précipite, avec impatience, vers le mystère des êtres et des choses.

Ces vertus, chères aux premiers Romantiques allemands, sont d’un genre viril. Elles se nomment liberté et courage, amitié chevaleresque et fidélité, et correspondent assez peu à l’image du Romantique se tordant les mains au clair de lune. L’humeur romantique se laisse aussi approcher par ce que Gobineau dit des « Calenders » dans son roman Les Pléiades, qui fut sans doute largement influencé par les romans de Jean-Paul Richter, et en particulier par Titan, - cet immense entrelacs de songes, d’aventures et de bonheurs. Si la peine et la mélancolie des temps qui nous abandonnent, la nostalgie et la déréliction, la folie même de ceux que frappe la foudre d’Apollon, la tragédie et la mort ne sont pas absente des œuvres romantiques, leur humeur, à qui fréquente leurs œuvres, fut d’emblée à la fantaisie, à l’audace, au rire et à l’ironie.
L’ombre et la lumière, au demeurant, n’existent que l’une par l’autre. Pour les Romantiques allemands, précurseurs, nous y reviendrons, de la logique du tiers-inclus, le Bien et le Mal ne sont pas des entités massive, irréductibles l’une à l’autre qu’affectionnent les esprits schématiques ; les crépuscules contiennent les aurores, et la Nuit dont Novalis écrivit les Hymnes, laisse se réfugier en elle, comme un éclat de lumière dans la prunelle de l’Aimée, tous les secrets du jour.
Il y aurait un livre entier à écrire sur l’ironie romantique. Cette ironie n’est point le ricanement de la certitude ou de la supériorité, l’antiphrase didactique et condescendante de Voltaire, mais une reconnaissance de la nature double, visible-invisible, du réel. Tout sens apparent divulgue, à celui qui s’y rend attentif, un sens caché. Toute apparence est transparence. Le monde n’est pas cette prison de convenances ou cette autre prison que serait une liberté dépourvue de sens. Le monde nous parle. Pour les Romantiques allemand, le langage que le monde nous adresse à travers les cristaux de neige, les murmures des feuillages ou les rumeurs de la mer n’est pas radicalement différents de celui dont nous autres humains usons et mésusons à loisir. Cette similitude, cette parenté est, pour les Romantiques allemands, une leçon d’humilité et de prodiges. Elle témoigne d’un accord possible entre le monde et l’homme, elle annonce des solitudes immensément peuplées d’âmes.

« La nature ne montre pas, ne dissimule pas, mais fait signe » écrivait Héraclite. Le Grand-Œuvre des Romantiques allemands sera le déchiffrement de ces signes, - déchiffrement dont l’humour, comme en témoignent le Contes de Hoffmann, n’est pas exclu. Tant qu’il est possible de rire, à travers l’herméneutique elle-même, rien n’est perdu. Les Romantiques allemands sont d’autant moins obscurantistes que l’interprétation qu’ils proposent des apparences et des signes, des textes sacrés (dont font partie les œuvres des poètes) est infinie. La sapience romantique est aussi peu administrative que possible. Le jeu de symboles et des correspondances, ne s’y trouve ni réglementé, ni instrumentalisé.
On pourrait dire, dans un apparent paradoxe, que ce qui sauve les Romantiques allemands de l’obscurantisme, c’est précisément cette défiance pour le rationalisme. Le culte de la « déesse Raison », dont on connaît les ravages, leur fut largement étranger. Le fou n’est pas celui auquel la raison fait défaut, mais bien celui qui a tout perdu sauf la raison. Toutefois, se défier de la raison n'interdit point d'être logicien ni de faire de la logique un instrument de spéculation et de prospection. L'accusation d'obscurantisme habituellement portée contre eux tient d'autant moins que ceux qui la formulent furent bien souvent les héritiers ou les instigateurs du totalitarisme moderne. Que le réel soit dialogique, pour reprendre le mot de Gilbert Durand, voire, polyphonique et gradué, - et avec une grande part d'imprévisible, - qu'il y eût une interdépendance entre la connaissance, celui qui connaît et la chose connue, que les ombres soient colorées et nos âmes chatoyantes et « tigrées » pour reprendre l'admirable formule de Victor Hugo, que les frontières entre la réalité et le songe soient indécises, que les métaphores soient à l'œuvre, qui changent les feuillages en serpents d'or, les amoureuses en sirènes, les arbres en patriarches, que les dieux puissent surgir et transparaître, que la parole soit donnée aux hiboux ou aux chats, que la différence entre les fées et les libellules puisse n'être, en certains cas, que de pure convenance, tout cela qui appartient au patrimoine imaginaire, ne reste point sans ouvrir des perspectives d'avenir, de nouvelles logiques et de neufs enchantements.

Peu encline à la linéarité, on ne saurait dire si la pensée romantique fut davantage tournée vers le passé ou vers l'avenir. Bien plus que rectiligne, la pensée romantique est encline à l'arborescence, à la sporade, à la spirale. « Grains de pollen », les pensées se dispersent, mais chacune d'elle tient en elle, mystérieusement, le ressouvenir de son origine. Ainsi, les Romantiques allemands ne furent ni progressistes, ni passéistes, ni excessivement confiant dans le « sens de l'histoire », ni adeptes d'une pure théorie de la décadence. Issus d'une tradition de l'intériorité, d'une spiritualité « paraclétique » illustrée par Angélus Silesius, Franz von Baader ou Jacob Böhme, ils répugnaient à se croire enchainés à quelque déterminisme historique: l'Histoire, avec des bonheurs divers, était en eux.
Certains critiques, non sans pertinence, ont distingué, chez les Romantiques allemands, deux courants, l'un « révolutionnaire » et quelque peu napoléonien, et l'autre, « réactionnaire», tourné vers l'anamnesis, l'ésotérisme, la recherche des fondements de « l'Allemagne secrète », ainsi que le nommera Stefan George. Ces deux courants, toutefois, s'opposent moins qu'il n'y paraît. Ce qui paraît juste, c'est de discerner un glissement, qui est moins d’ordre politique que mythologique. Peu à peu s'éloignant du dix-huitième siècle, de l'euphorie d'une Révolution vue de loin, Prométhée cède la place à Hermès. A la logique du voleur de feu (qui, par Hegel, est aux soubassements du marxisme qui voit en Prométhée la figure tutélaire des révolutions) succède le « feu de roue » des Alchimistes, les feux tournants de l'athanor, qui sont à la fois l'âme et le monde, l’intériorité et l'extériorité.
A la marche forcée du sens de l'Histoire, Novalis, Chamisso, Jean-Paul, préfèreront la promenade où, quelquefois, et comme par inadvertance, le vagabondage se change en pèlerinage, où la simple inclination au voyage devient une quête du Graal. On pourrait dire que le courant « hermésien » de l'Encyclopédie de Novalis s'oppose au courant prométhéen de la phénoménologie de l'Esprit de Hegel, comme, en retour, la volonté planifiante, étatique, hostile à la bigarrure du monde, s'oppose à la contemplation, au recueillement. Les choses, bien sûr, ne sont pas aussi simple, et il y eut bien un « hégélianisme de droite » qui, de Villiers de l'Isle-Adam à Jean-Louis Vieillard-Baron, tenta de donner à la procession hégélienne de l'Esprit une dimension verticale, et, pour tout dire, gnostique. Force est cependant de reconnaître qu'en sa postérité, comme le sut montrer Michel Le Bris, l'œuvre de Hegel engendra les philosophies et les idéologies les plus closes, poussant la raison triomphante à la folie et les hommes à la servitude.

Paradoxalement, ce passage de Prométhée à Hermès, du rationalisme à une sorte de sapience holistique, ajoute à la pensée romantique une finesse questionnante, un scepticisme, un « je ne sais quoi » de pyrrhonien qui fera toujours défaut à la lignée rivale, demeurée fidèle à l'hybris du voleur de feu.
Il y a davantage de question que de réponses dans les «grains de pollen » de Novalis, et si peu d'acrimonie et de ressentiment, que son œuvre nous apparaît aujourd'hui venir d'un autre monde. Voici belle lurette que les hommes n'écrivent plus sans haïr, au point que bien souvent la haine, le dépit, la rancœur semblent les seuls moteurs de leur écriture. Le fiel est ce qui demeure lorsque les enchantements ont disparu.
Au-delà la de leurs diversités qui sont grandes et qui rendent bien difficiles d'en parler en quelques pages, les Romantiques allemands, des plus sombres aux plus clairs, des plus rieurs aux plus tourmentés, des plus optimistes aux plus pessimistes, sont tous des hommes, et des femmes, de l'enchantement. Ces enchantements peuvent, eux aussi, être lumineux ou ténébreux, tels de douces brises sur la joue ou de noirs ensorcellements, des rencontres éblouies avec des paysages italiens, de suaves ensommeillements dans les bras des amantes ou des combats furieux contre des dragons; ces enchantements peuvent être austères ou dionysiaques, nous pencher de longues nuits sur des grimoires ou nous lancer dans de folles fêtes de fleurs ou de flamme; ces enchantements peuvent nous perdre ou nous sauver, peu importe, nous porter au-devant du monde sensible, dans les fracas, ou nous rassembler dans le silence d'une méditation mathématique, ils n'en demeurent pas moins la ressource commune à la tous les Romantiques allemands, leur irréfutable singularité, leur étrangeté dans un monde aussi désenchanté que le nôtre.
Nous sommes désormais si loin de tout enchantement que certains de nos intellectuels ont fait de l'enchantement l'ennemi par excellence: il facile de se faire un ennemi de qui ne règne plus ! Véritable arrière-garde, ces « intellectuels » (par antiphrase) persistent à batailler contre ce qui ne demeure plus qu'aux marges extrême de la vie. Dans ce monde planifié, rationalisé, médiatisé, dans ce technocosme surveillé, informatisé, où jamais la part du secret ne fut si rabougrie, ils voudraient encore nous persuader que l'enchantement est ce Mal à l'origine de tous les maux, ce germe du totalitarisme qu'il faut écraser avant qu'il ne s'éploie. Le désenchantement, la démystification, la déconstruction sont leurs grandes affaires, tout ce qui est numineux ou sacré est leur adversaire, comme si la grande « ruée vers le bas » et vers l'horreur n'était pas le démocratique produit du nihilisme et de l'hybris de la volonté, de la raison idolâtrée, planificatrice. Comme si de ne s'émerveiller de rien et de dénigrer toute chose, les hommes s'en trouvaient être meilleurs !

C'est méconnaître que l'enchantement est d'abord ce qui nous dénoue, ce qui nous surprend, ce qui sollicite notre hospitalité. C'est ne pas voir que l'enchantement est une « approche », ou, plus exactement, cette émotion qui survient au moment de l'approche, - à cette seconde magique où nous nous délivrons de nous-mêmes, de notre narcissisme individuel ou collectif, pour recevoir du monde un signe de bienvenue.
Voir dans l'enchantement un Mal est un étrange désespoir et ce désespoir mélangé d'optimisme historique ne laisse pas d'être inquiétant. Les Romantiques allemands pressentirent ce monde déserté des Anges et des Dieux, ce monde sans messagers, où plus rien n'advient de l'autre côté des apparences. Mais si plus rien ne doit advenir, alors les apparences ne sont plus des apparences, mais des murs de néant. D'où l’élan romantique vers les prodiges, qui sont en nous tout autant que dans le monde: « Il est étrange, écrit Novalis que l'homme intérieur n'ait été considéré que d'une manière si misérable et qu'on en ait traité que si stupidement. La soi-disant psychologie est aussi une de ces larves qui ont usurpé dans le sanctuaire la place réservée aux images véritables des dieux... Qui sait quelles unions merveilleuses, quelles générations étonnantes sont encore renfermées en nous-mêmes ? »
L'entendement humain apparaît aux Romantiques allemands comme un instrument prodigieux et méconnu, un stradivarius dont on se servirait comme d'un tambourin avant de le laisser brisé et à l'abandon. Refuser l'enchantement, c'est ainsi refuser non seulement le poème, le chant des sirènes, mais la spéculation elle-même, l'Intellect dans ses plus hautes œuvres. Il y a, certes, un danger dans le chant, comme dans la pensée, on peut s'y perdre mais ce danger est le propre de l'humain et sans doute n'est-il point si grand que le danger que recèle, pour la beauté de la vie, le culte bourgeois de la sécurité à tout prix.
Par ailleurs, l'enchantement romantique est fort loin de sa caricature. Il n'est point cet abandon aux forces de la vie et de la nature, ce panthéisme primaire, cette passivité végétale ou infrahumaine, ce culte de la Magna Mater ou ce fondamentalisme écologique que ses adversaires dépeignent avec complaisance : « Bien des gens, écrit Novalis, s'attachent à la nature, parce que, comme des enfants gâtés, ils craignent leur père et cherchent un refuge auprès de leur mère ». S'il importe d'apprendre à manier la baguette magique de l'analogie, ce n'est pas au détriment de la déduction, mais en contraste avec elle, sachant que « les contrastes sont des analogies inversées ». Ainsi, « la vie des dieux est mathématique » mais « c'est en l'humain que se manifeste l'empire des cieux ».
Pour le Romantique, la science chante comme les nombres et rien n'est véritablement abstrait. « Chaque descente du regard en soi-même est, en même temps, une ascension, une assomption, un regard vers l'extérieur véritable ». L'enchantement est ce point, cette frontière incertaine où le monde intérieur et le monde extérieur se rencontrent. Nous pouvons choisir de lutter contre le monde, de le prendre à bras le corps, de le défier, mais, en dernière instance, cette joute est nuptiale. Entre l'élan prométhéen et la sagesse d'Hermès, il est un accord possible, que Novalis, avec génie, résume en une seule phrase: « Nous ne nous comprendrons jamais entièrement; mais nous ferons et nous pouvons bien plus que nous comprendre ».
Luc-Olivier d'Algange
00:40 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, romantisme, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, luc-olivier d'algange |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 31 octobre 2020
Le Songe impérial de Dominique de Roux

Luc-Olivier d’Algange:
Le Songe impérial de Dominique de Roux
« L’existence, c’est quand l’être envoie en exil une expérience particulière de lui-même, qui devient alors souvenir, mémoire, volonté ou désir de retour, sinon revenir. Exister, c’est donc être en exil par rapport à l’être, s’en souvenir et tout sacrifier au retour, ressusciter les choses mortes. Reconquête de tout un art, d’un esprit de renaissance. »
Dominique de Roux
La portée poétique et métaphysique d’une œuvre tend à demeurer méconnue de ceux qui n’en retiennent que la figure humaine qu’elle dessine et le génie du style, en oubliant ce dont il est question, l’action que le Songe précipite comme une matière ardente dans ces conditions nécessaires que sont un destin d’homme et un art d’écrire. Il existerait ainsi, dans une zone antérieure à l’œuvre, comme le sceau d’une empreinte invisible. Qu’en est-il du sceau de l’œuvre de Dominique de Roux ? Quelle est sa mise-en-demeure ? De quelle nature, ouranienne, héliaque, impériale, est l’invisible dans ce que nous voyons d’elle, de ces images qu’elle fait apparaître ? Qu’en est-il des mythes et des Symboles ? Quelle attente ardente brûle dans ces phrases ? Et pour qui ? Une œuvre, et surtout une œuvre laissée en suspens, n’est-elle pas une courbe qui débute avant la page écrite et s’achève après elle ? Faute de se poser ces questions, la littérature des littérateurs, ou des idéologues, ce qui revient au même, nous rattrape, et nous en sommes réduits à juger et à jauger l’œuvre selon des normes sommaires, stéréotypées, grégaires.
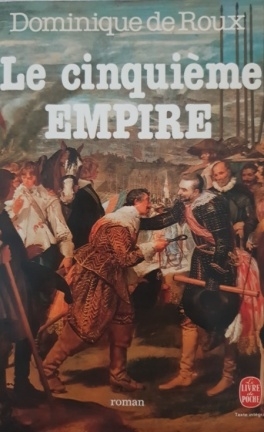 L’œuvre de Dominique de Roux témoigne d’une stratégie de rupture, mais rupture pour retrouver la plénitude de l’être, à laquelle, selon la théologie apophatique, « tout ce qui s’ajoute retranche ». Il faut donc rompre là, s’arracher avec une ruse animale non moins qu’avec l’art de la guerre (et l’on sait l’intérêt tout particulier que Dominique de Roux porta à Sun Tsu et à Clausewitz) pour échapper à ce qui caractérise abusivement, à ce qui détermine, et semble ajouter à ce que nous sommes, alors que la plénitude est déjà là, dans « l’être-là », dans l’existant pur, lorsque celui-ci, par une succession d’épreuves initiatiques, de ressouvenirs orphiques, de victoires sur les hypnoses léthéennes, devient le témoin de l’être et l’hôte du Sacré.
L’œuvre de Dominique de Roux témoigne d’une stratégie de rupture, mais rupture pour retrouver la plénitude de l’être, à laquelle, selon la théologie apophatique, « tout ce qui s’ajoute retranche ». Il faut donc rompre là, s’arracher avec une ruse animale non moins qu’avec l’art de la guerre (et l’on sait l’intérêt tout particulier que Dominique de Roux porta à Sun Tsu et à Clausewitz) pour échapper à ce qui caractérise abusivement, à ce qui détermine, et semble ajouter à ce que nous sommes, alors que la plénitude est déjà là, dans « l’être-là », dans l’existant pur, lorsque celui-ci, par une succession d’épreuves initiatiques, de ressouvenirs orphiques, de victoires sur les hypnoses léthéennes, devient le témoin de l’être et l’hôte du Sacré.
La radicalité de Dominique de Roux, ses provocations de Moderne anti-moderne, ne s’expliquent pas autrement : il faut aller au cœur de l’être, résolument, encourir le blâme pour s’établir souverainement dans ce qui nous appartient de toute éternité, s’y établir pour en devenir l’hôte et ne point laisser prise à ce qui, par l’usage quotidien, nous dépossède de sa claire vérité. N’hésitons point alors à encourir le reproche que certains firent à Dominique de Roux : de parler de lui-même en parlant des autres, - reproche mal fondé au demeurant car à parler de ce qu’une œuvre met en mouvement, de ce qu’elle suscite, à s’éloigner du texte et de la biographie, de la linguistique et de la psychologie, ou encore de l’idéologie, qui furent longtemps les seules grilles d’interprétation des critiques ( mais que voir et que vivre derrière des grilles ?), à s’évader de la fausse objectivité où s’exacerbe jusqu’à l’hybris la vanité du savoir, c’est bien une humilité que nous retrouvons, celle de laisser l’œuvre agir sur nous, d’en recevoir, pour nous-mêmes, ce qu’elle veut nous donner, de la lire comme si elle n’avait été écrite que pour nous, de suivre les pistes qu’elle nous indique au lieu, du haut de notre science, de la vouloir démonter, déconstruire, expliquer, comme si nous savions mieux que l’auteur ce dont il s’agit !
Longtemps Dominique de Roux fut notre aîné ; et voici, depuis quelques années, qu'il est notre cadet, qu'il nous devance déjà et encore de sa juvénilité, nous rappelle aux audaces essentielles, nous invite à découvrir et à défendre d'autres oeuvres que la nôtre et nous délivre, par cela même, de la mécanique odieuse de la subjectivité, de cet enfermement dans le « moi », autrement dit, de la « psychologie des larves » dont parlait Novalis, pour solliciter en nous ce songe de grandeur, cette nostalgie impériale qui veut le monde plus grand que ce que nous en pouvons penser. Nous gardons le souvenir des découvertes, des « missions de reconnaissance », où il nous précéda, de l’aventure prodigieuse des Cahiers de l’Herne, de son ultime revue Exil, où nous retrouvions tout ce qui, ces dernières années, nous avait requis, d'une requête tout autant métaphysique que littéraire, Pessoa, Julius Evola, Valery Larbaud, Knut Hamsun, Céline, Raymond Abellio, Gombrowicz, et parmi les contemporains, Jean Parvulesco, André Coyné, Matthieu Messagier, Patrice Covo… Les poètes et leurs intercesseurs, les aventuriers du Logos, les « calenders », selon le mot de Gobineau, les Exilés, car depuis que le monde se montre tel que nous le connaissons, les Fils de Roi sont toujours en exil. Qu’en est-il de l'exil, non point dans l'ailleurs mais dans l'ici-même ? Qu'en est-il de l'exil ontologique, et non point circonstanciel ou historique ? (1)
 L'exil, dans un monde déserté de l'être, dans un monde de vide et de vent, où toute présence réelle est démise par sa représentation dans une sorte de platonisme inversé, est notre plus profond enracinement. Et ce plus profond enracinement est ce qui nous projette, nous emporte au voisinage des prophéties. « Etre aristocrate, que voulez-vous, c’est ne jamais avoir coupé les ponts avec ailleurs, avec autre chose ». Cette fidélité aristocratique, qui scelle le secret de l’exil ontologique, autrement dit, de l’exil de l’être en lui-même, dans le cœur et dans l’âme de quelques uns, est au plus loin de la seule révérence au passé, aux coutumes d’une identité vouée aux processions funéraires : « Je ne me dédouble pas je cherche à multiplier l’existence, toujours dans le flot des fluctuations, vérités et mensonges qui existent, qui n’existent pas, au bord du langage. »
L'exil, dans un monde déserté de l'être, dans un monde de vide et de vent, où toute présence réelle est démise par sa représentation dans une sorte de platonisme inversé, est notre plus profond enracinement. Et ce plus profond enracinement est ce qui nous projette, nous emporte au voisinage des prophéties. « Etre aristocrate, que voulez-vous, c’est ne jamais avoir coupé les ponts avec ailleurs, avec autre chose ». Cette fidélité aristocratique, qui scelle le secret de l’exil ontologique, autrement dit, de l’exil de l’être en lui-même, dans le cœur et dans l’âme de quelques uns, est au plus loin de la seule révérence au passé, aux coutumes d’une identité vouée aux processions funéraires : « Je ne me dédouble pas je cherche à multiplier l’existence, toujours dans le flot des fluctuations, vérités et mensonges qui existent, qui n’existent pas, au bord du langage. »
L’héritage, alors, n’est plus un poids, un carcan de convenances mais un recours, une puissance à celui qui sait de par ses choix « être toujours et partout en territoire ennemi ». Etre en exil, c’est-à-dire au plus proche de l’être, au bord du langage, c’est être offert, comme en sacrifice, à la possibilité d’inventer une écriture dont le tracé, de crêtes en crêtes, d’énigmes en clartés, ravive le pouvoir de « protéger le ciel le plus haut, autrement dit, sa tradition ». Rien de moins conservateur, toutefois, que cette sauvegarde de sa tradition ; nul repli, fût-il stratégique, sur des positions obsolètes. Aux guerres frontales, qui, de notre côté, ne peuvent qu’être perdues, Dominique de Roux préfère les guérillas nuancées de logique taoïste, d’un « ethos » à la Sun Tsu qui feront de cet « anti-moderne » une figure décisive de l’ultra modernité, -autrement dit de la modernité au sens rimbaldien : celle de « l’étincelle d’or », de la fulgurance imprévisible. D’où l’importance de se garder d’être « inébranlable dans ses concepts, catégorique dans ses déclarations, clair dans ses idéologies, féru dans ses goûts, responsable dans ses dires et dans ses actes, précis et cristallisé dans ses manières d’être.»
Seuls pourront, en territoire ennemi, prolonger ce qui doit l’être, « le plus haut ciel », ceux qui refusent d’endosser un rôle, de se revêtir de la livrée ou de l’uniforme, de simplifier ou de schématiser leurs pensées ou leurs croyances à toutes fins utiles. Ce qui importe n’est point la doxa mais la gnosis, non point la représentation mais la présence réelle, non point l’eau croupie de la citerne mais l’eau vive, non point les mots mais la parole : « Le présent, donc, le passé ainsi que l’avenir d’une littérature qui est celle dont nous assumons les destinées sont chacun pris à part et tous ensemble, le temps d’un seul et même combat. Le combat de la parole contre les mots, du pouvoir d’intégration contre les puissances de la désintégration, et c’est là le mystère ultime de la parole d’Orphée déchiré par les chiens d’Hécate que sont les mots laissés à eux-mêmes ».
Loin d’être soumission aux prestiges fallacieux de la lettre, à la fascination des « signifiants » et à leurs structures immanentes, l’écriture de Dominique de Roux, au sens où lui-même parlait de l’écriture du Général de Gaulle, ressaisit dans un même combat le passé, le présent et le futur, la nostalgie orphique et le pressentiment sébastianiste, ressaisit, ou plus exactement refonde, la fondation étant aussi fusion dans le creuset alchimique de l’existence voulue comme expression de l’être, le Sens lui-même, le fluidifiant, lui restituant ses impondérables, ses fugacités tremblantes, ses chromatismes insaisissables qui sont le propre de la parole, c’est-à-dire du Logos lorsque de celui-ci ne se sont pas encore emparés les idolâtres et les abstracteurs.
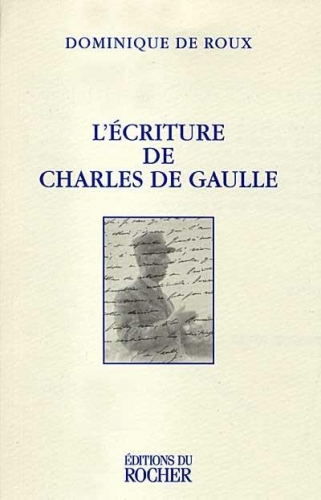 Ecrire sera ainsi pour Dominique de Roux cette action subversive, « ultra-moderne » qui consiste à retourner à l’intérieur des mots la parole contre les mots, à subvertir, donc, l’exotérique par l’ésotérique et à ne plus s’en laisser conter par ceux-là qui oublient que la parole humaine voyage entre les lèvres et les oreilles, comme sur les lignes ou entre les lignes, qu’elle voyage entre celui qui la formule et celui qui la reçoit, comme entre la vie et la mort, le visible et l’invisible : ce profond mystère qui se laisse sinon éclaircir, du moins comprendre, par la Théologie.
Ecrire sera ainsi pour Dominique de Roux cette action subversive, « ultra-moderne » qui consiste à retourner à l’intérieur des mots la parole contre les mots, à subvertir, donc, l’exotérique par l’ésotérique et à ne plus s’en laisser conter par ceux-là qui oublient que la parole humaine voyage entre les lèvres et les oreilles, comme sur les lignes ou entre les lignes, qu’elle voyage entre celui qui la formule et celui qui la reçoit, comme entre la vie et la mort, le visible et l’invisible : ce profond mystère qui se laisse sinon éclaircir, du moins comprendre, par la Théologie.
L’ardente polémique contre les diverses cuistreries plus ou moins universitaires qui prévalaient alors, loin de relever seulement d’une joyeuse humeur mousquetaire, se fondait, on ne le vit pas assez, sur une autre vision du langage et du monde, autrement dit de l’écriture comme « praxis » du haut et du profond, du lointain et de l’immédiat, destinée à lutter contre l’obscurcissement de l’être, contre cette banalité et cet ennui, toujours aux aguets, qui nous envahissent à la moindre inadvertance.
Dominique de Roux fut ainsi bien davantage que « le plus grand éditeur de l’après-guerre » selon la formule perfide de Jean-Edern Hallier qui dut avoir quelque difficulté à comprendre que l’on pouvait être un écrivain de grande race sans être exclusivement tourné vers soi-même. « Editeur », au demeurant, fût-ce « le plus grand » suffit mal à définir l’action de Dominique de Roux dans ce domaine pour autant que sa méthode, si méthode il y eut, fut d’abord de prolonger, de prouver par des actes, ses admirations. Editeur, Dominique de Roux le fut non par défaut mais par surcroît.
Par surcroît aussi, la politique, sujet litigieux. Disons simplement, avant d’en revenir à l’écriture, qu’il n’y a plus à discutailler de son prétendu « fascisme » dès lors que l’on sait que tout ce qui s’est opposé, s’oppose ou s’opposera au monde comme il va globalement a été, est, ou sera traité de « fasciste » par les adeptes de la loi du plus fort et qu’il n’y a pas de rébellion, de « contre-monde », fussent-ils purement contemplatifs, qu’il n’y a pas de métaphysique ou d’esthétique rétives au règne de l’argent et de la technique qui ne seront traités de « fascistes » par les défenseurs, pathétiquement dépourvus d’imagination, de l’ordre établi, comme naguère on réputait hérésiarques Maître Eckhart ou Giordano Bruno. Comme si le fascisme réel, le nazisme opérationnel ne furent pas aussi et d’abord de lourdes collusions entre l’esprit grégaire et les puissances de l’argent et de la technique !
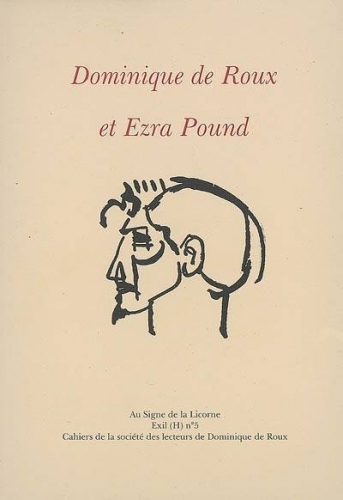 Des temps où il fut notre aîné, Dominique de Roux nous incita à donner forme à notre dessein. Devenu notre cadet, lorsque nous eûmes dépassé la frontière des quarante-deux ans, son œuvre nous fut cette mise-en-demeure à ne point céder, à garder au cœur la juvénile curiosité, à déchiffrer, dans son écriture aux crêtes téméraires, le sens d’une jeunesse qui, suspendue trop tôt dans l’absence, ne peut finir. Il y a une écriture de Dominique de Roux, un style, un usage de la langue française en révolte contre cette facilité à glisser, avec élégance, mais sans conséquence, sur la surface du monde. On s’exténue à condamner ou à défendre sa plume de « polémiste d’extrême-droite », alors que ce qui advient dans ces bouillonnements, ces ébréchures, ces anfractuosités n’est autre que la pure poésie.
Des temps où il fut notre aîné, Dominique de Roux nous incita à donner forme à notre dessein. Devenu notre cadet, lorsque nous eûmes dépassé la frontière des quarante-deux ans, son œuvre nous fut cette mise-en-demeure à ne point céder, à garder au cœur la juvénile curiosité, à déchiffrer, dans son écriture aux crêtes téméraires, le sens d’une jeunesse qui, suspendue trop tôt dans l’absence, ne peut finir. Il y a une écriture de Dominique de Roux, un style, un usage de la langue française en révolte contre cette facilité à glisser, avec élégance, mais sans conséquence, sur la surface du monde. On s’exténue à condamner ou à défendre sa plume de « polémiste d’extrême-droite », alors que ce qui advient dans ces bouillonnements, ces ébréchures, ces anfractuosités n’est autre que la pure poésie.
Sauver la poésie de ce qu’en font les poètes de laboratoire ou les poètes minimalistes ou illettrés, redonner la poésie à la prose et la prose à la poésie ( et je ne vois nul texte dit de « poésie » plus digne du beau nom de poème que La Maison jaune, texte inclassable, lapidaire et mystérieux) ; retrouver de la poésie un à un les pouvoirs, tel fut, semble-t-il le dessein de Dominique de Roux, - d’où l’absurdité de vouloir juger de ses œuvres selon les normes du genre romanesque ou de la prose française néoclassique.
La poésie est aussi présente à chaque page des romans et des essais que du journal et de la correspondance ( dont l’excellente biographie de Jean-Luc Barré nous livre maints extraits inédits) qu’elle est absente de la plupart des recueils de poèmes des « poètes » patentés par les satrapes du texte à lignes irrégulières qui officièrent alors dans la régulation des petits bouts de proses vantardes qui n’emportent rien sinon la pose de celui qui consent à ne rien dire, à ne rien évoquer, à s’en tenir rigoureusement en deçà du péril lyrique et liturgique du langage en cultivant de molles ambiguïtés par l’utilisation de métaphores discrètes, bien policées, insoupçonnables de moindres « accointances » avec le Sacré, avec le mythe ou avec le tragique, - autrement dit, avec la vérité orphique que l’enfer du décor où nous vivons nous dissimule alors qu’elle est, cette vérité, la seule à pouvoir dire en même temps notre destin et notre anti-destin, notre monde ( c’est-à-dire notre exil) et ce contre-monde qu’il nous faut ourdir en faveur de l’être et contre le néant.
C’est donc bien vers l’écriture de Dominique de Roux qu’il nous faudra nous tourner comme lui-même se tourna par un livre ardent vers l’écriture du Général de Gaulle : écriture des épicentres, non point cette écriture diurne, cette écriture de l’après-midi, coulée d’évidences en évidences au rythme du canotage mais bien une écriture nocturne, s’enroulant autour d’une métaphore solaire, mais d’un soleil en voie de création. D’abord l’Image, et ensuite les mots : « Ne servir que sa vision ». La rencontre éblouie avec d’autres œuvres, venues là comme des « confirmations », selon le mot de Philippe Barthelet, lui permettra précisément d’échapper au déjà formulé, au banal, au stéréotype et d’aller chercher l’impondérable entre l’œuvre et celui qui la reçoit : ce passage où le Verbe devient silence. L’espace de la passation des pouvoirs, la zone philosophale et « diplomatique » n’est pas le moi fictif, la subjectivité dont le triomphe nous réduit à l’état de mécanique, mais l’expérience métaphysique du Verbe. Ainsi la confrontation explicite avec d’autres œuvres, avec l’encre de sang d’autres « horribles travailleurs » devient fondatrice d’une vérité et d’une liberté essentielle.
 Rien n’importe que « la saison mystérieuse de l’âme». Toutes nos luttes, nos impatiences, et notre solitude conquise et notre exil, nos œuvres, qui ne sont ni des victoires ni des défaites, tout cela, non seulement au bout du compte, mais dès le départ ne vaut que pour ces retrouvailles légères : « Je viendrai en janvier. Je viendrai longtemps. Vous me parlerez encore des jardins et des hommes… dans cette petite salle blanche du monastère qui sent la pomme et le grain, sur cette colline de silence et de beauté, parmi les pluies qui tressent tout autour une saison mystérieuse. Je vous écouterai. Vous calmerez ma foi clignotante comme une étoile. J’enserrerai votre trésor comme un écureuil entre mes mains. »
Rien n’importe que « la saison mystérieuse de l’âme». Toutes nos luttes, nos impatiences, et notre solitude conquise et notre exil, nos œuvres, qui ne sont ni des victoires ni des défaites, tout cela, non seulement au bout du compte, mais dès le départ ne vaut que pour ces retrouvailles légères : « Je viendrai en janvier. Je viendrai longtemps. Vous me parlerez encore des jardins et des hommes… dans cette petite salle blanche du monastère qui sent la pomme et le grain, sur cette colline de silence et de beauté, parmi les pluies qui tressent tout autour une saison mystérieuse. Je vous écouterai. Vous calmerez ma foi clignotante comme une étoile. J’enserrerai votre trésor comme un écureuil entre mes mains. »
Dominique de Roux ne fut ni « fasciste » ni « réactionnaire » comme le disent les imbéciles mais anti-moderne (ce qui est tout autre chose et peut-être le contraire) ; et anti-moderne, il faut bien reconnaître qu’il y a de bonnes rasions de l’être pour peu que l’on soit sensible à l’âme des êtres et des choses, à leurs « saisons mystérieuses ». Substituant le confort à la beauté, la prédation à l’héroïsme, le pouvoir de l’argent (qui rend également esclaves les dominants et les dominés) aux jeux divers de la puissance et de la gloire, le monde moderne est cette lèpre, cet enlaidissement général de tout par tous les moyens, y compris ceux de la morale déchue en « moraline », pour reprendre le mot de Nietzsche.
Antimoderne en morale, c’est-à-dire ultra-moderne pour ce qui est de l’inventivité littéraire, penseur paradoxal, c’est-à-dire littéralement en marge de la doxa, de la croyance commune de son temps, aimant le heurt des contradictions, Dominique de Roux fut, à sa façon, le parfait représentant de sa lignée alors que d’autres, qui ne sont point idiots, le voient en rebelle à toute convenance héritée. Or, s’il fut l’un et l’autre, fidèle et rebelle, ce ne fut pas même alternativement mais en même temps, c’est-à-dire dans l’éternité qui, pour éternelle qu’elle soit, ne nous est donnée que par brusques échappées, semblables à ces rafales qui, dans leurs embruns, nous étourdissent.
Dominique de Roux fut cet aristocrate anti-moderne, ce fidèle, ce chevalier, dans le geste même qui affirme la liberté absolue : « Un nouvel équilibre est à conquérir dans la fièvre » ou encore : « Il faut rester des hommes libres… Jamais je ne me laisserai prendre dans ma vie à quelque parti que ce soit, droite gauche centre vert bleu hormis celui de l’amitié, de la violence de l’amitié, ses traits bien fermes, ses grandes passes d’ombre, ses vivacités nerveuses, ses inconnues, ses droits. »
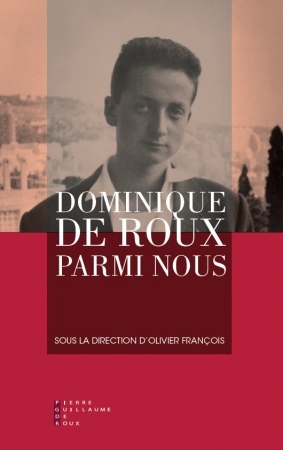 A l’exigence morale qui consiste à ne pas être là où les autres vous attendent correspondra une écriture aux incidentes imprévisibles où les mots inattendus, dans leurs explosions fixes, captent les éclats du pur instant : « Par rapport à l’écriture, ni loi, ni science, pas même une destinée ». L’héritage comme force motrice, élan donné, s’oppose à la destinée, forme consentie de la soumission. Du peu de liberté qui nous reste, l’anti-moderne ultra-moderne veut étendre le champ d’action et les prestiges secrets pour aller vers la réalité, tracé de lumière entre deux ténèbres : « Retrouver la réalité, aller vers le réel, l’élémentaire, vers la mort prévue de l’homme et vers l’homme secret qui vit encore, vers sa réapparition dans la forme nouvelle, dans l’éternelle jeunesse de l’antiforme éternelle ».
A l’exigence morale qui consiste à ne pas être là où les autres vous attendent correspondra une écriture aux incidentes imprévisibles où les mots inattendus, dans leurs explosions fixes, captent les éclats du pur instant : « Par rapport à l’écriture, ni loi, ni science, pas même une destinée ». L’héritage comme force motrice, élan donné, s’oppose à la destinée, forme consentie de la soumission. Du peu de liberté qui nous reste, l’anti-moderne ultra-moderne veut étendre le champ d’action et les prestiges secrets pour aller vers la réalité, tracé de lumière entre deux ténèbres : « Retrouver la réalité, aller vers le réel, l’élémentaire, vers la mort prévue de l’homme et vers l’homme secret qui vit encore, vers sa réapparition dans la forme nouvelle, dans l’éternelle jeunesse de l’antiforme éternelle ».
S’il faut « jeter par-dessus bord les totems et les tabous de la tribu », c’est-à-dire devenir, selon la formule d’Al-Hallâj « un Unique pour un Unique », s’il faut, en même temps, accompagner « la longue marche de l’Occident à son propre être, au-delà du déclin », ce ne saurait être sans le dévoilement de l’écriture par elle-même, où plus exactement, sans le voilement de l’écriture par l’Ecriture qui accomplit à travers elle cette « intelligence prophétique de l’Histoire » cette « expérience du salut, secrète, existentielle » que Dominique de Roux évoquait à propos du Général de Gaulle.
Ecrire, alors, ce n’est plus s’évertuer, dans le néant du sens, à composer un « texte », lui-même destiné aux thanatopracteurs virtuels, universitaires ou journalistes, mais laisser œuvrer en soi la « vague d’assaut », l’action théurgique, d’un « certain retour à la vie ». Ces vagues, toutefois, ne sont pas un vain tumulte mais orbes venues d’une immobilité centrale, d’un cœur de calme infini, là où règnent « les Forts, les Sereins, les Légers » de L’Etoile de l’Alliance, évoquée par Stefan George. « Maintenant, les cercles sont plus lents et plus hauts, c’est le temps de l’exil, de l’écriture ». Le sens de la tradition, de la fidélité à l’appartenance se révèlent dans la distance et dans la solitude. L’écrivain doit être séparé du monde « pour qu’il lui faille l’imaginer à nouveau et l’aimer autrement, l’unifier et en éclairer toutes les causes, le pénétrer, le vaincre intérieurement, le régénérer. »
Pour témoigner du monde, il faut le porter en soi, et pour le porter en soi, il faut s’en détacher. La politique et l’écriture dévoilante sont à équidistance de ce détachement qui permet de « transcender abruptement l’actualité immédiate, de nouer avec le passé le fil rompu, d’appliquer un De Monarchia. » Point de retour à Ithaque sans l’arrachement, le déracinement, sans l’exil dans le vent et la mer qui nous revêt de « la livrée majeure de l’Esprit ».
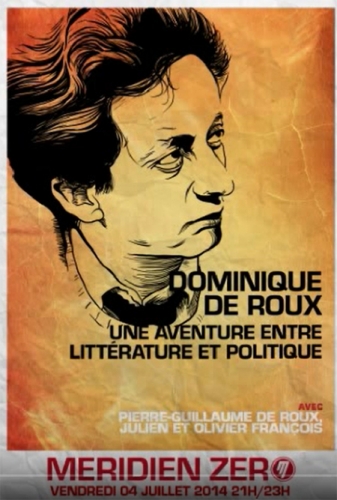 « L’exil n’est pas une autre demeure. Il est séparation d’avec notre demeure. L’exil s’accompagne de la volonté de retour. C’est le visage dans les mains de l’homme séparé de lui-même (…) Et si la grande poésie arrache au monde, le développement de l’exil ne concerne pas seulement l’expérience de celui qui le vit, il abandonne les organisations têtes baissées vers la flamme et commence une vie nouvelle, cherchant la passe. »
« L’exil n’est pas une autre demeure. Il est séparation d’avec notre demeure. L’exil s’accompagne de la volonté de retour. C’est le visage dans les mains de l’homme séparé de lui-même (…) Et si la grande poésie arrache au monde, le développement de l’exil ne concerne pas seulement l’expérience de celui qui le vit, il abandonne les organisations têtes baissées vers la flamme et commence une vie nouvelle, cherchant la passe. »
Cette « passe », impériale et portugaise, passe vers l’écriture à travers la politique et non subordination de l’une à l’autre, comme il en advient aux écrivains dits « engagés ». Loin d’être ce retour contrit à l’Histoire et au collectif des clercs hantés par la conscience malheureuse ou mauvaise, l’engagement de Dominique de Roux se trouve être exactement contemporain de son plus radical désengagement, de sa perception d’un au-delà de l’Histoire, véritable et seul objet de l’enquête : « Le Portugal, parce qu’il croit aux réalités finales a compris, quand le reste de l’Afrique est livré au désordre, que dans le continent noir il ne fallait pas seulement avancer en espace mais aussi en esprit (…). Quand l’histoire européenne est pleine de peuples morts ou moralement détruits par le temps, le Portugal, refusant d’échapper au temps humain, qui est aussi une manière d’échapper aux exigences de la réalité, fait coexister dans son espace planétaire, une réalité humaine universellement pensée et prétendant agir sur l’Histoire ».
Ne pas échapper au temps mais le transmuter de l’intérieur, tel sera le propre du Cinquième Empire que Dominique de Roux entrevoit. C’est aussi toute la différence entre la Révolution et la contre-révolution qui veulent échapper au temps en le niant, en refusant le palimpseste du réel et ce « contraire de la révolution » qu’évoquait Joseph de Maistre qui vainc le temps en opérant à sa transmutation alchimique, providentielle. L’écriture de Dominique de Roux accompagne et souvent précède ces étapes successives, ou ces stations de la conscience où la conscience individuelle devient le miroir ardent de la conscience du monde. A la globalisation uniformisatrice, Dominique de Roux n’oppose pas ces vieilleries du modernisme que sont le nationalisme, le racisme, le pétainisme mais une autre universalité qui est celle du palimpseste, de la mémoire libérée de ses propres représentations, de la mémoire rendue à sa matière fusible, chatoyante et dispersée.
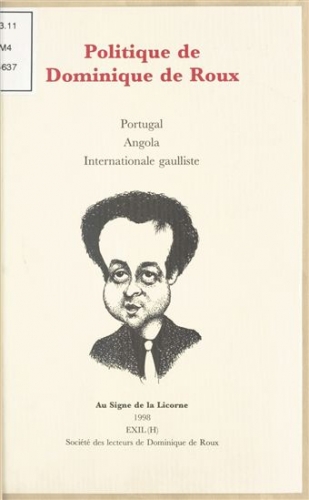 Le révolutionnaire comme le contre-révolutionnaire sont des nihilistes : ils nient la mémoire réelle, ils veulent, dans l’hybris de leur volonté, conformer le monde à leurs plans : hybris de ménagère et non de conquérant. Il faut défendre sa vision du monde ; mais telle est la limite du colonialisme, il convient que les mondes conquis, et même le monde natal, nous demeurent quelque peu étrangers. Cette étrangeté discrète et persistante est la condition universelle de l’homme que les planificateurs modernes ont en horreur et dont ils veulent à tout prix départir les êtres et les choses au nom d’un « universalisme » qui n’est rien d’autre que la plus odieuse des hégémonies, la soumission des temporalités subtiles de l’âme au temps utilitaire, au faux destin de l’Histoire idolâtrée, à l’optimisme stupide, au nihilisme béat.
Le révolutionnaire comme le contre-révolutionnaire sont des nihilistes : ils nient la mémoire réelle, ils veulent, dans l’hybris de leur volonté, conformer le monde à leurs plans : hybris de ménagère et non de conquérant. Il faut défendre sa vision du monde ; mais telle est la limite du colonialisme, il convient que les mondes conquis, et même le monde natal, nous demeurent quelque peu étrangers. Cette étrangeté discrète et persistante est la condition universelle de l’homme que les planificateurs modernes ont en horreur et dont ils veulent à tout prix départir les êtres et les choses au nom d’un « universalisme » qui n’est rien d’autre que la plus odieuse des hégémonies, la soumission des temporalités subtiles de l’âme au temps utilitaire, au faux destin de l’Histoire idolâtrée, à l’optimisme stupide, au nihilisme béat.
Le « code secret du fado », la saudade qui « projette les êtres et les choses hors du temps », sera pour Dominique de Roux le signe du retour, l’aperception directe, en mode visionnaire, d’un horizon paraclétique où s’opèrent les noces de l’eau mercurielle et du feu apollinien, de la nostalgie et du pressentiment : « Le Cinquième Empire ? L’Empire de la Fin d’après la fin, quand toutes les choses humaines auront été consommées (consumées) et ce qui apparaîtra de l’homme alors, ce sera ce que l’homme aura passé l’histoire entière à gommer, et qui lui reviendra : sa ressemblance. »
Que l’homme soit enfin, et au-delà de toute fin, à sa propre ressemblance comme à la ressemblance de son empire infime et infini sur les êtres et les choses, que notre solitude soit enfin signe et condition de cette amitié divine qu’évoquent Maître Eckhart et Rûmî, qu’une ombre jetée, qui est pure transparence, « antiforme éternelle », entre le monde et nous advienne pour nous réconcilier, l’écriture de Dominique de Roux nous en persuade d’autant mieux qu’elle devance, par un Songe (creuset de la réalité) toute démonstration et toutes arguties : ainsi à la pointe du Songe comme à la pointe du Calame, l’écriture de l’Empire « universel, missionné pour l’éternité » sera désormais « comme fondu dans l’immensité océanique de son rêve, non point âge de conquérants ou de bâtisseurs, mais de découvreurs, de messagers, de navigateurs sans fin tenant leur raison d’être et leur force de cette absence de fin. »
Le Cinquième Empire appartient au passé autant qu’à l’avenir et quand bien même son attente semble déçue, il appartient encore au présent, à cette « lumière qui persiste identique à elle-même derrière le film » pour reprendre la formule de Nisargadata Maharaj. L’une des énigmes du Cinquième Empire se trouve paradoxalement chez Gombrowicz dont le parti pris anti-idéologique, le mépris de toute forme collective, l’aristocratisme libertaire sont précisément les plus profondes raisons d’être. C’ est que l’Empire, pour Dominique de Roux, loin d’être un super-état (c’est-à-dire, pour paraphraser Nietzsche, le plus grand des plus froids des monstres froids) serait au contraire, s’il advenait, un espace géopolitique et spirituel d’une « rejuvénation » du monde, d’un retour à cette enfance, à cette adolescence, d’avant les systèmes, à cet Eros premier, cette humeur turquoise, qui précède les adultérations, le sérieux utilitaire, l’esprit « homaisien », le puritanisme, auquel les intellectuels échappent si rarement quand bien même ils se veulent parangons de la « transgression » et de la « dérision » .
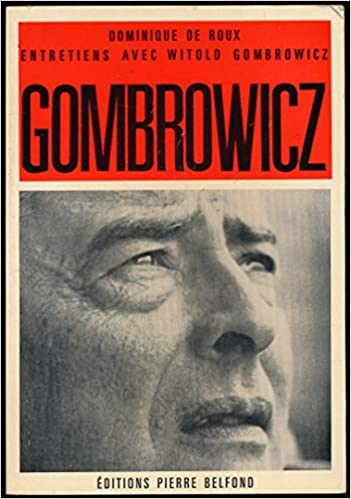 Que ce monde soit triste, torve, rancuneux et qu’il nous apparaisse tel sans que nous en eussions connu un autre suffit à convaincre qu’il n’est qu’un leurre, un mauvais rêve, un brouillard qui laisse deviner, derrière lui, une vérité éclatante mais encore plus ou moins informulée. Dominique de Roux fut exactement le contraire d’un nihiliste ; loin de nous ressasser que tout a déjà été dit, il nous donne à penser que presque tout reste à dire et même à créer : ainsi le Cinquième Empire dont la venue a pour condition le retour du Roi, un soir de brume sur le Tage ou le Nouveau Règne paraclétique de Stefan George ou encore l’Imam caché du prophétisme ismaélien.
Que ce monde soit triste, torve, rancuneux et qu’il nous apparaisse tel sans que nous en eussions connu un autre suffit à convaincre qu’il n’est qu’un leurre, un mauvais rêve, un brouillard qui laisse deviner, derrière lui, une vérité éclatante mais encore plus ou moins informulée. Dominique de Roux fut exactement le contraire d’un nihiliste ; loin de nous ressasser que tout a déjà été dit, il nous donne à penser que presque tout reste à dire et même à créer : ainsi le Cinquième Empire dont la venue a pour condition le retour du Roi, un soir de brume sur le Tage ou le Nouveau Règne paraclétique de Stefan George ou encore l’Imam caché du prophétisme ismaélien.
L’attente paraclétique n’est pas le contraire de l’action, quand bien même elle subordonne l’action à la contemplation, l’action n’ayant pour raison d’être que de favoriser les conditions de la contemplation. Cette attente est une « écriture du monde », et cette écriture est un renouvellement, une « rejuvénation poétique », celle là même que Dominique de Roux chercha chez les poètes de la Beat Génération ou chez les Electriques. De même que pour Sohravardî la prophétie n’était point scellée, que d’autres prophètes pouvaient survenir, croyance qui lui coûta la vie, Dominique de Roux crut en une poésie future, une poésie autre, non encore advenue, celle des « langues de feu » de la Pentecôte, du Paraclet annonçant l’Imperium Amoris, ou celle encore de la « foudre d’Apollon » qui frappa Hölderlin. D’où l’incertitude où nous sommes de savoir si sa vue-du-monde est païenne ou prophétique, inspirée par quelque gnose orphique ou empédocléenne ou inscrite dans l’œcuménisme des racines, des branches, des fleurs et des parfums de la tradition abrahamique.
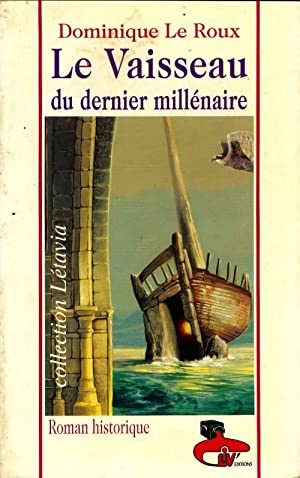 Si le Paraclet est avenir, s’il est l’eschaton de notre destin, la foudre d’Apollon, elle, est déjà tombée, mais elle est aussi mystérieusement en chemin vers nous, comme voilée, encore insue. De son ultime chantre, ou victime, Hölderlin, qui incarne pour Dominique de Roux « la poésie absolue », il nous reste encore à déchiffrer les traces, ces « jours de fêtes » dans l’éclaircie de l’être, ces silhouettes à la fois augurales et nostalgiques sur les bords précis de la Garonne, dans la lumière d’or de Bordeaux, cet exil en forme de talvera de la patrie perdue et infiniment retrouvée.
Si le Paraclet est avenir, s’il est l’eschaton de notre destin, la foudre d’Apollon, elle, est déjà tombée, mais elle est aussi mystérieusement en chemin vers nous, comme voilée, encore insue. De son ultime chantre, ou victime, Hölderlin, qui incarne pour Dominique de Roux « la poésie absolue », il nous reste encore à déchiffrer les traces, ces « jours de fêtes » dans l’éclaircie de l’être, ces silhouettes à la fois augurales et nostalgiques sur les bords précis de la Garonne, dans la lumière d’or de Bordeaux, cet exil en forme de talvera de la patrie perdue et infiniment retrouvée.
« Tout recommence » écrit Dominique de Roux et ce recommencement contient en lui l’admirable paradoxe de la coexistence du révolu et du prophétique, dépassant ainsi dans une torrentueuse assomption, l’opposition, somme toute subalterne, de l’anti-modernité et de l’ultra-modernité que nous évoquions plus haut. Le propre du Songe impérial est non seulement d’arracher le politique au despotisme de la société individualiste ou communautariste, de retrouver la dimension historiale et légendaire du destin commun des peuples, des races, des nations, mais aussi, et par cela même, de sauver, en même temps, la fidélité hölderlinienne aux dieux antérieurs et le frémissement annonciateur du Nouveau Règne. La société, dès lors qu’elle est livrée à la goujaterie, à la crétinisation de masse ne saurait en aucune façon trouver en elle-même les ressources du recommencement. Condamnée à l’infantilisme cacochyme, elle laisse jouer, en une apparence de liberté, une alternative emprisonnée dans la conjoncture profane, apoétique, soumise aux aléas des coutumes dévastées. Ces « communautés » que l’on veut opposer à l’individualisme, prises dans le plan général (et donc dépourvue de volume) sont à l’intérieur de la société, comme une âme qui serait emprisonnée dans un corps, comme dans un cachot dont, sauf un gardien muet, tout le monde a oublié l’existence. L’Empire que rêve Dominique de Roux suppose un radical renversement herméneutique : comprendre soudain que ce n’est point l’âme qui gît dans le corps mais le corps qui est dans l’âme, qui est environné d’âme, qui voyage dans l’âme.
A ce point de recouvrance, l’intériorité et l’extériorité ne se distinguent plus et le temps n’est plus de distinguer l’individu du collectif, le subjectif de l’objectif, une autre logique apparaît où nous nous apercevons soudain que la clef de notre destin est un « mantra » en accord avec la poésie du monde. Le Cinquième Empire, comme le nouveau règne de Stefan George, comme l’état confucéen rêvé par Ezra Pound, comme la « république » impériale de Valery Larbaud apparurent à Dominique de Roux comme autant de chances offertes à un contre-impérialisme – étant entendu que seule une idée d’Empire, idée au sens platonicien de « forme formatrice » suscitée par l’anamnésis (le ressouvenir d’Hésiode à Hölderlin, en vagues d’or…) disposera de la puissance en songe et en acte de frapper d’inconsistance l’impérialisme brutal, fiduciaire et puritain.

00:20 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : dominique de roux, hommage, luc-olivier d'algange, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 octobre 2020
Hommage à Henry Corbin - Clavis hermeneutica

Hommage à Henry Corbin
Clavis hermeneutica
par Luc-Olivier d'Algange
La philosophie est cheminement, ou plus exactement, comme le disait Heidegger, « acheminement vers la parole ». Ce qui est dit porte en soi un long parcours, une pérégrination, à la fois historique et spirituelle. Avant de parvenir à l'oreille de celui à qui elle s'adresse, la parole humaine accomplit un voyage qui la conduit des sources du Logos jusqu'à l'entendement humain. Ce voyage, à maints égards, ressemble à une Odyssée. Dans l'éclaircie de la présence de la chose dite frémissent des clartés immémoriales, des songes et des visions. Toute spéculation philosophique témoigne, en son miroitement étymologique, d'une vision qui n'appartient ni entièrement au monde sensible, ni entièrement au monde intelligible, mais participe de l'un et de l'autre en les unissant, selon la formule de Platon, « par des gradations infinies ». L’idée est à la fois la « chose vue », l’Idea au sens grec, la forme, et la « cause » qui nous donne à voir. De même que la parole ne se situe ni exactement dans la bouche de celui qui parle ni exactement dans l'oreille de celui qui entend, mais entre eux, le monde imaginal, qui sera au principe de l'herméneutique corbinienne, se situe entre l'Intelligible et le sensible, donnant ainsi accès à la fois à l'un et à l'autre et favorisant ainsi l'étude historique la mieux étayée non moins que l'interprétation spirituelle la plus précise.
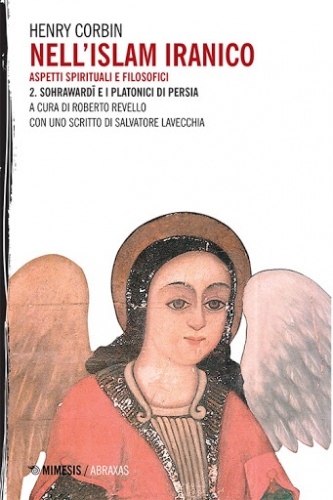 On pourrait, par analogie, transposer ce qu'à propos de Mallarmé, Charles Mauron nomma le « symbolisme du drame solaire ». De l'Occident extrême, crépusculaire, de Sein und Zeit, de la méditation allemande du déclin de l'Occident, une pérégrination débute, qui conduit, à travers l'œuvre-au-noir et la mise-en-demeure de « l’être pour la mort » à l'aurora consurgens de la « renaissance immortalisante ». Point de rupture, ni de renversement, ici, mais un patient approfondissement de la question. Le crépuscule inquiétant des poèmes de Trakl, la « lumière noire » de la foudre d'Apollon des poèmes d'Hölderlin, ne contredisent point mais annoncent l'âme d'azur, « dis-cédée », et la terre céleste dans le resplendissement du Logos. Le crépuscule détient le secret de l'aurore, l'extrême Occident tient, dans son déclin, le secret de la sagesse orientale. Au philosophe, pour qui, je cite, « les variations linguistiques ne sont que des incidents de parcours, ne signalent que des variantes topographiques d'importance secondaires », l'art de l'interprétation sera une attention matutinale. A l'orée des signes, entre le jour et la nuit, sur la lisière impondérable, il n'est pas impossible que le secret de l'aube et le secret du crépuscule, le secret de l'Occident et le secret de l'Orient soient un seul un même secret. L'attention herméneutique guette cet instant où le Sens s'empourpre comme l'Archange dont parle le Traité de Sohravardî.
On pourrait, par analogie, transposer ce qu'à propos de Mallarmé, Charles Mauron nomma le « symbolisme du drame solaire ». De l'Occident extrême, crépusculaire, de Sein und Zeit, de la méditation allemande du déclin de l'Occident, une pérégrination débute, qui conduit, à travers l'œuvre-au-noir et la mise-en-demeure de « l’être pour la mort » à l'aurora consurgens de la « renaissance immortalisante ». Point de rupture, ni de renversement, ici, mais un patient approfondissement de la question. Le crépuscule inquiétant des poèmes de Trakl, la « lumière noire » de la foudre d'Apollon des poèmes d'Hölderlin, ne contredisent point mais annoncent l'âme d'azur, « dis-cédée », et la terre céleste dans le resplendissement du Logos. Le crépuscule détient le secret de l'aurore, l'extrême Occident tient, dans son déclin, le secret de la sagesse orientale. Au philosophe, pour qui, je cite, « les variations linguistiques ne sont que des incidents de parcours, ne signalent que des variantes topographiques d'importance secondaires », l'art de l'interprétation sera une attention matutinale. A l'orée des signes, entre le jour et la nuit, sur la lisière impondérable, il n'est pas impossible que le secret de l'aube et le secret du crépuscule, le secret de l'Occident et le secret de l'Orient soient un seul un même secret. L'attention herméneutique guette cet instant où le Sens s'empourpre comme l'Archange dont parle le Traité de Sohravardî.
Cet Archange empourpré, dont une aile est blanche et l'autre noire, dont l'envol repose à la fois sur le jour et sur la nuit, est le Sens lui-même qui se refuse à l'exclusive ou à la division. Opposer l'Orient et l'Occident, ce serait ainsi refuser le drame solaire du Logos lui-même, découronner le Logos, le réduire à n'être qu'une monnaie d'échange, un or irradié, dont la valeur est attribuée, utilitaire au lieu d'être un or irradiant, donateur et philosophal, forgé dans l'œuvre-au-rouge de l'herméneutique. Tout homme habitué au patient compagnonnage avec des textes lointains ou difficiles connaît ce moment de l'éclaircie, où le Sens s'exhausse de sa gangue, où les signes s'irisent, où l'exil devient la fine pointe des retrouvailles. Après avoir affronté les tempêtes et le silence des vents, l'excès du mouvement comme l'excès de l'immobilité, la houle et la désespérance du navire encalminé, après avoir déjoué les ruses de Calypso, les asiles fallacieux, et la nuit et le jour également aveuglants, l'odyssée herméneutique entrevoit le retour à la question d'origine, enfin déployée comme une voile heureuse. L'acheminement se distingue du simple cheminement. L'herméneute s'achemine vers: il ne vagabonde point, il pèlerine vers le secret de la question qu'il se pose au commencement. Il ne fuit point, ne s'éloigne point, mais s'approche au plus près du Dire dans la chose dite, de l'essence même du Logos qui parle à travers lui.
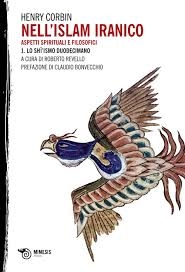 Toute herméneutique est donc odysséenne, par provenance et destination. Elle l'est par provenance, comme en témoigne le catalogue des œuvres détruites par le feu de la bibliothèque d'Alexandrie dont une grande part fut consacrée à la méditation du « logos intérieur » (selon la formule du Philon d'Alexandrie) de l'Odyssée, et dont quelques fragments nous demeurent, tel que L'Antre des Nymphes de Porphyre. L'Orient, comme l'Occident demeure spolié de cet héritage de l'herméneutique alexandrine où s'opéra la fécondation mutuelle du Logos grec et de la sagesse hébraïque. L'herméneutique est odysséenne par destination en ce qu'elle ne cesse de vouloir retrouver dans l'oméga, le sens de l'alpha initial. Pour l'herméneute, l'horizon du voyage est le retour. La ligne ultime, celle de l'horizon, comme « l'heure treizième » du sonnet de Gérard de Nerval, est aussi et toujours la première ligne de ce livre originel que figurent les rouleaux de la mer. L'herméneute, pour s'avancer sur les abysses, dont les couleurs assombries sont elles-mêmes l'interprétation de la lumière du ciel, pour s'orienter dans les étendues qui lui paraissent infinies, ne dispose que du sextant de son entendement qu'il sait faillible, dont il sait qu'il n'est qu'un instrument,- ce qui lui épargnera l'hybris de la raison qui omet de s'interroger sur elle-même et les errances du discours subjectif qui perd de vue l'alpha et l'oméga et restreint le sens dans l'aléatoire, l'éphémère et l'accidentel.
Toute herméneutique est donc odysséenne, par provenance et destination. Elle l'est par provenance, comme en témoigne le catalogue des œuvres détruites par le feu de la bibliothèque d'Alexandrie dont une grande part fut consacrée à la méditation du « logos intérieur » (selon la formule du Philon d'Alexandrie) de l'Odyssée, et dont quelques fragments nous demeurent, tel que L'Antre des Nymphes de Porphyre. L'Orient, comme l'Occident demeure spolié de cet héritage de l'herméneutique alexandrine où s'opéra la fécondation mutuelle du Logos grec et de la sagesse hébraïque. L'herméneutique est odysséenne par destination en ce qu'elle ne cesse de vouloir retrouver dans l'oméga, le sens de l'alpha initial. Pour l'herméneute, l'horizon du voyage est le retour. La ligne ultime, celle de l'horizon, comme « l'heure treizième » du sonnet de Gérard de Nerval, est aussi et toujours la première ligne de ce livre originel que figurent les rouleaux de la mer. L'herméneute, pour s'avancer sur les abysses, dont les couleurs assombries sont elles-mêmes l'interprétation de la lumière du ciel, pour s'orienter dans les étendues qui lui paraissent infinies, ne dispose que du sextant de son entendement qu'il sait faillible, dont il sait qu'il n'est qu'un instrument,- ce qui lui épargnera l'hybris de la raison qui omet de s'interroger sur elle-même et les errances du discours subjectif qui perd de vue l'alpha et l'oméga et restreint le sens dans l'aléatoire, l'éphémère et l'accidentel.
Ainsi devons-nous à Henry Corbin, non seulement la lumière faite sur des pans méconnus des cultures orientales et occidentales mais aussi le recouvrance de l'Art herméneutique à sa fine pointe, qui au-delà de l'exposition et de l'explication, serait une nouvelle implication du lecteur dans l'écrit qui se déroule sous ses yeux. Loin de considérer les œuvres de Mollâ Sadrâ ou de Ruzbéhan de Shîraz comme des objets culturels, délimités par l'histoire et la géographie, et dont nous séparerait à jamais la doxa de notre temps, Henry Corbin nous restitue à elles, à notre possibilité de les comprendre (dont dépend la possibilité de nous comprendre nous-mêmes), à cette implication, plus pointue que toute explication, à cette gnosis qui, je cite « convertit en jour cette nuit qui pourtant est toujours là, mais qui est une nuit de lumière ». « Ainsi donc, écrit Henry Corbin, lorsqu'il nous arrive de mettre en épigraphe les mots Ex oriente lux, nous nous tromperions du tout au tout en croyant dire la même chose que les Spirituels dont il sera question ici, si, pour guetter cette lumière de l'Orient, nous nous contentions de nous tourner vers l'orient géographique. Car, lorsque nous parlons du Soleil se levant à l'orient, cela réfère à la lumière du jour qui succède à la nuit. Le jour alterne avec la nuit, comme alternent deux contrastes qui, par essence, ne peuvent coexister. Lumière se levant à l'orient, et lumière déclinant à l'occident: deux prémonitions d'une option existentielle entre le monde du Jour et ses normes et le monde de la nuit, avec sa passion profonde et inassouvissable. Tout au plus, à leur limite, un double crépuscule: crepusculum vesperinum qui n'est plus le jour et qui n'est pas encore la nuit; crepusculum matutinum qui n'est plus la nuit et n'est pas encore le jour. C'est par cette image saisissante, on le sait, que Luther définissait l'être de l'homme ».
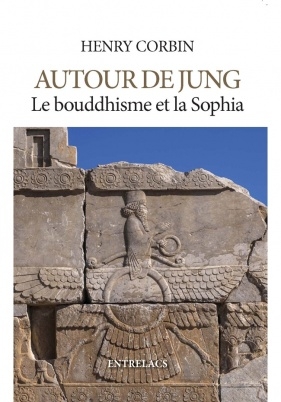 Dans ce crépuscule matutinal, auquel Baudelaire consacra un poème, dans cette lumière transversale, rasante, où le ciel semble plus proche de la terre, tout signe devient sacramentum, c'est-à-dire signe d'une chose cachée. L'oméga du crépuscule vespéral ouvre la mémoire à l'anamnésis du crépuscule matutinal. Par l'interprétation du « signe caché », du sacramentum, l'herméneute récitera, mais en sens inverse, le voyage de l'incarnation de l'esprit dans la matière, semblable, je cite « à la Columna gloriae constituée de toutes les parcelles de Lumière remontant de l'infernum à la terre de lumière, la Terra lucida ».
Dans ce crépuscule matutinal, auquel Baudelaire consacra un poème, dans cette lumière transversale, rasante, où le ciel semble plus proche de la terre, tout signe devient sacramentum, c'est-à-dire signe d'une chose cachée. L'oméga du crépuscule vespéral ouvre la mémoire à l'anamnésis du crépuscule matutinal. Par l'interprétation du « signe caché », du sacramentum, l'herméneute récitera, mais en sens inverse, le voyage de l'incarnation de l'esprit dans la matière, semblable, je cite « à la Columna gloriae constituée de toutes les parcelles de Lumière remontant de l'infernum à la terre de lumière, la Terra lucida ».
Matutinale est la pensée de l'implication dont l'interprétation est semblable à une procession liturgique, à une trans-ascendance vers la nuit lumineuse des Symboles. Voir les signes du monde et le monde des signes à la lumière de l'Ange suppose cette conquête du « suprasensible concret » qui n'appartient ni au monde matériel ni au monde de l'abstraction, mais à la présence même, qui selon la formule Héraclite, traduite par Battistini, « ne voile point, ne dévoile point, mais fait signe ». Or, si tout signe est signe d'éternité, la chance prodigieuse nous est offerte de lire les œuvres non plus au passé, comme s'y emploient les historiographies profanes et les fondamentalismes, mais bien au présent, à la lumière matutinale de l'Ange de la présence, témoin céleste de l'avènement herméneutique qui, souligne Henry Corbin, « implique justement la rupture avec le collectif, le rejonction avec la dimension transcendante qui prémunit individuellement la personne contre les sollicitations du collectif, c'est-à-dire contre toute socialisation du spirituel ».
L'implication de l'herméneute dans le déchiffrement des signes, le monde lui-même apparaissant, selon l'expression de Hugues de Saint-Victor, comme « la grammaire de Dieu », dévoile ainsi la vérité matutinale de l'Orient, en tant que « pôle de l'être », centre métaphysique, d'où l'Archange Logos nous invite à la transfiguration de l'entendement, à la conquête d'une surconscience délivrée des logiques grégaires, des infantilismes et des bestialités de ce que Simone Weil, après Platon, nomma « le Gros Animal », autrement dit, le monde social réduit à lui-même. « Le jour de la conscience, écrit Henry Corbin, forme un entre-deux entre la nuit lumineuse de la surconscience et la nuit ténébreuse de l'inconscience ». La psychologie transcendantale, dont Novalis, dans son Encyclopédie, déplorait l'inexistence ou la disparition, Henry Corbin en retrouvera non seulement les traces, mais la connaissance admirablement déployée dans la « Science de la Balance » et les théories chromatiques des soufis qui décrivent exactement l'espace versicolore entre la nuit ténébreuse et la nuit lumineuse, entre l'inconscience et la surconscience. L'intérêt de l'étude de cette psychologie transcendantale dépasse, et de fort loin, l'histoire des idées; elle se laisse si peu lire au passé, elle devance si largement nos actuels savoirs psychologiques que l'on doit imputer sans doute à une déplorable imperméabilité des disciplines qu'elle n'eût point encore renouvelé de fond en comble ces « sciences humaines » qui se revendiquent aujourd'hui de la psychologie ou de la psychanalyse, et semblent encore tributaires, à maint égards, du positivisme du dix-neuvième siècle.
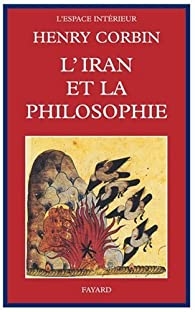 Sans doute le moment est-il venu de ressaisir aussi l'œuvre de Henry Corbin dans cette vertu transdisciplinaire, qui fut d'ailleurs de tous temps le propre de toutes les grandes œuvres philosophiques, à commencer par celle de Sohravardî qui, dans son traité de la Sagesse orientale, résume toutes les sciences de son temps, à l'intersection des sagesses grecques, abrahamiques, zoroastriennes et védantiques.
Sans doute le moment est-il venu de ressaisir aussi l'œuvre de Henry Corbin dans cette vertu transdisciplinaire, qui fut d'ailleurs de tous temps le propre de toutes les grandes œuvres philosophiques, à commencer par celle de Sohravardî qui, dans son traité de la Sagesse orientale, résume toutes les sciences de son temps, à l'intersection des sagesses grecques, abrahamiques, zoroastriennes et védantiques.
De l'herméneutique heideggérienne, dont il fut un des premiers traducteur, jusqu'à cette phénoménologie de l'Esprit gnostique, que sont les magistrales études sur l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn’Arabî, Henry Corbin renoue avec la lignée des philosophes qui ne limitent point leur dessein à méditer sur l'essence ou la légitimité de la philosophie, mais œuvrent, à l'exemple de Leibniz ou de Pascal, à partir d'un savoir, d'un corpus de connaissances, qu'ils portent au jour et qui, sans eux fût demeuré voilé, méconnu ou hors d'atteinte. L'acheminement, à travers les disciplines diverses qu'il éclaire, rétablit l'usage d'une gnose polyglotte et transdisciplinaire qui s'affranchit des assignations ordinaires du spécialiste. Au voyage extérieur, historique et géographique, correspond un voyage intérieur vers la Jérusalem Céleste, pour autant que ces deux personnage: le Chevalier de la célèbre gravure de Dürer, chère à Gilbert Durand, qui s'achemine vers le Jérusalem Céleste, entre la Mort et le Diable, et Ulysse sont les deux versants, l'un grec et l'autre abrahamique, de l'aventure herméneutique.
Mais revenons, faisons retour sur le principe même de l'acheminement, à partir d'une phrase lumineuse d'Eugenio d'Ors qui écrivait, je cite « Tout ce qui n'est pas tradition est plagiat ». L'herméneute participe de la tradition en ce qu'il suppose possible la traduction, en ce qu'il ne croit point en la nature arbitraire, immanente et close des langues humaines. Traduire, suppose à l'évidence, que l'on ne récuse point l'existence du Sens. Hamann, dans sa Rhapsodie en prose Kabbalistique, éclaire le processus herméneutique même de la traduction: « Parler, c'est traduire d'une langue angélique en une langue humaine, c'est-à-dire des pensées en des mots, des choses en des noms, des images en des signes ». Ce qui, dans les œuvres se donne à traduire est déjà, à l'origine, la traduction d'une langue angélique. L'office du traducteur-herméneute consistera alors à faire, selon la formule phénoménologique, « acte de présence » à ce dont le texte qu'il se propose de traduire est lui-même la traduction. Les théologiens médiévaux nommaient cette « présence » en amont, la vox cordis, la voix du cœur.
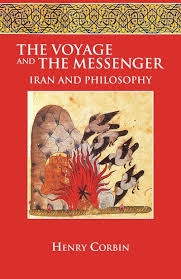 Loin de délaisser l'herméneutique heideggérienne et la phénoménologie occidentale, Henry Corbin en accomplit ainsi les possibles en de nouvelles palingénésies. A lire « au présent » les œuvres du passé, l'herméneute révèle le futur voilé inaccompli dans « l'Ayant-été ». « L'être-là, le dasein, écrit Henry Corbin, c'est essentiellement faire acte de présence, acte de cette présence par laquelle et pour laquelle se dévoile le sens au présent, cette présence sans laquelle quelque chose comme un sens au présent ne serait jamais dévoilé. La modalité de cette présence est bien alors d'être révélante, mais de telle sorte qu'en révélant le sens, c'est elle-même qui se révèle, elle-même qui est révélée ». L'implication essentielle de cette lecture au présent, qui révèle ce que le passé recèle d'avenir, fonde, nous dit Corbin, « le lien indissoluble, entre modi intellegendi et modi essendi, entre modes de comprendre et modes d'être ». Le dévoilement de ce qui est caché, c'est-à-dire de la vérité du Sens n'est possible que par cet acte de présence herméneutique qui, selon la formule soufie « reconduit la chose à sa source, à son archétype ». « Cet acte de présence, nous dit Henry Corbin, consiste à ouvrir, à faire éclore l'avenir que recèle le soi-disant passé dépassé. C'est le voir en avant de soi. ». A cet égard l'œuvre de Henry Corbin, bien plus que celle de Sartre ou de Derrida, qui usèrent à leur façon des approches de Sein und Zeit, semble véritablement répondre à la mise-en-demeure de la question heideggérienne, voire à la dépasser dans l'élan de son mouvement même.
Loin de délaisser l'herméneutique heideggérienne et la phénoménologie occidentale, Henry Corbin en accomplit ainsi les possibles en de nouvelles palingénésies. A lire « au présent » les œuvres du passé, l'herméneute révèle le futur voilé inaccompli dans « l'Ayant-été ». « L'être-là, le dasein, écrit Henry Corbin, c'est essentiellement faire acte de présence, acte de cette présence par laquelle et pour laquelle se dévoile le sens au présent, cette présence sans laquelle quelque chose comme un sens au présent ne serait jamais dévoilé. La modalité de cette présence est bien alors d'être révélante, mais de telle sorte qu'en révélant le sens, c'est elle-même qui se révèle, elle-même qui est révélée ». L'implication essentielle de cette lecture au présent, qui révèle ce que le passé recèle d'avenir, fonde, nous dit Corbin, « le lien indissoluble, entre modi intellegendi et modi essendi, entre modes de comprendre et modes d'être ». Le dévoilement de ce qui est caché, c'est-à-dire de la vérité du Sens n'est possible que par cet acte de présence herméneutique qui, selon la formule soufie « reconduit la chose à sa source, à son archétype ». « Cet acte de présence, nous dit Henry Corbin, consiste à ouvrir, à faire éclore l'avenir que recèle le soi-disant passé dépassé. C'est le voir en avant de soi. ». A cet égard l'œuvre de Henry Corbin, bien plus que celle de Sartre ou de Derrida, qui usèrent à leur façon des approches de Sein und Zeit, semble véritablement répondre à la mise-en-demeure de la question heideggérienne, voire à la dépasser dans l'élan de son mouvement même.
Ainsi de la notion fondamentale d'historialité (qu'Heidegger distingue de l'historicité en laquelle nous nous laissons insérer, nous interdisant par là même l'acte de présence phénoménologique) que Henry Corbin couronnera de la notion de hiéro-histoire: « histoire sacrale, laquelle ne vise nullement les fait extérieurs d'une "histoire sainte", d'une histoire du salut mais quelque chose de plus originel, à savoir l'ésotérique caché sous le phénomène de l'apparence littérale, celle des récits des Livres saints. » Si l'historialité permet de se déprendre des sommaires logiques déterministes, « en nous arrachant à l'historicité de l'Histoire », aux logiques purement discursives et chronologiques qui enferment les pensées dans leurs « contextes » sociologiques, la hiéro-histoire, elle, « nous apprend qu'il y a des filiations plus essentielles et plus vraies que les filiations historiques. » Non seulement les disparités linguistiques ou sociologiques ne nous interdisent pas de comprendre les œuvres du passé, mais, nous détachant des contingences de la chose dite, des écorces mortes, elles révèlent la vox cordis, la présence en acte, la vérité des filiations essentielles. L'empreinte visible détient le secret du sceau invisible et « la vieille image héraldique qui parlait en figures » dont parle Ernst Jünger dans La Visite à Godenholm, se révèle sous l'acception acquise des mots à celui interroge leur étymologie. Hamann, dans sa lumineuse « Rhapsodie » ne dit rien d'autre: « La poésie est la langue maternelle de l'humanité », de même que les alchimistes et des théosophes de l'Occident, les philosophes de la nature, les paracelsiens qui s'acheminent vers le déchiffrement des « signatures » de l'Invisible dans le visible et perçoivent la lumière révélante dans les éclats de la lumière révélée.

Le propre de cette langue, « qui parle en image », de cette langue prophétique et poétique sera, en dévoilant ce qui est caché, en laissant éclore et fleurir la lumière révélante, en élevant l'œcuménisme des branches et des racines jusqu'à la temporalité subtile de l'œcuménisme des essences et des parfums, de nous délivrer de la causalité historique, de transfigurer notre entendement, de l'ouvrir en corolle aux « Lumières seigneuriales » dont les lumières visibles et sensibles ne sont que les épiphénomènes ou les ombres. Lux umbra dei, disent les théologiens médiévaux: « La lumière est l'ombre de Dieu ». L'histoire n'est que l'ombre projetée dans les apparences de la hiéro-histoire. D'où, chez le gnostique, comme chez l'herméneute-phénoménologue, le nécessaire renversement de la métaphore.
Ce ne sont point l'Idée ou le Symbole qui sont métaphores de la nature ou de l'histoire, mais la nature et l'histoire qui sont une métaphore de l'Idée ou du Symbole. Ainsi, les interprétations allégoriques ou evhéméristes tombent d'elles-mêmes. Ce ne sont point les Symboles qui empruntent à la nature, ni les Mythes qui empruntent à l'histoire mais la nature et l'histoire qui en sont les reflets ou les réverbérations. Etre présent aux êtres et aux choses, c'est percevoir en eux l'éclat de la souveraineté divine dont ils procèdent. Le renversement de la métaphore dépasse la connaissance formelle, qui présume une représentation, pour atteindre à ce que les Ishrâqîyûns, les platoniciens de Perse, nomment une « connaissance présentielle ». Dès lors, les êtres et les choses ne sont plus des objets mais des présences. A « l'être pour la mort », qui fut pour un certain existentialisme, l'horizon indépassable de la pensée heideggérienne, et à la « laïcisation du Verbe » qui lui correspond (avec toutes les abusives et monstrueuses sacralisations de l'immanence qui s'ensuivirent), Henry Corbin répond par « l'être par-delà la mort » que dévoile « l'ek-stasis herméneutique » vers, je cite « ces autres mondes invisibles qui donnent son sens vrai au nôtre, à notre phénomène du monde. » Loin de débuter avec Sein und Zeit, comme sembleraient presque le croire quelques fondamentalistes heideggériens, la distinction classique entre l'Etre et l'étant (fut-il « Etant Suprême ») est précisément à l'origine de la méditation sur le tawhîd, sur « l'Attestation de l'Unique », qui est au cœur de la pensée d'Ibn’Arabî et de Sohravardî. Tout l'effort de ces gnostiques consiste à nous donner penser la distinction entre l'Unité théologique, exotérique, en tant que Ens supremum et l'Unificence ésotérique qui témoigne d'une ontologie de l'unité transcendantale de l'Etre. Nulle trace, ici, d'un « quiproquo onto-théologique », nul syncrétisme ou mélange malvenu. Pour reprendre la distinction platonicienne, la « doxa » ne confond pas avec la « gnosis ». Si la croyance s'adresse à un Dieu personnel ou à un Etant suprême, la gnose s'ordonne à la phrase ultime et oblative de Hallâj: « Le bon compte de l'Unique est que l'Unique le fasse unique », autrement dit, en langage eckhartien: « Le regard par lequel je vois Dieu et le regard par lequel Dieu me voit sont un seul et même regard. »

La Tradition, au sens d'art herméneutique de la traduction, Sapience de la « réelle présence », comme eût dit Georges Steiner, implication du « comprendre » dans l'être, est donc bien comme le suggère Eugenio d'Ors, recommencement, c'est-à-dire le contraire du plagiat ou du psittacisme. Ce qui est traduit recouvre son sens dans la traduction. Lorsque la traduction se prolonge en herméneutique, cette recouvrance est révélation. De même que les textes grecs nous sont parvenus par l'ambassade de la langue arabe, la traduction en français des textes persans et arabe de Sohravardî s'offre à nous comme un recommencement, une recouvrance, de la pensée grecque, aristotélicienne et platonicienne. L'œuvre de Henry Corbin s'inscrit ainsi dans une tradition et son art diplomatique, sinon par des circonstances contingentes, ne diffère pas essentiellement, des commentaires de ses prédécesseurs iraniens. Dans son mouvement odysséen, l'herméneutique, fut-elle le « commentaire d'un commentaire », ne s'éloigne point de la source du sens, mais s'en rapproche. Ainsi qu'Heidegger le disait à propos d'Hölderlin, certaines œuvres demeurent « en réserve »; et c'est bien à partir de cette « réserve », qui est le fret du navigateur, que s'accomplissent les renaissances, y compris artistiques. Point de Renaissance florentine, par exemple, sans le retour au texte, sans la volte néoplatonicienne de Pic de la Mirandole, de Marsile Ficin, ou celle kabbalistique et hébraïsante, du Cardinal Egide de Viterbe. La cause est entendue, ou devrait l'être depuis Saint-Bernard: « Nous sommes des nains assis sur les épaules des géants ». Non seulement les textes anciens ne nous sont pas devenus étrangers, incompréhensibles, inutiles, comme nous le veulent faire croire ces plagiaires qui s'intitulent parfois « progressistes », mais nos ombres qui nous devancent ne bougent que par la clarté antérieure qu'ils jettent sur nous. Traducteur, homme de Tradition, au sens étymologique, l'herméneute, ravive un lignage spirituel dont l'ultime manifestation, aussi obscurcie et profanée qu'elle soit, récapitule, pour qui sait se rendre attentif, l'entière lignée dont elle est l'aboutissement mais non la fin.
 Les ultimes sections d'En Islam iranien portent ainsi sur la notion de chevalerie spirituelle et de lignage spirituel. Ce lignage toutefois n'implique nulle archéolâtrie, nulle vénération fallacieuse des « origines ». Il n'est point tourné vers le passé, et sa redite, il n'est récapitulation morne ou cortège funèbre, mais renouvellement du Sens, fine pointe phénoménologique obéissant à l'impératif grec: sôzeïn ta phaïmomenon, sauver les phénomènes. « Ce qu'une philosophie comparée doit atteindre, écrit Henry Corbin, dans les différents secteurs d'un champ de comparaison défini, c'est avant tout ce que l'on appelle en allemand Wesenschau, la perception intuitive d'une essence ». Or cette perception intuitive dépend, non plus d'une nostalgie mais d'une attente eschatologique qui, nous dit Corbin « est enracinée au plus profond de nos consciences ». L'archéon de l'archéologie, ne suffit pas à la reconquête de l'eschaton de l'eschatologie. La transmutation du temps du ressouvenir en temps du pressentiment suppose que nous surmontions « la grande infirmité de la pensée moderne » qui est l'emprisonnement dans l'Histoire et que nous retrouvions l'accès à notre temps propre. « Un philosophe, écrit Henry Corbin, est d'abord lui-même son temps propre car s'il est vraiment un philosophe, il domine ce qu'il est abusivement convenu d'appeler son temps, alors que ce temps n'est pas du tout le sien, puisqu'il est le temps anonyme de tout le monde. »
Les ultimes sections d'En Islam iranien portent ainsi sur la notion de chevalerie spirituelle et de lignage spirituel. Ce lignage toutefois n'implique nulle archéolâtrie, nulle vénération fallacieuse des « origines ». Il n'est point tourné vers le passé, et sa redite, il n'est récapitulation morne ou cortège funèbre, mais renouvellement du Sens, fine pointe phénoménologique obéissant à l'impératif grec: sôzeïn ta phaïmomenon, sauver les phénomènes. « Ce qu'une philosophie comparée doit atteindre, écrit Henry Corbin, dans les différents secteurs d'un champ de comparaison défini, c'est avant tout ce que l'on appelle en allemand Wesenschau, la perception intuitive d'une essence ». Or cette perception intuitive dépend, non plus d'une nostalgie mais d'une attente eschatologique qui, nous dit Corbin « est enracinée au plus profond de nos consciences ». L'archéon de l'archéologie, ne suffit pas à la reconquête de l'eschaton de l'eschatologie. La transmutation du temps du ressouvenir en temps du pressentiment suppose que nous surmontions « la grande infirmité de la pensée moderne » qui est l'emprisonnement dans l'Histoire et que nous retrouvions l'accès à notre temps propre. « Un philosophe, écrit Henry Corbin, est d'abord lui-même son temps propre car s'il est vraiment un philosophe, il domine ce qu'il est abusivement convenu d'appeler son temps, alors que ce temps n'est pas du tout le sien, puisqu'il est le temps anonyme de tout le monde. »
A se délivrer du temps anonyme, autrement dit de la temporalité grégaire, propre au « Gros Animal », l'herméneute, je cite, « s'insurge contre la prétention de réduire la notion d'événement aux événements de ce monde, perceptibles par la voie empirique, constatables par tout un chacun, enregistrés dans les archives. » A cette conception de l'homme à l'intérieur de l'histoire, s'opposera, écrit Henry Corbin « une conception fondamentale, sans laquelle celle de l'histoire extérieure est privée de tout fondement. Elle considère que c'est l'histoire qui est dans l'homme ». Ces événements intérieurs, supra historiques, sans lesquels il n'y aurait point d'événements extérieurs, ces visions, intuitions ou extases qui nous font passer du monde des phénomènes à celui des noumènes sont à la fois le fruit de la grâce et d'une décision résolue. Dans sa temporalité propre reconquise Ruzbéhân de Shîraz écrit: « Il m'arriva quelque chose de semblable aux lueurs du ressouvenir et aux brusques aperçus qui s'ouvrent à la méditation. »
Ce quelque chose qui arrive, ou, plus exactement qui advient, qui n'appartient ni à la subjectivité ni à la perception empirique, n'arrive toutefois pas à n'importe qui et ne peut être jugée, ou contredit par n'importe qui. Ce que voient les yeux de feu ne saurait être contesté par les yeux de chair. « Que valent en effet, écrit Henry Corbin, les critiques adressées à ceux qui ont vus eux-mêmes, donc aux témoins oculaires, par ceux qui n'ont jamais vu et ne verront jamais rien ? La position est intrépide, je le sais, mais je crois que la situation de nos jours est telle que le philosophe, conscient de sa responsabilité, doit faire sienne cette intrépidité sohravardienne. » L'événement intérieur porte en lui le principe de la recouvrance d'une temporalité délivrée des normes profanes et de ces formes de socialisation extrême où se fourvoient les fondamentalismes religieux ou profanes. Ces événements hiérologiques dévoilent à l'intrépide, c'est-à-dire au chevalier spirituel, ce qui caché dans ce qui se révèle en frappant d'inconsistance le hiatus chronologique qui nous en sépare. Ce caché-révélé, qui réconcilie Héraclite et Platon, nous indique que l'Idée est à la fois immanente et transcendante. Elle est immanente, par les formes perceptibles qu'elle donne aux choses mais transcendante car, selon la belle formule platonisante d'André Fraigneau, « sans jeunesse antérieure et sans vieillesse possible ».
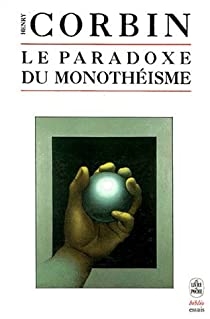 Ce paradoxe, que la philosophe platonicienne résout sous le terme de methexis, c'est-à-dire de « participation », précède un autre paradoxe. Les Platoniciens de Perse parlent en effet des Idées comme de natures ou de substances « missionnées » ou « envoyées ». Cet impérissable que sont les Idées n'est point figé dans un ciel immuable, mais nous est envoyé dans une perspective eschatologique, dans la profondeur du temps qui doit advenir. Dans le creuset de la pensée des Platoniciens de Perse, la fusion des Idées platoniciennes, des archanges zoroastriens, des Puissances divines (Dynameis) de Philon d'Alexandrie s'accomplit bien dans et par un feu prophétique. Les Lumières des Idées archétypes, comparables aux séphiroth de la kabbale hébraïque, ne demeurent point dans leur lointain: elles ont pour mission de nous faire advenir au saisissement de leur splendeur, elles nous sont « envoyées » pour que nous puissions établir un pont entre l'archéon et l'eschaton, entre ce que nous dévoile l'anamnésis et ce qui demeure caché dans les fins dernières. La Tradition à laquelle se réfère la chevalerie spirituelle n'a d'autre sens: elle est cette tension, dans la présence même de l'expérience intérieure, d'une relation entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Cette Tradition n'est point commémorative ou muséologique mais éveil du plus lointain dans la présence, fraîcheur castalienne, élévation verdoyante du Sens, semblable à l'Arbre qui, dans l'Ile Verte domine le temple de l'Imâm Caché.
Ce paradoxe, que la philosophe platonicienne résout sous le terme de methexis, c'est-à-dire de « participation », précède un autre paradoxe. Les Platoniciens de Perse parlent en effet des Idées comme de natures ou de substances « missionnées » ou « envoyées ». Cet impérissable que sont les Idées n'est point figé dans un ciel immuable, mais nous est envoyé dans une perspective eschatologique, dans la profondeur du temps qui doit advenir. Dans le creuset de la pensée des Platoniciens de Perse, la fusion des Idées platoniciennes, des archanges zoroastriens, des Puissances divines (Dynameis) de Philon d'Alexandrie s'accomplit bien dans et par un feu prophétique. Les Lumières des Idées archétypes, comparables aux séphiroth de la kabbale hébraïque, ne demeurent point dans leur lointain: elles ont pour mission de nous faire advenir au saisissement de leur splendeur, elles nous sont « envoyées » pour que nous puissions établir un pont entre l'archéon et l'eschaton, entre ce que nous dévoile l'anamnésis et ce qui demeure caché dans les fins dernières. La Tradition à laquelle se réfère la chevalerie spirituelle n'a d'autre sens: elle est cette tension, dans la présence même de l'expérience intérieure, d'une relation entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Cette Tradition n'est point commémorative ou muséologique mais éveil du plus lointain dans la présence, fraîcheur castalienne, élévation verdoyante du Sens, semblable à l'Arbre qui, dans l'Ile Verte domine le temple de l'Imâm Caché.
L'intrépidité sohravardienne qu'évoque Henry Corbin et qu'il fit sienne, cette vertu d'areté, qui est à la fois homérique et évangélique, donne seule accès à ce qu’il nomme, à partir de l'œuvre de Mollâ Sadrâ, « la métaphysique existentielle » des palingénésies et des métamorphoses que supposent le processus initiatique et la tension eschatologique: « L'acte d'exister, écrit Henry Corbin est en effet capable d'une multitude de degrés d'intensification ou de dégradation. Pour la métaphysique des essences, le statut de l'homme, par exemple, ou le statut du corps sont constant. Pour la métaphysique existentielle de Mollâ Sadrâ, être homme comporte une multitude de degrés, depuis celui des démons à face humaine jusqu'à l'état sublime de l'Homme Parfait. Ce qu'on appelle le corps passe par une multitude d'états, depuis celui du corps périssable de ce monde jusqu'à l'état du corps subtil, voire du corps divin. Chaque fois ces exaltations dépendent de l'intensification ou de l'atténuation, de la dégradation de l'existence, de l'acte d'exister ». Ce champ de variation, cette « latitude des formes » est au principe même de l'expérience intérieure, des événements du monde imaginal. Leur histoire est l'histoire sacrée de la temporalité propre du chevalier spirituel, le signe de son intrépidité à reconnaître dans les apparences la figure héraldique dont elles procèdent par la précision des lignes et l'intensité des couleurs. L'herméneutique tient ainsi à une métaphysique de l'attention et de l'intensité. La tension de l'attente eschatologique favorise l'intensité de l'attention. A l'opposé de cette tension, l'inattention à autrui, au monde et à soi-même est atténuation et dégradation de l'acte d'exister, par le mépris, l'indifférence, l'insensibilité, la complaisance dans l'illusion ou l'erreur, la vénération du confus ou de l'informe, qui engendrent les pires conformismes.
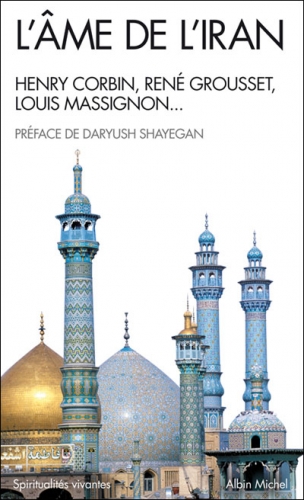 L'areté de l'herméneute, l'intrépidité chevaleresque précisent ainsi une éthique, c'est-à-dire une notion du Bien, indissociable du Vrai et du Beau qui s'exerce par l'attente et l'attention, en nous faisant hôtes, au double sens du mot: recevoir et être reçu. Si le voyage chevaleresque entre l'Orient et l'Occident définit une géographie sacrée avec ses épicentres, ses sites de haute intensité spirituelle, ses « cités emblématiques » où la Vision advint, où s'opéra la jonction entre le sensible et l'Intelligible, c'est bien parce qu'il se situe dans l'attente et dans l'attention, dans l'accroissement de la latitude des formes, et non dans la soumission aux opinions, aux jugements collectifs, fussent-ils de prétention religieuse. Que des temples eussent été édifiés à l'endroit où des errants, des déracinés, ont vu la terre et le Ciel s'accorder, que, de la sorte, l'espace et la géographie sacrée fussent déterminés par les révélations, les extases des « Nobles Voyageurs », cela suffirait à montrer que le mouvement, le tradere, la pérégrination précède les certitudes établies. D'où l'importance de la distinction, maintes fois réaffirmée par Henry Corbin et les auteurs dont il traite, entre la vérité ésotérique, intérieure, et l'exotérisme dominateur, qui veut emprisonner la spéculation et la vision dans l'immobilité d'une légalité outrecuidante et ratiocinante.
L'areté de l'herméneute, l'intrépidité chevaleresque précisent ainsi une éthique, c'est-à-dire une notion du Bien, indissociable du Vrai et du Beau qui s'exerce par l'attente et l'attention, en nous faisant hôtes, au double sens du mot: recevoir et être reçu. Si le voyage chevaleresque entre l'Orient et l'Occident définit une géographie sacrée avec ses épicentres, ses sites de haute intensité spirituelle, ses « cités emblématiques » où la Vision advint, où s'opéra la jonction entre le sensible et l'Intelligible, c'est bien parce qu'il se situe dans l'attente et dans l'attention, dans l'accroissement de la latitude des formes, et non dans la soumission aux opinions, aux jugements collectifs, fussent-ils de prétention religieuse. Que des temples eussent été édifiés à l'endroit où des errants, des déracinés, ont vu la terre et le Ciel s'accorder, que, de la sorte, l'espace et la géographie sacrée fussent déterminés par les révélations, les extases des « Nobles Voyageurs », cela suffirait à montrer que le mouvement, le tradere, la pérégrination précède les certitudes établies. D'où l'importance de la distinction, maintes fois réaffirmée par Henry Corbin et les auteurs dont il traite, entre la vérité ésotérique, intérieure, et l'exotérisme dominateur, qui veut emprisonner la spéculation et la vision dans l'immobilité d'une légalité outrecuidante et ratiocinante.
Ainsi, la notion de chevalerie spirituelle, que Henry Corbin définit comme un compagnonnage avec l'Ange, se donne à comprendre comme l'acheminement de la philosophie vers la métaphysique, c'est-à-dire vers son origine, sa source désempierrée. Loin d'être une philosophie plus abstraite que la philosophie, la métaphysique de la « latitude des formes » se distingue, comme le souligne Jean Brun par une relation concrète à des hommes concrets: « L'homme qui prétend atteindre une connaissance directe de Dieu par la nature ou par l'histoire se divinise et ne rend, en effet, témoignage que de lui-même. » Si la philosophie forge la clavis herméneutica, la métaphysique ouvre la porte qui nous porte au-delà du seuil. « Un mot simple comme l'être, écrit Jünger, a des profondeurs plus grandes qu'on ne saurait l'exprimer, ni même le penser. Par un mot comme sésame, l'un entend une poignée de graines oléagineuses, alors que l'autre, en le prononçant, ouvre d'un coup la porte d'une caverne aux trésors. Celui-ci possède la clef. Il a dérobé au pivert le secret de faire s'ouvrir la balsamine. » La clef n'est point la porte et la porte n'est point l'espace inconnu qu'elle ouvre à celui qui la franchit. Toutefois, ainsi que le souligne Jünger, « ce sont les grandes transitions que l'on remarque le moins. »
On ne saurait ainsi nier, que, par la vertu de l'art odysséen de l'herméneutique, une sorte de translation essentielle soit possible entre la philosophie et la métaphysique. Si la vérité ne se réduit pas à la cohérence des propositions logiques, si elle est bien aléthéia, dévoilement et ressouvenir, c'est-à-dire expérience intérieure où l'homme en tant qu'être du lointain s'éveille à la « coprésence », la conversion du regard qui change la philosophie en métaphysique, les yeux de chair en yeux de feu, échappe à toute contrôle, à toute vérification, voire à toute législation. De ce voyage intérieur, le grand soufi Djalal-ûd-din Rûmi put dire: « Ceci n'est pas l'ascension de l'homme jusqu'à la lune mais l'ascension de la canne à sucre jusqu'au sucre. » Le savoir ne devient Sapience, la philosophie ne devient métaphysique que par l'épreuve de la saveur, de l'essentielle intimité du voyage intérieur. S'adressant à nous, c'est-à-dire à ces êtres du lointain que nous étions pour lui, dans la coprésence du ressouvenir et de l'attente, Sohravardî nous dit « Toi-même tu es l'un des bruissements des ailes de Gabriel ». L'embarcation herméneutique est la clef de la mer et du ciel, le vaisseau subtil alchimique de l'interprétation infinie nous invite au dialogue où la lumière matérielle, sensible, devient la lux perpétua de la philosophie illuminative, autrement dit de la métaphysique. Ce que le ciel et la mer ont à se dire, en assombrissements et en splendeurs, nous invite à nous retrouver nous- mêmes. « Nous sommes un dialogue, écrit Heidegger, dans ses Approches de Hölderlin, l'unité du dialogue consiste en ce que chaque fois, dans la parole essentielle soit révélé l'Un et même sur lequel nous nous unissons, en raison duquel nous sommes Un et ainsi authentiquement nous -mêmes. » Loin de ramener le religieux au social, ou la philosophie à une religiosité grégaire, la conversion de la philosophie en métaphysique, telle qu'elle s'illustre dans l'œuvre de Henry Corbin, en ce voyage vers l'Ile Verte en la mer blanche nous conduit à une science de la vérité cachée, non détenue, et, par voie de conséquence, rétive à toute instrumentalisation.
 Ces dernières décennies nous ont montré, si nécessaire, que l'instrumentalisation du religieux en farces sanglantes appartenait bien à notre temps, qu'elle était, selon la formule de René Guénon, avec la haine du secret, un des « Signes des Temps » qui sont les nôtres. Si elle n'est pas cortège funèbre, fixation sur la lettre morte, idolâtrie des écorces de cendre, la Tradition est renaissance, recueillement dans la présence du voyage intérieur où l'Un dans son unificence devient principe d'universalité. « Il ne s'agit plus, écrit Jean Brun, de permettre à l'historicisme d'accomplir son travail dissolvant en laissant croire que la recherche des sources se situe dans le cadre d'une histoire comparée de la philosophie des religions ou de la mythologie. Toutes ces spécialités analysent des combustibles ou des cendres au lieu de se laisser illuminer par le feu de la Tradition. » Il ne s'agit pas davantage, de se soumettre, par fidélité aveugle, à des coutumes ou des dénomination confessionnelles, d'emprisonner la parole dans la catastrophe de répétition mais bien de comprendre la vertu paraclétique de la Tradition, qui n'est point un « mythe » au sens de mensonge, moins encore une réalité historique mais, selon la formule de Henry Corbin « un synchronisme réglant un champs de conscience dont les lignes de force nous montrent à l'œuvre les mêmes réalités métaphysiques. » Le Paraclet est la présence même dont l'advenue confirme en nous la pertinence de l'idée augustinienne selon laquelle le passé et le présent, par le souvenir et l'attente, sont présents dans la présence. « Tout se passe, écrit Henry Corbin, comme si une voix se faisait entendre à la façon dont se ferait entendre au grand orgue le thème d'une fugue, et qu'une autre voix lui donnât la réponse par l'inversion du thème. A celui qui peut percevoir les résonances, la première voix fera peut-être entendre le contrepoint qu'appelle la seconde, et d'épisode en épisode l'exposé de la fugue sera complet. Mais cet achèvement c'est le Mystère de la Pentecôte, et seul le Paraclet a mission de le dévoiler. »
Ces dernières décennies nous ont montré, si nécessaire, que l'instrumentalisation du religieux en farces sanglantes appartenait bien à notre temps, qu'elle était, selon la formule de René Guénon, avec la haine du secret, un des « Signes des Temps » qui sont les nôtres. Si elle n'est pas cortège funèbre, fixation sur la lettre morte, idolâtrie des écorces de cendre, la Tradition est renaissance, recueillement dans la présence du voyage intérieur où l'Un dans son unificence devient principe d'universalité. « Il ne s'agit plus, écrit Jean Brun, de permettre à l'historicisme d'accomplir son travail dissolvant en laissant croire que la recherche des sources se situe dans le cadre d'une histoire comparée de la philosophie des religions ou de la mythologie. Toutes ces spécialités analysent des combustibles ou des cendres au lieu de se laisser illuminer par le feu de la Tradition. » Il ne s'agit pas davantage, de se soumettre, par fidélité aveugle, à des coutumes ou des dénomination confessionnelles, d'emprisonner la parole dans la catastrophe de répétition mais bien de comprendre la vertu paraclétique de la Tradition, qui n'est point un « mythe » au sens de mensonge, moins encore une réalité historique mais, selon la formule de Henry Corbin « un synchronisme réglant un champs de conscience dont les lignes de force nous montrent à l'œuvre les mêmes réalités métaphysiques. » Le Paraclet est la présence même dont l'advenue confirme en nous la pertinence de l'idée augustinienne selon laquelle le passé et le présent, par le souvenir et l'attente, sont présents dans la présence. « Tout se passe, écrit Henry Corbin, comme si une voix se faisait entendre à la façon dont se ferait entendre au grand orgue le thème d'une fugue, et qu'une autre voix lui donnât la réponse par l'inversion du thème. A celui qui peut percevoir les résonances, la première voix fera peut-être entendre le contrepoint qu'appelle la seconde, et d'épisode en épisode l'exposé de la fugue sera complet. Mais cet achèvement c'est le Mystère de la Pentecôte, et seul le Paraclet a mission de le dévoiler. »
Loin de se réduire à un comparatisme profane, l'art de percevoir des résonances relève lui-même sinon du Mystère du moins d'une approche du Mystère. Husserl, qui définissait la phénoménologie comme une « communauté gnostique » disait que, pour mille étudiants capables de restituer ses cours de façon satisfaisante et même brillante, il ne devait s'en trouver que deux ou trois pour avoir vraiment réalisé en eux-mêmes l'expérience phénoménologique du « Nous transcendantal ». Sans doute en est-il de même des symboles religieux, qui peuvent être de banales représentations d'une appartenance collective ou pure présence d'un retour paraclétique à soi-même, c'est à dire au principe d'un au-delà de l'individualisme, d'une universalité métaphysique dont l'uniformisation moderne n'est que l'abominable parodie. « J'ai réfléchi, dit Hallâj, sur les dénominations confessionnelles, faisant effort pour les comprendre, et je les considère comme un Principe unique à ramification nombreuses. Ne demande donc pas à un homme d'adopter telle dénomination confessionnelle, car cela l'écarterait du Principe fondamental, et certes, c'est ce Principe Lui-même qui doit venir le chercher, Lui en qui s'élucident toutes les grandeurs et toutes les significations: et l'homme alors comprendra. »
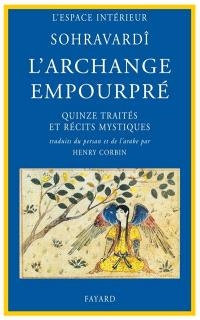 Que le Principe dût nous venir chercher, car il est de l'ordre du ressouvenir et de l'attente, de la nostalgie et du pressentiment, que nous ne puissions-nous saisir de Lui, nous l'approprier, le soumettre à l'hybris de nos ambitions trop humaines, il suffit pour s'en persuader de comprendre ce qu'Heidegger disait du langage: « Le langage n'est pas un instrument disponible, il est tout au contraire, cet historial qui lui-même dispose de la suprême possibilité de l'être de l'homme. » L'apparition vespérale-matutinale de l'Archange Logos, dont nous ne sommes qu'un bruissement, ce dévoilement de la vérité hors d'atteinte, à la fois anamnésis et désir, n'est autre, selon la formule de Rûmi que « la recherche de la chose déjà trouvée » qui, entre la nuit et le jour, réinvente le dialogue de l'Unique avec l'unique: « Si tu te rapproches de moi, c'est parce que je me suis rapproché de toi. Je suis plus près de toi que toi-même, que ton âme, que ton souffle ».
Que le Principe dût nous venir chercher, car il est de l'ordre du ressouvenir et de l'attente, de la nostalgie et du pressentiment, que nous ne puissions-nous saisir de Lui, nous l'approprier, le soumettre à l'hybris de nos ambitions trop humaines, il suffit pour s'en persuader de comprendre ce qu'Heidegger disait du langage: « Le langage n'est pas un instrument disponible, il est tout au contraire, cet historial qui lui-même dispose de la suprême possibilité de l'être de l'homme. » L'apparition vespérale-matutinale de l'Archange Logos, dont nous ne sommes qu'un bruissement, ce dévoilement de la vérité hors d'atteinte, à la fois anamnésis et désir, n'est autre, selon la formule de Rûmi que « la recherche de la chose déjà trouvée » qui, entre la nuit et le jour, réinvente le dialogue de l'Unique avec l'unique: « Si tu te rapproches de moi, c'est parce que je me suis rapproché de toi. Je suis plus près de toi que toi-même, que ton âme, que ton souffle ».
Loin d'être cet Etant suprême de la théologie exotérique, qui nous tient en exil de la vérité de l'être, séparé de l'éclaircie essentielle, Dieu est alors celui qui se voit lui-même à travers nous-mêmes, de même que nous ne parlons pas le langage mais que le langage se parle à travers nous, nous disant, par exemple, par la bouche d'Ibn’Arabî, à ce titre prédécesseur de la Mystique rhénane,: « C'est par mon œil que tu me vois , ce n'est pas par ton œil que tu peux me concevoir ». Croire que Dieu n'est qu'un Etant suprême, c'est confondre la forme avec ce qu'elle manifeste, c'est être idolâtre, c'est demeurer sourd à l'Appel, c'est renoncer à la vision du cœur et à l'attestation de l'Unique. A la tristesse, la morosité, l'ennui, la jalousie, le ressentiment qui envahissent l'âme emprisonnée dans l'exil occidental, dans le ressassement du déclin, dans l'oubli de l'oubli comme dans « la volonté de la volonté », la vertu paraclétique oppose la ferveur, la légèreté dansante, le tournoiement des possibles, l'intensification des actes d'exister. « Comment, écrit Rûmi, le soufi pourrait-il ne pas se mettre à danser, tournoyant sur lui-même comme l'atome au soleil de l'éternité afin qu'il le délivre de ce monde périssable ? » S'unissant en un même mouvement, dans un même tournoiement des possibles, la nostalgie et le pressentiment, le passé et le futur se délivrent d'eux-mêmes pour éclore dans la présence pure en corolle, qui est la réponse même, le répons, à « la question qui ne vient ni du monde, ni de l'homme ».
La clef herméneutique heideggérienne, trouvant son usage pertinent dans la métaphysique, qui n'est plus la métaphysique dualiste, et pour tout dire caricaturale, du platonisme scolaire, ni la théologie de l'Etant suprême, ni la soumission aveugle à la forme en tant que telle, - en nous ouvrant à la perspective de la « gradation infinie » des états de l'être et de la conscience, du plus atténué au plus intense, en graduant la connaissance selon les principes initiatiques, nous délivre ainsi, du même geste, de toute forme de socialisation extrême, de tout fondamentalisme, fût-il « démocratique ». L'Imâm caché sous le grand Arbre cosmogonique d'où jaillit la source la vie, l'eau castalienne de la mémoire retrouvée, interdit toute socialisation du religieux, toute réduction du Symbole à la part visible et immanente, à une beauté qui ne serait que purement terrestre, donc relative et variable selon les us et coutumes. La laideur qui s'empare des Symboles profanés, des coutumes instrumentalisées, est un signe de la fausseté qui en abuse. La Beauté prouve le Vrai, comme l'humilité et courtoisie prouvent le Bien. Si le monde sensible est la métaphore de l'intelligible, si la forme perçue est le miroir de la forme idéale, ce monde-ci, avec ses Normes profanes, ses communautés vindicatives, ne peut en aucune façon prétendre au Beau et au Vrai. « Dès que les hommes se rassemblent, écrit Henry de Montherlant, ils travaillent pour quelque erreur. Seule l'âme solitaire dialogue avec l'esprit de vérité. » Cette solitude cependant, par un paradoxe admirable, n'est point esseulement mais communion car elle suppose l'oubli de soi-même, l'extinction du moi devant l'Ange de la Face, le consentement à la pérégrination infinie loin de soi-même, dans les écumes de la mer blanche et le pressentiment de l'Ile Verte. Au relativisme absolu des Modernes, qui emprisonnent chaque chose dans une abstraction profane, pour lesquels « le corps n'est que le corps », la danse des soufis oppose l'absolu des relations tournoyantes dans l'approche d'une Beauté dont toutes les beautés relatives ne sont que l'émanation ou le reflet. A la philosophie, comme instrument de pouvoir (ce qu'elle fut, dans la continuité hégélienne, avec fureur) la métaphysique reconquise, par l'humilité et l'abandon à la grandeur divine, opposera ce décisif retournement de la métaphore qui laisse à la beauté de la vérité son resplendissement, comme le reflet du soleil sur la mer, comme la solitude de l'Unique pour un unique.
Luc-Olivier d'Algange.
20:20 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, tradition, henry corbin, iran, islam, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 25 octobre 2020
L'Intellectualité musicale

L'Intellectualité musicale
par Luc-Olivier d'Algange
L'importance de la musique dans l'œuvre de Hoffmann n'est pas seulement d'ordre thématique ou anecdotique. Les Contes, et Le Vase d'Or, en particulier, s'ordonnent à des lois subtiles et mobiles qui requièrent du lecteur une attention que l'on pourrait dire « musicienne ». Etre attentif aux phrases, à l'enchaînement des circonstances du récit et à la pensée même de l'auteur, c'est, en la circonstance, changer en musique les mots écrits, élever les signes typographiques à la hauteur idéale du chant. Par cette exigence à l'égard d'elle-même et à l'égard du lecteur, l'œuvre de Hoffmann s'inscrit dans la tradition du Romantisme allemand tel que Novalis en sut formuler les idées majeures et le dessein. Albert Béguin écrit, à propos de Hoffmann: « Tard venu, il héritait d'une tradition qui remonte à Herder, dont Goethe avait été tributaire et dont Novalis avait élaboré la théorie. »
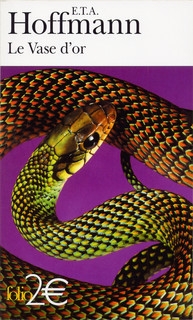 D'ordre prophétique, plutôt que systématique, les théories de Novalis éclairent la pensée qui, à l'œuvre dans Le Vase d'Or, risque de paraître allusive ou incertaine. Or, l'idée d'une intellectualité musicale, c'est-à-dire d'une intellectualité en mouvement suppose, dans la pensée de Novalis, que l'esthétique et la métaphysique soient indubitablement liées, unies, dans les variations infinies et les configurations sans cesse nouvelles de la musique. L'Intellect n'est point séparé des sens; il est, pour ainsi dire, le moyeu immobile de cette circularité synesthésique où, selon l'expression de Baudelaire, « les couleurs, les parfums et les sons se répondent. »
D'ordre prophétique, plutôt que systématique, les théories de Novalis éclairent la pensée qui, à l'œuvre dans Le Vase d'Or, risque de paraître allusive ou incertaine. Or, l'idée d'une intellectualité musicale, c'est-à-dire d'une intellectualité en mouvement suppose, dans la pensée de Novalis, que l'esthétique et la métaphysique soient indubitablement liées, unies, dans les variations infinies et les configurations sans cesse nouvelles de la musique. L'Intellect n'est point séparé des sens; il est, pour ainsi dire, le moyeu immobile de cette circularité synesthésique où, selon l'expression de Baudelaire, « les couleurs, les parfums et les sons se répondent. »
« Il est étrange, écrit Novalis, que l'intérieur de l'homme ait été jusqu'à présent exploré de façon aussi indigente et qu'on en ait traité avec tant d'insipidité, un tel manque d'esprit. La prétendue psychologie est encore une de ces larves qui ont pris, dans le sanctuaire, la place que devaient tenir d'authentiques images divines... Intelligence, imagination, raison, ce sont là des compartiments misérables de l'univers qui est en nous. De leurs merveilleuses compénétrations, des configurations qu'elles forment, de leurs transitions infinies, pas un mot. Il n'est venu à l'idée de personne de chercher en nous des forces nouvelles encore, et qui n'ont pas reçu de nom, d'enquêter sur leurs rapports de compagnonnage. Qui sait à quelles merveilleuses unions, à quelles générations prodigieuses nous pouvons encore nous attendre au-dedans de nous-mêmes. » La musique étant l'art des variations et des transitions infinies, l'intellectualité musicale, à l'œuvre dans Le Vase d'Or, sera le principe de passages entre des domaines, des règnes et des états habituellement séparés par des frontières rigoureuses. La réalité et le rêve, la nature inanimée et animée, les figures humaines et mythiques se confondent pour susciter ces « générations prodigieuses » que pressent Novalis. De cette mise-en-miroir d'aspects ordinairement distincts naît un vertige de reflets et de spéculations infinies où la réalité mystérieusement s'avive et s'agrandit.
Sous le sureau où s'est réfugié l'étudiant Anselme, soudain s'accroît l'intensité des couleurs. Les « vagues dorées du beau fleuve », les « clochers lumineux sur le fond vaporeux du ciel », les « prés fleuris et les forêts d'un vert tendre » annoncent les brillantes nuances des « serpents verts » et les teintes de la bibliothèque secrète de l'Archiviste Lindhorst. Les couleurs sont les accords magnifiques qui annoncent le passage de la réalité quotidienne, banale, à une réalité visionnaire et prodigieuse. Les images du conte sont annonciatrices. L'imprévisible est contenu dans le déjà advenu. La vastitude et la complexité du monde auquel l'expérience visionnaire convie l'étudiant Anselme, évoque un opéra féerique. La « folie » d'Anselme est le prélude d'une sagesse verdoyante. Développée à partir d'un thème unique, l'intellectualité musicale favorise l'arborescence logique des métamorphoses.
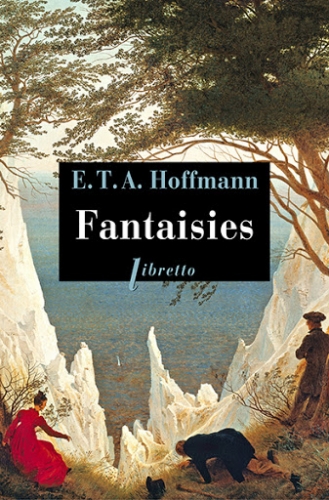 Les bruissements deviennent parole. L'inintelligible, le bruit sont gagnés par le Sens et par la musique: « Ici l'étudiant Anselme fut interrompu dans son soliloque par un étrange bruit de frôlements et de froufrous qui s'éleva dans l'herbe tout près de lui, pour glisser et monter bientôt après jusqu'aux branches et aux feuilles du sureau qui s'étalaient en voûte au-dessus de sa tête. On eût dit tantôt que le vent du soir secouait le feuillage, tantôt que les oiselets folâtraient dans les branches, agitant de-ci de-là leurs petites ailes en leurs capricieux ébats. Puis ce furent des chuchotements, des zézaiements, et il sembla que les fleurs tintaient comme autant de clochettes cristallines suspendues aux branches. Anselme ne se laissait pas de prêter l'oreille. Tout à coup, sans qu'il sut lui-même comment, ces zézaiements, ces chuchotements et ces tintements se changèrent en paroles à peine perceptibles, à moitié emportées par le vent... » La musicalité des mots coïncide avec leur ressaisissement par le sens: « Zwischen durch - zwischen ein - zwischen Zweigen, zwischen swellenden Bluten... » Le texte allemand, mieux que ses traductions françaises, restitue ce saisissement des rumeurs par la musicalité naissante du Sens dont la souveraineté soudaine tinte « comme un accord parfait de claires cloches cristallines » précédant l'apparition de Serpentina.
Les bruissements deviennent parole. L'inintelligible, le bruit sont gagnés par le Sens et par la musique: « Ici l'étudiant Anselme fut interrompu dans son soliloque par un étrange bruit de frôlements et de froufrous qui s'éleva dans l'herbe tout près de lui, pour glisser et monter bientôt après jusqu'aux branches et aux feuilles du sureau qui s'étalaient en voûte au-dessus de sa tête. On eût dit tantôt que le vent du soir secouait le feuillage, tantôt que les oiselets folâtraient dans les branches, agitant de-ci de-là leurs petites ailes en leurs capricieux ébats. Puis ce furent des chuchotements, des zézaiements, et il sembla que les fleurs tintaient comme autant de clochettes cristallines suspendues aux branches. Anselme ne se laissait pas de prêter l'oreille. Tout à coup, sans qu'il sut lui-même comment, ces zézaiements, ces chuchotements et ces tintements se changèrent en paroles à peine perceptibles, à moitié emportées par le vent... » La musicalité des mots coïncide avec leur ressaisissement par le sens: « Zwischen durch - zwischen ein - zwischen Zweigen, zwischen swellenden Bluten... » Le texte allemand, mieux que ses traductions françaises, restitue ce saisissement des rumeurs par la musicalité naissante du Sens dont la souveraineté soudaine tinte « comme un accord parfait de claires cloches cristallines » précédant l'apparition de Serpentina.
La pensée qui amoureusement s'unit à cette musique, mieux que la pensée profane, s'accorde aux secrètes concordances du monde. Les choses ne sont point ce qu'elles paraissent être. L'Invisible résonne dans le visible et les échos du visible se prolongent et se répercutent dans l'Invisible. Le monde, dans tous ses aspects est ainsi doué de parole: « Le vent du soir passa dans un frôlement et dit: « je me jouais autour de ton front mais tu ne m'as pas compris; le souffle est mon langage, quand l'amour l'enflamme ». Les rayons du soleil percèrent les nuées, et la lueur éclatait comme en paroles: « Je t'inondais de mon or embrasé, mais tu ne m'as pas compris; l'embrasement est mon langage quand l'amour l'enflamme. Et, plongeant toujours plus au fond des deux yeux magnifiques, la nostalgie se faisait plus ardente, le désir s'embrasait. Alors tout s'agita et s'anima, tout sembla s'éveiller à la vie et au plaisir. Les plantes et les fleurs embaumaient autour de lui et leur parfum était comme un chant magnifique de mille voix de flûtes; et les nuages du soir qui passaient en fuyant emportaient l'écho de leurs chansons vers les pays lointains. » En l'apogée de l'intellectualité musicale, la nature irradie. Le présent rayonne des hautes puissances d'un passé légendaire ou mythique. L'archiviste Lindhorst peut défier la clientèle bourgeoise car il est en vérité Prince des Esprits: « Il se peut que ce que je viens de vous raconter, en traits bien insuffisants, il est vrai, vous paraisse absurde et extravagant, mais ce n'en est pas moins extrêmement cohérent et nullement à prendre au sens allégorique, mais littéralement vrai »
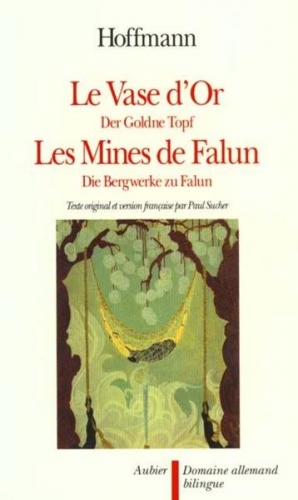 « Nullement allégoriques et littéralement vraies » sont, dans le Conte de Hoffmann, les métamorphoses. Les véritables « identités » ne sont pas détenues dans le monde profane mais elles sont les reflets des plus hautes et immémoriales identités des « seigneuries d'Atlantis ». De même que, selon Platon, le temps est l'image mobile de l'éternité, les identités des personnages sont les images mobiles d'une vérité provisoirement lointaine, mais source d'une lancinante nostalgie. Les objets eux-mêmes, menacés dans leur statut,- et par cela même menaçants,- ne sont pas exempts de ces métamorphoses. Ainsi en est-il du heurtoir de la porte de Lindhorst: « La figure de métal s'embrasant dans une hideuse fantasmagorie de lueurs bleues, se contracta en un grimaçant rictus...» Plus loin, c'est le cordon de la sonnette qui se change en reptile: « Le cordon de sonnette s'abaissant devint un serpent géant, blanc et diaphane qui l'enveloppa, l'étreignit; laçant ses anneaux de plus en plus serrés, si bien que les os flasques et broyés s'effritèrent en craquant et que le sang gicla de ses veines pénétrant le corps diaphane du serpent et le colorant de rouge. » Entre l'angoisse et l'extase, l'intellectualité musicale entraîne la pensée dans une imagerie mouvante où chaque thème et chaque image est en proie à l'exigence qui doit les changer en d'autres thèmes et d'autres images. Les métamorphoses angoissantes annoncent les métamorphoses extatiques. Le resserrement de l'angoisse va jusqu'à la pétrification. Face à l'archiviste Lindhorst, Anselme sent « un torrent de glace parcourir ses veines gelées » comme s'il était en train de se changer en statue de pierre. Par contraste, les métamorphoses extatiques n'en sont que plus ouraniennes et plus immatérielles. Sous le baiser de Phosphorus, la fleur de lys se défait de toute pesanteur et de toute compacité et s'embrase dans les hauteurs: « Et comme rayonnante de lumière, elle s'embrasa en hautes flammes, d'où fit irruption un être étranger, qui, laissant la vallée bien loi au-dessous de lui, erra en tous sens dans l'espace infini.»
« Nullement allégoriques et littéralement vraies » sont, dans le Conte de Hoffmann, les métamorphoses. Les véritables « identités » ne sont pas détenues dans le monde profane mais elles sont les reflets des plus hautes et immémoriales identités des « seigneuries d'Atlantis ». De même que, selon Platon, le temps est l'image mobile de l'éternité, les identités des personnages sont les images mobiles d'une vérité provisoirement lointaine, mais source d'une lancinante nostalgie. Les objets eux-mêmes, menacés dans leur statut,- et par cela même menaçants,- ne sont pas exempts de ces métamorphoses. Ainsi en est-il du heurtoir de la porte de Lindhorst: « La figure de métal s'embrasant dans une hideuse fantasmagorie de lueurs bleues, se contracta en un grimaçant rictus...» Plus loin, c'est le cordon de la sonnette qui se change en reptile: « Le cordon de sonnette s'abaissant devint un serpent géant, blanc et diaphane qui l'enveloppa, l'étreignit; laçant ses anneaux de plus en plus serrés, si bien que les os flasques et broyés s'effritèrent en craquant et que le sang gicla de ses veines pénétrant le corps diaphane du serpent et le colorant de rouge. » Entre l'angoisse et l'extase, l'intellectualité musicale entraîne la pensée dans une imagerie mouvante où chaque thème et chaque image est en proie à l'exigence qui doit les changer en d'autres thèmes et d'autres images. Les métamorphoses angoissantes annoncent les métamorphoses extatiques. Le resserrement de l'angoisse va jusqu'à la pétrification. Face à l'archiviste Lindhorst, Anselme sent « un torrent de glace parcourir ses veines gelées » comme s'il était en train de se changer en statue de pierre. Par contraste, les métamorphoses extatiques n'en sont que plus ouraniennes et plus immatérielles. Sous le baiser de Phosphorus, la fleur de lys se défait de toute pesanteur et de toute compacité et s'embrase dans les hauteurs: « Et comme rayonnante de lumière, elle s'embrasa en hautes flammes, d'où fit irruption un être étranger, qui, laissant la vallée bien loi au-dessous de lui, erra en tous sens dans l'espace infini.»
Rien n'échappe à ces variations, transitions et métamorphoses qui, par leurs enchantements, entraînent la pensée en des contrées surnaturelles. La nostalgie romantique qui s'empare de l'étudiant Anselme, recèle des pouvoirs extrêmes car elle est le principe d'embrasement du pressentiment lui-même. La nostalgie romantique, « sehnsucht », est une nostalgie prophétique, impérieuse, qui oeuvre à une véritable transmutation de l'entendement. Mais cette transmutation n'est pas sans dangers: « Je vois et je sens parfaitement désormais que toutes sortes de formes étrangères, venues d'un monde lointain et prodigieux que je ne contemplais jadis qu'en certains rêves singuliers, et bien particuliers, ont envahis à présent mes états de veille et ma vie active, et se jouent de moi. » Fidèle au dessein de Novalis, qui consiste à se saisir des configurations et des transitions nouvelles de l'intelligence, de l'imagination et de la raison, Le Vase d'Or de Hoffmann va proposer dans une adresse au lecteur, qui se situe à peu près au milieu du récit, une interprétation métaphysique des épreuves que traverse la pensée lorsqu'elle est vouée à l'aventure des métamorphoses: « Essaie, ami lecteur, dans le royaume féerique plein de sublimes prodiges, qui provoquent sous leur choc formidable les suprêmes délices aussi bien que la plus profonde épouvante,- dans ce royaume où l'austère déesse lève un coin de son voile, si bien que nous nous figurons contempler son visage,- ( mais un sourire brille souvent sous son regard austère, et c'est le caprice taquin qui se joue de nous et nous trouble et nous ensorcelle de mille façons, comme une mère aime à badiner avec ses enfants préférés),- dans ce royaume disais-je, dont l'esprit, du moins en rêve, nous ouvre si souvent les portes, essaie, ami lecteur, de reconnaître les silhouettes bien connues que tu coudoies journellement, suivant l'expression consacrée, dans la vie ordinaire. Tu seras alors d'avis que ce sublime royaume est beaucoup plus près de nous que, peut-être, tu ne l'estimais ordinairement... et c'est ce que je souhaite de tout mon coeur, et m'efforce de te faire comprendre dans l'étrange histoire de l'étudiant Anselme. »
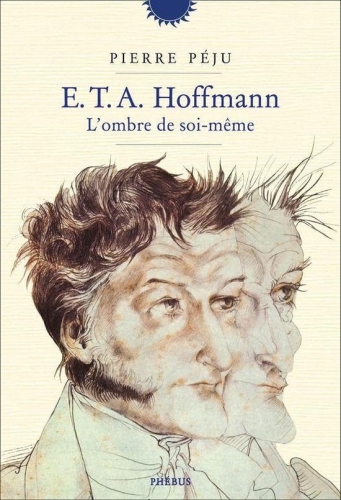
La « vie ordinaire » qui nous sépare des « suprêmes délices » et des « profondes épouvantes » est plus ténue qu'il n'y paraît. La proximité du « sublime royaume » est attestée par les pouvoirs de notre conscience à se concevoir elle-même comme changeante, soumise à cette hiérarchie infinie des états dont la veille, le rêve, le sommeil, l'extase offrent quelques exemples rudimentaires. Ce qui importe est plus subtil: cette orée miroitante qui unit et sépare la veille et le rêve, où tout, soudainement, devient possible. La nostalgie de l'étudiant Anselme n'est pas le regret d'un passé situé à un quelconque point antérieur de l'histoire humaine, c'est, au sens propre, une nostalgie de l'inconnu et de l'inouï. Hanté par la nostalgie, Anselme va à la conquête de formes nouvelles et de neuves harmonies: telle est l'inquiétude de l'intellectualité musicale qui, semblable au désir amoureux, ne connaît qu'une soif que seule comble une soif nouvelle.
Il n'est pas indifférent de constater que, distribuée en veilles,- qui sont autant de défis à l'ensommeillement de la pensée dans l'illusion de la vie ordinaire,- la poursuite initiatique et amoureuse que relate Le Vase d'Or, débute sous un arbre, en l'occurrence un sureau, dont la moelle légère fut évoquée, par André Breton, dans un poème de Clair de terre. Ainsi que le soulignent les études de René Guénon et de Mircéa Eliade, l'Arbre fut souvent identifié à l'axe du monde, lieu par excellence du passage entre les différents états de la conscience et de l'être. Or, l'expérience visionnaire d'Anselme sous le sureau rejoint, dans son illumination arborescente, ce symbolisme du passage et de l'axe du monde. Le caractère impérieux et fulgurant de la vision et l'embrasement de la conscience qui en résulte, montrent que l'arbre est habité par une puissance électrique, annoncée par les bruissements lumineux, dont le surgissement va littéralement transmuter la conscience de l'étudiant. « Cependant, écrit René Guénon, on pourrait se demander si le rapprochement ainsi établi entre l'arbre et le symbole de la foudre, qui peuvent sembler à première vue être deux choses fort distinctes, est susceptible d'aller encore plus loin que le seul fait de cette signification axiale qui leur est manifestement commune; la réponse à cette question se trouve dans ce que nous avons dit de la nature ignée de l'Arbre du monde, auquel Agni lui-même est identifié dans le symbolisme védique, et dont, par suite, la colonne de feu est un exact équivalent comme représentation de l'axe. Il est évident que la foudre est également de nature ignée et lumineuse; l'éclair est d'ailleurs un des symboles les plus habituels de l'illumination au sens intellectuel ou spirituel. L'Arbre de Lumière dont nous avons parlé traverse et illumine tous les mondes; d'après le passage du Zohar, cité à ce propos par A. Coomaraswamy, l'illumination commence au sommet et s'étend en ligne droite à travers le tronc tout entier; et cette propagation de la lumière peut facilement évoquer l'idée de l'éclair. Du reste, d'une façon générale, l'Axe du monde est toujours regardé plus ou moins explicitement comme lumineux... »
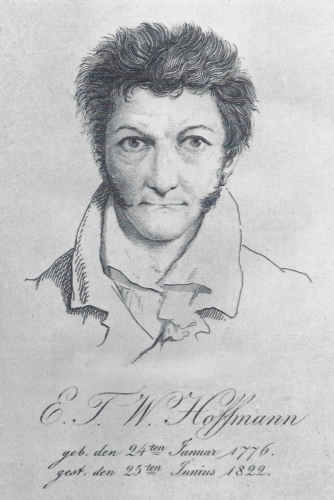
Illuminateur, le passage donne accès à un monde dont les configurations mobiles évoquent une partition symbolique. Les symboles, dans le récit, se répondent les uns aux autres. Chaque chose est le répons musical et mythique d'une autre. Hoffmann ne cite pas en vain Swedenborg, théoricien et visionnaire d'un univers de correspondances où les mondes se superposent infiniment dans l'Invisible. La responsabilité qui incombe aux personnages est de répondre à ces configurations imprévisiblement nouvelles qui naissent de l'identité mythique des personnages. « La précision mythique, écrit Ernst Jünger, est autre que celle de l'histoire. Elle lui est opposée pour autant qu'elle ne se fonde pas sur l'univocité mais sur la pluralité d'interprétations des faits. La personnalité historique est déterminée par une origine, une biographie, une fin. La figure mythique, au contraire, peut avoir plusieurs pères; plusieurs biographies, peut être tout à la fois dieu et homme, être à la fois morte et vivante, et toute contradiction, pour autant qu'elle soit réelle, ne fera qu'en accroître la netteté. Elle est amoindrie, enchaînée par le repérage historique. Son signe distinctif est qu'elle revient du fond de l'intemporel. »
Loin de contredire à cette dimension mythique, l'ironie, que Novalis tenait pour l'une des précellentes vertus romantiques, en réaffirme le pouvoir d'incertitude créatrice. L'ironie romantique, en effet, ne se réduit pas au ricanement. Elle se rapporte à la nature amphibolique de la réalité. L'euphorie du poète, son allégresse, sa légèreté riante,- qui entraînent le récit au-delà de la tragédie et du malheur,- proviennent de cette ironie essentielle selon laquelle ce qui est dit énonce autre chose qu'il n'y paraît. L'ironie romantique n'est pas l'expression d'un scepticisme ordinaire; elle est, au vrai, un moyen de connaissance accordé à l'intellectualité musicale que l'ambiguïté des choses, leur dualitude, exalte. Loin d'être mise en échec par l'amphibolie du réel, l'intellectualité musicale y trouve le principe de ses développements. Le ton de l'ironie, qui parcourt le récit du Vase d'Or, confirme la vérité mythique et symbolique car, dans le Mythe, le personnage est autre qu'il n'y paraît et le symbole toujours renvoie à son autre part, ainsi qu'en témoigne l'étymologie du mot. Ainsi les choses peuvent se changer les unes en les autres car elles sont déjà les unes dans les autres; le répons de l'autre est dans l'une, toujours la même et autre ironiquement, dans la plus entraînante joie musicale.
Luc-Olivier d’Algange
08:59 Publié dans Littérature, Musique, Musique, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, e. t. a. hoffmann, réalisme fantastique, musique, musicalité, philosophie, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, allemagne, romantisme, luc-olivier d'algange |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 31 juillet 2020
Luc-Olivier d'Algange: Entretien avec Anna Calosso sur "L'âme secrète de l'Europe"

Luc-Olivier d'Algange: Entretien avec Anna Calosso sur "L'âme secrète de l'Europe"
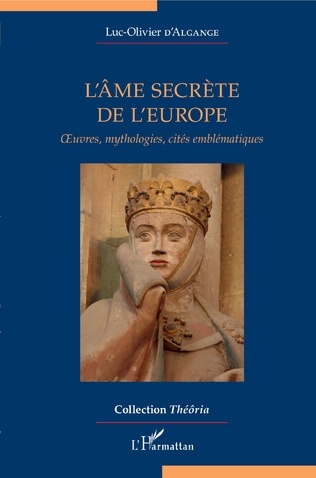 Anna Calosso : Vous venez de faire paraître un fort beau livre, au titre particulièrement évocateur pour nous, L'Ame secrète de l'Europe, dans la collection Théôrià, aux éditions de L'Harmattan, et je serais tentée de vous demander d'emblée : Qu'est-ce qu'une âme ? Et l'Europe, selon vous, a-t-elle encore une âme ?
Anna Calosso : Vous venez de faire paraître un fort beau livre, au titre particulièrement évocateur pour nous, L'Ame secrète de l'Europe, dans la collection Théôrià, aux éditions de L'Harmattan, et je serais tentée de vous demander d'emblée : Qu'est-ce qu'une âme ? Et l'Europe, selon vous, a-t-elle encore une âme ?
Luc-Olivier d'Algange : Avant de répondre directement à votre question, ou plus exactement à vos deux questions, aussi fondamentales l'une que l'autre, permettez-moi de dire quelques mots à propos de la collection où il vient de paraître, dirigée par Pierre-Marie Sigaud, nommée Théôrià. Cette collection, qui prend la suite de la collection Delphica des éditions de L'Age d'Homme, publie, depuis deux décennies, des œuvres, philosophiques et métaphysiques, qui relèvent de ce que l'on a nommé la sophia perennis . Citons, parmi les auteurs, Frithjof Schuon, Jean Borella, Jean Hani, Marco Pallis, Gilbert Durand, Françoise Bonardel, Patrick Laude ou encore Paul Ballanfat, dont un livre tout récent présente l'oeuvre de Yunus Emre, poète majeur, dont l'oeuvre poétique vient également de paraître dans cette collection.
Si l'on considère la pensée dominante, y compris dans ses aspects en apparence contradictoires, force est de reconnaître que nous sommes pris en tenaille entre le nihilisme relativiste, d'une part, et des formes de religiosités fondamentalistes, légalistes ou moralisatrices d'autre part. Entre l'homme-machine et le dévot narcissique et vengeur, entre un matérialisme et un spiritualisme (qui, soit dit en passant, obéissent également à une logique managériale), bien peu d'espace nous reste, tant et si bien que nous vivons dans un monde où nous ne respirons guère, où les souffles sont courts, où les pensées sont étroitement surveillées, où le débat intellectuel se réduit à l'accusation et à l'invective. D'où l'importance de ce corpus rassemblé sous le nom de Théôria,- mot qui veut dire contemplation, et qui redonne sa primauté à l'herméneutique, l'art de l'interprétation, l'expérience intérieure, mais avec précision et exigence, loin du fatras New Age et des « spiritualités » interchangeables ou touristiques.
Voici donc pour le paysage, où je suis heureux de me retrouver, et dans lequel le mot âme, bien sûr, vient tout de suite à l'esprit. L'expression « venir à l'esprit », au demeurant, n'est pas fortuite. L'âme, pour sortir de la sa gangue, a besoin de l'esprit. De même, que serait un esprit qui serait totalement détaché de l'âme, d'un esprit sans souci de l'âme, sinon une pure abstraction ? Une chose détachée, une chose sans cause, un pur néant.
Qu'est que l'âme ? L'âme est ce qui anime, et je serais tenté de dire, avec Jean-René Huguenin, que ce n'est pas l'âme qui est dans le corps mais le corps qui est dans l'âme. L'âme est inspir et expir, elle n'est point un épiphénomène, elle n'est pas subjective ; si intérieure qu'elle soit, c'est elle qui nous donne accès à la grande extériorité, au cosmos lui-même. Infime iota de lumière incréée dans le noir de la prunelle, elle est ce qui resplendit, la lumière sur l'eau, « la mer allée avec le soleil » dont parle Rimbaud.
Quant à la seconde partie de votre question, le titre même de l'ouvrage, donne la réponse. L'âme de l'Europe est devenue secrète. Elle existe, mais inapparente et lorsqu'elle semble apparaître, ici ou là, dans les vestiges visibles du passé, sa statuaire par exemple, ou ses œuvres contemporaines, elle est insultée, bafouée, conspuée, ou tout simplement ignorée. Cependant, le secret, dans sa modalité, n'est pas seulement un refuge, un retrait, une clandestinité, mais aussi, de par l'étymologie même du mot, un recours au sacré. Secrète, l'âme de l'Europe, n'est pas moins vive. Peut-être même pouvons-nous comprendre cette clandestinité comme une sorte de « mise-en-abyme » héraldique , la possibilité d'une récapitulation salvatrice. L'âme disparaît des apparences pour se tenir en éveil dans l'Apparaître.

Un chapitre du livre évoque cette possibilité : « Les dieux, ceux qui apparaissent ». Pour qu'une chose apparaisse, il faut qu'au préalable elle soit cachée, en attente, en puissance. Il n'est si grand hiver, qui, vers sa fin, ne laisse éclater les graines qui survivaient sous sa glace. Tout désormais, pour ceux qui sont attachés à la grande culture européenne, est affaire de survie. Or, lorsqu'elle est menacée, la survie devient métaphysique. Elle passe de l'immanence à la transcendance, elle se retourne vers son origine et sa fin dernière. Elle devient une lisière entre l'être et le néant, une expérience « gnostique » non au sens de la « gnose qui enfle », de la prétention intellectuelle, mais au sens d'une humilité nécessaire. Lorsque plus rien ne semble tenir, que tout s'effondre, et que l'horizon indépassable du « progrès » semble être un champs de ruines ou, pire encore, une réalité faussée, virtuelle, clonée, « zombique », nous devons retrouver le sens de la terre, de l'humus.
Vous avez remarqué qu'à intervalles régulier nos ordinateurs nous demandent de prouver que nous ne sommes pas des robots. Les preuves à l'appui seront, je gage, de plus en plus en plus difficiles à fournir, puis inutiles. Nous sommes intimement modifiés par les instruments que nous utilisons et par notre façon de les utiliser. En littérature, cette façon se nomme le style. Mais la littérature qui exige le silence, l'attente, la patience, la temporalité profonde, est elle-même menacée par l'ère du « clic » et du « toc » où nous sommes déjà entrés. Voyez la morale, qui fut autrefois l'objet de tant de réflexions et de passion, voyez ce qu'elle est est devenue : une chose binaire, manipulable, destructrice et d'une crétinerie sans nom, voire, pour filer la métaphore, une sorte de TOC, autrement dit un trouble obsessionnel compulsif. La morale qui fut l'objet de l'attention patiente des stoïciens, des théologiens, de Spinoza, de Montaigne, de Pascal, est devenue une forme de pathologie qui menace de tout ravager sur son passage, à commencer par la littérature, - non seulement la littérature « mal-pensante », mais la littérature en soi, autrement le langage qui n'est pas exclusivement au service d'une utilité ou d'une efficience immédiate.
 Anna Calosso : La comparaison vous paraîtra peut-être étrange, mais à lire votre livre, j'ai pensé à l'ouverture du Lohengrin de Richard Wagner. J'ai perçu là une musique, des nappes sonores, des orchestrations, des « leitmotives », comme si, en évoquant, tour à tour Nietzsche et Venise, la pensée grecque, des présocratiques à Plotin, Novalis et les romantiques allemands, l'alchimie du poème, vous vous étiez donné pour dessein de dire l'aurore attendue à travers le crépuscule : une aurore européenne, belle comme la statue de Uta von Ballenstedt qui figure sur la couverture de votre livre.
Anna Calosso : La comparaison vous paraîtra peut-être étrange, mais à lire votre livre, j'ai pensé à l'ouverture du Lohengrin de Richard Wagner. J'ai perçu là une musique, des nappes sonores, des orchestrations, des « leitmotives », comme si, en évoquant, tour à tour Nietzsche et Venise, la pensée grecque, des présocratiques à Plotin, Novalis et les romantiques allemands, l'alchimie du poème, vous vous étiez donné pour dessein de dire l'aurore attendue à travers le crépuscule : une aurore européenne, belle comme la statue de Uta von Ballenstedt qui figure sur la couverture de votre livre.
Luc-Olivier d'Algange : Je vous avoue n'y avoir pas songé, mais la façon dont vous en parlez donne à la comparaison une pertinence qui va,sans tarder, me porter à réécouter cette ouverture... Je vous avoue cependant que ces derniers temps j'ai davantage écouté du Debussy et du Ravel, voire du Nino Rota, que du Wagner. Mais vous avez sans doute raison, et Debussy fut aussi, peut-être, à sa façon, un « anti-wagnérien » wagnérien. Enfin, je vous dirai qu'entendre un livre comme de la musique, entendre la musique sur laquelle reposent les phrases, est sans doute la meilleure façon de lire, et peut-être la seule. Il n'est rien de plus navrant que ces lecteurs qui, dans un livre, se contentent de collecter les informations, des opinions, à partir desquelles ils se forgeront des avis ou des opinions, en accord ou en contradiction avec ceux du livre, peu importe. Ils seront passés à côté de ce dont naquirent les phrases ; ils seront passés à côté de l'auteur, et, ce qui est plus grave, des paysages et des figures aimées. Nous écrivons toujours avec toutes nos Muses. Les écrivains sont tous des plagiaires, - mais ce qu'ils tentent de plagier, ce n'est que malencontreusement d'autres livres. Le bon défi, en écrivant, est de tenter de plagier Scarlatti ou John Coltrane, ou encore un bruissement de feuillage ou son enchevêtrement, la neige qui tombe, la rugosité de l'écorce, la fugacité de la luciole, et les vagues, bien sûr, les vagues en leur triple mouvement. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas une seule façon de bien écrire, mais d'infinies, allant de l'évidence immobile du galet sur la plage jusqu'aux bouleversements des nuages par temps d'orage.
Anna Calosso : Cependant votre livre, si grande que soit l'importance que vous attachez à la poésie, est aussi un livre polémique, et, si j'ose dire, une sorte de « défense et illustration » de la culture européenne dans son identité profonde. Comment pourriez-vous formuler rapidement la thèse défendue?
Luc-Olivier d'Algange : Le mot « thèse » me semble inadéquat, cela supposerait une anti-thèse et une synthèse. Mon dessein est plus modeste et plus improvisé. J'obéis à des admirations, - et toutes, loin de là, ne figurent pas dans cet ouvrage... Ce livre est peut-être né du sentiment que tout conjure, aujourd'hui plus jamais, à nous faire passer à côté de la beauté des êtres et des choses. L'Europe n'est pas seulement un territoire, un ensemble de langues et de peuples plus ou moins apparentés ; elle fut aussi une possibilité de l'esprit et des corps, une réfraction particulière du monde. Qu'elle disparaisse, et ce sont des aspects de l'entendement humain qui disparaîtront, des styles, des exactitudes et des abandons, des mythes et des symboles, des inquiétudes et des aventures, des métaphysiques contradictoires, mais aussi des coutumes, des rites populaires ou aristocratiques . C'est vous dire que je ne crois aucunement en l'Europe économique ou technocratique, mais en la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal etc... Que se passe-t-il quand nous nous promenons à Paris ou à Venise, dans un village de Provence ou de l'Aveyron, quelles pensées nous viennent sur le quai du Tounis à Toulouse, ou sur le bord du Tage à Lisbonne, ou encore au Temple de Delphes, - ou tout simplement dans une forêt, sur la chemin de campagne, sur la terrasse d'un bistrot ? L'esprit des lieux, toujours, est plus grand que nous. Une certitude nous en vient : nous nous devons à ce qui est plus grand que nous, au choeur des voix qui se sont tues dont parlait Péguy, à notre langue, au Logos qui est Roi. Les grands bonheurs sont des réminiscences.

Anna Calosso : Mais qu'en est-il alors du présent, du bonheur présent ?
Luc-Olivier d'Algange : Le bonheur du présent est de devenir présence par l'afflux de la réminiscence, par les dons reçus et honorés. Il n'est pire malheur que l'amnésie ou le reniement. L'enfer sur terre a toujours été instauré par les adeptes de la table rase. Ceux-ci, remarquons-le, ne désarment pas. A peine sommes-nous remis d'un de leurs désastres programmés que les voici de nouveau à la tache, traquant, surveillant, lynchant sans relâche, honnissant leur passé et s'exaltant narcissiquement de leur présent, lui trouvant toutes sortes de vertus, et se croyant l'incarnation du Bien. A chaque homme de grande mémoire qui disparaît, notre vie s'abaisse d'un cran ; elle devient plus ennuyeuse, plus mesquine, plus calculatrice, et, en tout, plus misérable. Notre langue est notre mémoire : elle nous dit ce que nous fûmes et ce que nous pourrions être. Aussi bien s'acharne-t-on à la défigurer, à en rendre l'usage presque impossible, avec l'écriture inclusive, l'approximation, le jargon, une syntaxe effondrée, mais aussi, et surtout, un appauvrissement du vocabulaire, une uniformisation du propos autorisé, - si bien que certaines choses ne peuvent, tout simplement plus être dites. Les quelques « puristes » de la langue qui demeurent, hélas, n'y changeront rien. Tout au plus feront-ils quelques livres aimables dans un style « néo-hussard », où Blondin, Nimier, ou Jacques Laurent, certes, ne reconnaîtraient point leurs petits. Le mal est en amont. Il est dans l'expérience intérieure, l'espace intérieur. Qu'en est-il du « champs du possible » qu'évoquait Pindare ? Qu'en est-il de nos sensations à fleur de peau et des plus hautes spéculations de l'Intelligible, - au sens platonicien. Qu'en est-il de l'espace entre les deux, ce monde « imaginal » selon le néologisme de Henry Corbin, d'où apparaissent les symboles, les mythes, les épiphanies ? Qu'en est-il de l'aventure humaine ?

Anna Calosso : Vous écoutant, il me vient naturellement à l'esprit le nom de Gabriele D'Annunzio, auquel un des chapitres de votre livre est consacré. Un regret cependant, vous n'y retracez pas la fameuse équipée de Fiume, dont vous aviez parlé dans une excellente émission de radio en compagnie de Didier Carette.
Luc-Olivier d'Algange : Fiume sera présente dans un prochain livre qui porte sur le refus de la servitude volontaire. Ce fut, en effet, une aventure extraordinaire, échappant à toutes les idéologies, un exercice pratique de liberté conquise. J'y reviendrai. J'étais particulièrement heureux de l'évoquer avec Didier Carette, - qui sait particulièrement bien ce que c'est qu'être acteur, - au sens étymologique du terme. Au commencement était l'action, disait Goethe. Qu'est-ce que l'agir, qu'est-ce que la pensée ? Heidegger creuse admirablement la question. Nous croyons penser alors que nous ne pensons pas encore ; nous calculons, nous classons, nous évaluons, nous ratiocinons, mais nous ne pensons pas encore. Nous construisons des systèmes, nous inventons des orthopraxies, mais nous ne pensons pas. Il en est de même de l'action : nous nous affairons, mais l'essence de l'agir nous échappe. Le monde politique est la scène de ces actions vides, qui n'existent que par la représentation qu'elle se donnent d'elle-mêmes, - qui est flatteuse, qui n'est même que flatterie. Rien ne se fait vraiment : nos contemporains en sont flattés. Il y a des écoles de flatterie, de flagornerie, c'est une science : selon que le vent souffle, bien reconnaître le sens du poil. Un bon politicien reconnaît le sens du poil du Gros Animal dont il voudra se servir pour ne rien faire. D'où l'importance des poètes, du poien, et D'Annunzio en eut la plus haute conscience. La vie, dont il écrivit l'éloge, il la voulut, en disciple de Pindare, magnifique. Célébrer le passé afin que l'avenir revienne vers nous, ne rien renier, et tout vouloir hausser à une plus haute intensité, aimer d'un amour égal la douceur de la vie et la tragique de la mort. Sa devise est parfaite : « J'ai ce que j'ai donné ».
Anna Calosso : Quant-à-vous, cher Luc-Olivier, vous nous avez donné un beau livre, dont nous n'avons évoqué ici qu'une infime partie. Mais j'invite nos lecteurs à voyager avec vous dans le songe de Pallas-Athéna, d'entendre « le beau murmure des sages abeilles du pays », de méditer sur « la légère et infinie trame du monde », de divaguer au bord de lllissos, du Tage et de la Garonne, dans l'Allemagne d'Hölderlin, ou de Jacob Böhme, dans monde des visionnaires néoplatoniciens et des Alchimistes, « entre Albe et Aurore ». Rarement l'image de l'Attelage Ailé ne m'a semblé plus juste. Une dernière question. Dans votre hommage à Stefan George vous écrivez « La poésie est un combat ». Qu'en est-il du combat aujourd'hui ? Contre qui ou contre quoi faut-il se battre ?

Luc-Olivier d'Algange : Stefan George est un poète qui me tient à cœur. Il est tout ce que ce monde, - tantôt nihiliste malin, tantôt fondamentaliste obtus – n'est plus. Ludwig Lehnen disait de l'oeuvre de Stefan George qu'elle était un « contre-monde ». Solennelle, mais pour inviter à la légèreté de l'être ; mystérieuse mais pour donner accès au mystère de la limpidité ; aristocratique, mais par générosité. Ce « contre-monde » est l'enfance continuée. Sa langue est là, mallarméenne à certains égards, pour dire ce que nous ressentions avant de pouvoir le dire, avant l'adultération, la ratiocination, la banalité despotique.
La poésie est un combat contre le prosaïque, - elle est un combat pour la sauvegarde de ses propres sources intérieures . Le combat n'est pas idéologique, ni politique au sens actuel du terme, - qui se réduit à trouver un poste, - mais de chaque instant... A chaque instant, il nous donné de ternir ou de faire resplendir le monde. Il ne suffit plus d'être intelligent, de manier des concepts ou d'être maître dans l'art du sarcasme : il faut, comme disait Novalis « poétiser le réel ». Chacun sait, par intuition, que la vie ne suffit pas. Il faut faire danser les images et les mots en tarentelles dionysiaques... ou comme le proclamait D'Annunzio, à Fiume, aux derniers jours de l'aventure, danser une dernière fois devant la mer, aux lueurs des feux, avant la fin du rêve.
13:53 Publié dans Entretiens, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, livre, tradition, europe, mythe européen, âme européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 05 juin 2020
Le Pays d’Henri Bosco
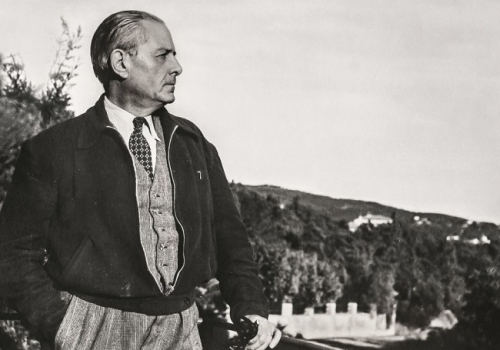
Luc-Olivier d’Algange:
Le Pays d’Henri Bosco
Le Pays d’Henri Bosco appartient à quiconque se souvient de son enfance, à ces temps d’avant le temps, in illo tempore, antérieurs à l’expropriation, à l’adultération, à l’exil. La phrase d’Henri Bosco ne dit pas seulement les êtres et les choses, elle les convoque, elle œuvre, en exorciste, en sourcier, à l’éveil de puissances impondérables, c’est à dire livrées à l’éveil de l’air, à « l’air de l’air » dont parle l’Epître d’Aristée, « ces grandes odeurs sauvages qu’exhalent les arbres dans leur solitude », cet éther qui est au cœur des éléments comme leur source vive, leur intensité la plus subtile. Si le monde moderne désaltère notre soif cruelle par la source du Léthé, au point de nous laisser oublieux de notre oubli même, artificieusement protégés du ressac des réminiscences (c’est-à-dire du bonheur et du malheur, de la tragédie et de la joie) les romans d’Henri Bosco s’abreuvent et nous abreuvent de la source de Mnémosyne qui éveille en nous les résonances de ces divinités du dehors, de ces dieux qui adviennent avec une torrentueuse fraîcheur de la profondeur des temps.
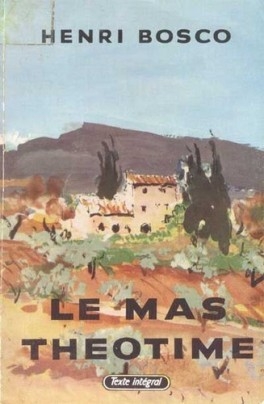 Toute œuvre romanesque qui ne se réduit pas à l’anecdote ou à de vaines complications psychologiques instaure un autre rapport au temps, s’inscrit dans une météorologie et une chronologie légendaires où l’homme cesse d’être à lui-même la seule réalité. Voici le ciel, la terre, et cette mémoire seconde, qui affleure, et qui porte les phrases ; voici cette rhétorique profonde, sur laquelle les phrases reposent comme sur une houle et vont porter jusqu’à nous, jusqu’aux rives de notre entendement, des mondes chiffrés, que notre intelligence déchiffre comme des énigmes, sans pour autant les expliquer. Ainsi les romans d’Henri Bosco nous laissent dans le suspens, dans une aporie, une attente, une attention extrêmes aux variations d’ombre et de lumière, aux états d’âme qui n’appartiennent pas seulement aux sentiments humains mais au monde lui-même, à ce Pays qui n’est pas seulement une réalité administrative ou départementale mais un don, une civilité, un commerce entre le visible et l’invisible, - le don d’une autre temporalité qui nous fait à jamais insolvables des bienfaits reçus.
Toute œuvre romanesque qui ne se réduit pas à l’anecdote ou à de vaines complications psychologiques instaure un autre rapport au temps, s’inscrit dans une météorologie et une chronologie légendaires où l’homme cesse d’être à lui-même la seule réalité. Voici le ciel, la terre, et cette mémoire seconde, qui affleure, et qui porte les phrases ; voici cette rhétorique profonde, sur laquelle les phrases reposent comme sur une houle et vont porter jusqu’à nous, jusqu’aux rives de notre entendement, des mondes chiffrés, que notre intelligence déchiffre comme des énigmes, sans pour autant les expliquer. Ainsi les romans d’Henri Bosco nous laissent dans le suspens, dans une aporie, une attente, une attention extrêmes aux variations d’ombre et de lumière, aux états d’âme qui n’appartiennent pas seulement aux sentiments humains mais au monde lui-même, à ce Pays qui n’est pas seulement une réalité administrative ou départementale mais un don, une civilité, un commerce entre le visible et l’invisible, - le don d’une autre temporalité qui nous fait à jamais insolvables des bienfaits reçus.
Ni roman psychologique, ni roman formaliste, ni roman engagé, ni roman naturaliste, le roman d’Henri Bosco échappe à ces dissociations nihilistes qui posent l’intelligence humaine face aux mondes comme expérimentatrice. Ce temps dans lequel nous entrons, ce temps du Pays, cette « rondeur des jours » comme l’eût dit Giono, n’est pas une expérience, mais une relation, une alliance ; non plus une subjectivité face aux autres et aux choses, y cherchant une explication, mais une implication, un échange, une porosité : mise en relation de l’âme humaine et de l’Ame du monde. Discrète, l’œuvre échappe à cette arrogance qui n’est jamais que l’envers d’un grief à l’égard de ce qui est, mais dans cette humilité même, dans ce consentement à recevoir débute une aventure prodigieuse qui nous fait revivre l’ontogenèse et la phylogenèse, jusqu’à cette fine pointe, ce moment de la conscience extrême où la conscience s’abolit, où nous devenons, selon la formule de Rimbaud, le « lieu et la formule ». L’œuvre chemine ainsi sur la beauté de la terre vers un doux resplendissement de phrases qui disent plus qu’elles en décrivent, qui nomment, mais en laissant aux noms la chance de refermer sur eux une part de nos propres songes et de nous rendre comme hors d’atteinte de nous-mêmes. Rien d’insolite cependant dans ces récits, puisque tout y est relié, en résonance, en échos ; les personnages approchent par détours, chemins de traverses, non pas vers la résolution d’une intrigue, vers une victoire sur des forces adverses humainement définies, mais vers un moment, une heure, qui est une victoire sur l’insignifiance et sur l’oubli.
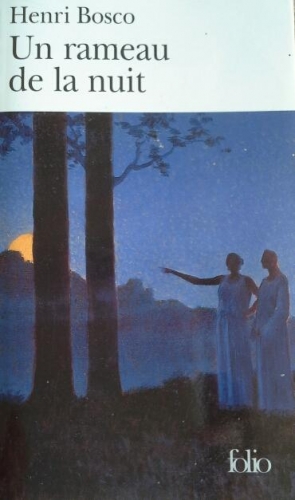 L’œuvre d’Henri Bosco est, comme toutes les grandes œuvres de notre littérature, une pensée en action, mais en accord avec l’étymologie même du mot pensée, qui évoque la juste pesée, ces rapports et ces proportions où la part de l’inconnu n’est pas moins grande que la part connue ; où la part de la nuit détient les secrets de la lumière provençale. Œuvre nocturne mais non point ténébreuse ou opaque, louange des nuits lumineuses, des ombres qui sauvegardent, du haut jour qui tient sa vérité comme le secret d’une plus haute clarté encore, l’œuvre d’Henri Bosco sauve les phénomènes de la représentation abstraite que nous nous en faisons, et nous sauve nous-mêmes de nos identités trop certaines qui nous enferment dans une humanité irreliée à l’ordre du monde, détachée de la sagesse profonde de la nuit foisonnante de toutes les choses vivantes qui tendent vers la lumière ou en reçoivent les éclats. « Je pus ainsi, écrit Henri Bosco, me replacer sans peine devant le décor intérieur où j’avais regardé ma propre nuit en train de descendre sur moi cependant qu’au-dessus de moi dans le ciel s’avançait la nuit sidérale ».
L’œuvre d’Henri Bosco est, comme toutes les grandes œuvres de notre littérature, une pensée en action, mais en accord avec l’étymologie même du mot pensée, qui évoque la juste pesée, ces rapports et ces proportions où la part de l’inconnu n’est pas moins grande que la part connue ; où la part de la nuit détient les secrets de la lumière provençale. Œuvre nocturne mais non point ténébreuse ou opaque, louange des nuits lumineuses, des ombres qui sauvegardent, du haut jour qui tient sa vérité comme le secret d’une plus haute clarté encore, l’œuvre d’Henri Bosco sauve les phénomènes de la représentation abstraite que nous nous en faisons, et nous sauve nous-mêmes de nos identités trop certaines qui nous enferment dans une humanité irreliée à l’ordre du monde, détachée de la sagesse profonde de la nuit foisonnante de toutes les choses vivantes qui tendent vers la lumière ou en reçoivent les éclats. « Je pus ainsi, écrit Henri Bosco, me replacer sans peine devant le décor intérieur où j’avais regardé ma propre nuit en train de descendre sur moi cependant qu’au-dessus de moi dans le ciel s’avançait la nuit sidérale ».
Le Pays d’Henri Bosco nous est d’autant plus proche, plus intime, qu’il se trouve loin des clichés folkloriques, régionalistes ou touristiques. Il n’y a là rien à visiter, à photographier, à revendiquer ou à vendre. Par le récit, qui est une légende, autrement dit, par ce qui se donne à lire sur la page et qui n’est que la réverbération de ce qui se donne à lire dans le paysage (de cette écriture du monde, en striures d’écorces, en tumultes fluviaux, en nervures, en corolles, en nuées), au Pays est restitué son règne, cette autorité douce et impérieuse, empreinte visible d’un sceau invisible. Si le Pays règne, s’il est une royauté des arbres, une royauté du feu et de la pierre, s’il est une souveraineté des hommes, c’est-à-dire une liberté d’allure, un « privilège immémorial de la franchise » comme on le disait naguère des hommes de France, c’est dans la vive intelligence qui se trouve, comme soudain se lèvent une nuée d’oiseaux, après s’être longtemps cherchée, enracinée en même temps dans la terre et dans le ciel, dans un « être là », une présence qui existe, qui rayonne dans son existence, et témoigne d’un privilège insigne : celui qui revient à préférer ce qui est à ce qui n’est pas.
On s’aperçoit alors que les grands songes d’Henri Bosco sont exactement le contraire des utopies qui dédaignent l’être au profit du néant et prétendent échapper au tragique par le désenchantement. Or le règne de la technique globalisée, commence à nous apprendre, et assez brutalement, que les désenchanteurs sont les pires sorciers, - de même que les puritains sont les plus radicaux ennemis de la pureté, c’est à dire du feu, pyros, qui arde et transfigure. La réalité, même la plus réduite, n’est jamais aussi plate, aussi planifiable que le voudraient les idéalistes du tiers-état, et leurs idéologues, vigilants « désenchanteurs » qui crurent que le désenchantement du monde était nécessaire à la raison humaine. Grossière erreur que nous continuons à payer par la dissolution progressive du monde réel en monde virtuel, mais d’une virtualité pour ainsi dire nulle, c’est-à-dire offerte, par son vide, au démon de la défiguration. D’où l’importance de ces personnages qui, dans les romans d’Henri Bosco, adviennent comme à l’impourvue, et dont il nous parle comme si nous les connaissions déjà car ils sont précisément des figures que le récit transfigure.
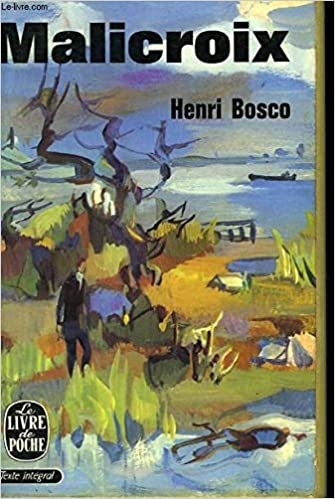 Rien de muséologique dans ce Pays qui est une réalité antérieure autant qu’un « vœu de l’esprit », selon la formule de René Char. Rien qui soit de l’ordre d’une représentation, d’une identité recluse sur elle-même, mais la pure et simple présence réelle qui ne s’éprouve que par la brusque flambée portée dans la rumeur du vent et dans l’amitié qui nous unit au monde, dans ces affinités dont nous sommes les élus bien plus que nous ne les choisissons. Ce qui nous est conté est un recours au cours de la tradition, de sa solennité légère, et non plus un discours ; une conversation et non pas une discussion, si bien que l’intelligence se laisse empreindre par les lieux qu’elle fréquente dans le temps infiniment recommencé de la promenade. C’est dans la connivence des éléments, de l’air, de l’eau, du feu et de la terre, en leurs inépuisables métamorphoses, que le temps se renouvelle et s’enchante au lieu de n’être que le signe de l’usure, d’une finalité malapprise, insultante au regard du libre cours qui conduit à elle.
Rien de muséologique dans ce Pays qui est une réalité antérieure autant qu’un « vœu de l’esprit », selon la formule de René Char. Rien qui soit de l’ordre d’une représentation, d’une identité recluse sur elle-même, mais la pure et simple présence réelle qui ne s’éprouve que par la brusque flambée portée dans la rumeur du vent et dans l’amitié qui nous unit au monde, dans ces affinités dont nous sommes les élus bien plus que nous ne les choisissons. Ce qui nous est conté est un recours au cours de la tradition, de sa solennité légère, et non plus un discours ; une conversation et non pas une discussion, si bien que l’intelligence se laisse empreindre par les lieux qu’elle fréquente dans le temps infiniment recommencé de la promenade. C’est dans la connivence des éléments, de l’air, de l’eau, du feu et de la terre, en leurs inépuisables métamorphoses, que le temps se renouvelle et s’enchante au lieu de n’être que le signe de l’usure, d’une finalité malapprise, insultante au regard du libre cours qui conduit à elle.
Les romans d’Henri Bosco sauvegardent, mais comme par inadvertance ou irrécusable évidence, cette teneur du temps, ce palimpseste léger où le grand-large de l’âme s’ouvre à chaque instant. Le Pays est cette évidence et ce mystère d’un temps qui est à l’intérieur du temps comme l’amande vive sous son écorce, un Pays où l’on renaît à soi-même : un Pays tellurique et sidéral, un Pays littéralement inconnu et dont la gloire est d’emporter dans son torrent ce que nous imaginions connaître.
Le Pays d’Henri Bosco devient ainsi le lieu d’une conversion du regard, d’une réconciliation du Mythe et du Logos. L’espace-temps du roman oscille, en vases communicants, entre la réalité et le rêve, comme l’est le Pays lui-même avec celui qui en est l’hôte au double sens du mot, celui qui reçoit et celui qui est reçu. Nous comprenons alors que le Pays nous habite, et qu’en voyageant en lui, nous voyageons en nous-mêmes,- voyage intérieur qui est un voyage vers l’intérieur, c’est à dire vers « l’extériorité véritable », comme l’écrivait Novalis, vers la source du Temps. Nous voyageons vers ce qui est déjà là, vers ce que nous sommes, sans pleinement le savoir. La nuit des romans d’Henri Bosco, est la source d’un jour qui rêve. « D’ordinaire, je rêve peu, écrit Henri Bosco, du moins la nuit. C’est dans la journée que me viennent mes songes, et ils disparaissent plutôt vers le soir. Aussi, cette nuit là n’eus-je pas d’autre rêve que ce sentiment. Je l’éprouvais sans qu’il s’y glissât le rappel des personnages, des événements pourtant singuliers, dont j’avais fait depuis le matin la rencontre. Je ne fus plus qu’un état d’âme ».

Or cette flottaison, cette indétermination, n’est autre que le Réel dans ses possibilités infinies, l’enfance, ce silence d’avant le langage que le poète traduit, l’enfance qui perdure, toute-possibilité accordée au ciel, au fleuve, à la pierre de nous faire signe, d’entrer, ou, plutôt de nous laisser entrer dans une conversation dont nous eussions été exclus si, par malheur, nous avions cédés à la misérable fiction du temps linéaire, d’un temps voulu entièrement vers un but précis, et dont nous eussions récusé l’hospitalité.
L’œuvre répond ainsi à la décisive mise en demeure hölderlinienne, « habiter en poète ». Le numineux, puissance sacrée à la fois inquiétante et enchanteresse ordonne chaque roman d’Henri Bosco. La réalité ne suffit pas au Réel, il y faut le songe qui est la réverbération, le halo de la réalité telle qu’elle se prolonge, musicienne, ou s’éploie dans ce « logos intérieur » qui se révèle à nous par étapes ou par « stations » successives, comme le savaient les mystiques soufis, ces Fidèles d’Amour, dont Henri Bosco, mais ce serait l’occasion d’une autre approche, fut proche à maints égards.
 Le temps qualifié, la géographie sacrée, les ressources secrètes des êtres et des choses singuliers, qui vont s’accordant avec les forces impersonnelles, ouvrent un espace, celui du roman, où le monde intérieur et le monde extérieur cessent d’être séparés par d’irréfragables frontières. Le soleil, le fleuve, les arbres, le vent, la nuit sont des présences sacrées car leur réalité symbolise avec une réalité plus haute, hors d’atteinte, que les phrases mélodieuses, selon la formule héraclitéenne, « voilent et dévoilent en même temps ». Entre le sensible et l’intelligible, entre la nuit profonde et l’éblouissante clarté, toutes les gradations s’emparent des songes, des effrois, des attentes ardentes des personnages devenus, par le génie romanesque, fabuleux instruments de perception des variations météorologiques. La vérité humaine est d’autant plus profonde et nuancée qu’elle est située, qu’elle cesse, par un suspens, de se référer exclusivement à elle-même. Les hommes ne sont humblement et souverainement présents que par ce partage de leur règne qu’ils consentent avec la terre et le ciel.
Le temps qualifié, la géographie sacrée, les ressources secrètes des êtres et des choses singuliers, qui vont s’accordant avec les forces impersonnelles, ouvrent un espace, celui du roman, où le monde intérieur et le monde extérieur cessent d’être séparés par d’irréfragables frontières. Le soleil, le fleuve, les arbres, le vent, la nuit sont des présences sacrées car leur réalité symbolise avec une réalité plus haute, hors d’atteinte, que les phrases mélodieuses, selon la formule héraclitéenne, « voilent et dévoilent en même temps ». Entre le sensible et l’intelligible, entre la nuit profonde et l’éblouissante clarté, toutes les gradations s’emparent des songes, des effrois, des attentes ardentes des personnages devenus, par le génie romanesque, fabuleux instruments de perception des variations météorologiques. La vérité humaine est d’autant plus profonde et nuancée qu’elle est située, qu’elle cesse, par un suspens, de se référer exclusivement à elle-même. Les hommes ne sont humblement et souverainement présents que par ce partage de leur règne qu’ils consentent avec la terre et le ciel.
Le Pays d’Henri Bosco n’est ainsi pas seulement une géographie, une histoire il est une autre dimension du temps, et c’est bien pourquoi l’auteur est d’abord romancier, exerçant au plus haut l’art du romancier qui est de créer une autre temporalité, ou, dans les cas les plus heureux, de révéler une temporalité plus réelle que celle à laquelle nous contraint une idéologie, devenue par cela même l’ennemie de la civilisation, fondée sur l’utilitarisme, c’est à dire sur le nihilisme. A ce nihilisme qui fige les êtres et les choses, sous éclairage artificiel, dans des identités plates dans relief ni ombrages, sans voiles ni révélations, Henri Bosco oppose, comme un recours, le frémissement immanent de l’eau auquel s’accorde le mouvement de ses phrases. Celles-ci ne disent pas seulement ce mouvement, cette incertitude fabuleuse, elles s’y accordent, mieux encore, elles en renouvellent la vérité dans le creuset de la réalité elle-même, dans son inscription héraldique. La tradition d’un Pays, le tradere est une rivière : « Les eaux, écrit Henri Bosco, m’inquiètent et m’attirent. Tout ce qui se passe dans leur voisinage prend fatalement à mes yeux je ne sais quoi d’irréel, un corps imaginaire. Les personnages, les événements les plus incontestables ne le sont que dans cette troublante lueur. »
 Contre la clarté monocorde, ennemie des ombres, Henri Bosco invoque non seulement le frémissement de l’eau, mais aussi le feu, là même où s’opère la coalescence de l’Eros et du Logos : « J’étais fasciné par le feu. Il pénétrait en moi, immobilisait mon cerveau sur une seule idée. Cette idée n’était qu’une braise… Terrible, mais si vive, si envahissante qu’elle ne soulevait aucune épouvante. J’étais devenu feu, corps de feu, cœur de feu, esprit-feu, et toute la forêt en flammes. Si l’incendie se fut propagé jusqu’à moi, je n’aurais pas fui, j’aurai attendu, embrassé le feu, et pris feu pour disparaître dans mon propre feu au milieu d’une gerbe d’étincelles. »
Contre la clarté monocorde, ennemie des ombres, Henri Bosco invoque non seulement le frémissement de l’eau, mais aussi le feu, là même où s’opère la coalescence de l’Eros et du Logos : « J’étais fasciné par le feu. Il pénétrait en moi, immobilisait mon cerveau sur une seule idée. Cette idée n’était qu’une braise… Terrible, mais si vive, si envahissante qu’elle ne soulevait aucune épouvante. J’étais devenu feu, corps de feu, cœur de feu, esprit-feu, et toute la forêt en flammes. Si l’incendie se fut propagé jusqu’à moi, je n’aurais pas fui, j’aurai attendu, embrassé le feu, et pris feu pour disparaître dans mon propre feu au milieu d’une gerbe d’étincelles. »
Nul lecteur, plus que celui d’Henri Bosco (sinon peut-être celui de Gérard de Nerval) ne se trouve proche, en suivant le chemin de ses personnages, de cette beauté numineuse où la réalité s’inscrit et dont elle reçoit les puissances fécondantes. Les êtres et les choses ne sont pas ce qu’ils semblent être dans leurs représentations sécularisées, mais ce qu’ils sont, dans leurs toute-possibilité augurale… Mondes aux orées tremblantes comme des flammes où les circonstances, en apparence banales, deviennent emblématiques, chargées de ce magnétisme onirique qui rapproche ou éloigne les personnages les uns des autres, les laissant parfois dans une haute solitude, comme avant les marées, et leur intime l’ordre de consentir à ce qu’ils ne peuvent comprendre, mais sans y succomber.
Comment « habiter en poète », selon la formule d’Hölderlin, être là où nous sommes, exister dans le secret qui est l’immédiate évidence sensible elle-même ? De livre en livre, de chapitre en chapitre, de phrase en phrases, Henri Bosco nous rapproche du point à partir duquel les variations des états de conscience et d’être se recomposent avec les sollicitations du Pays, avec ce temps redevenu espace où l’âme s’éprouve et se disperse, s’enhardit à s’associer aux forces telluriques, aux rameaux de la nuit, - et de ces forces qu’elle reçoit retourne en son propre règne, en sa propre clarté d’entendement dont témoigne, au demeurant, le style d’une si belle, si naturelle, mesure classique d’Henri Bosco.
 Tel est peut-être un des secrets le mieux gardés de la littérature française, de sa tant et si mal vantée « clarté classique », de n’être, en sa beauté ordonnatrice, qu’un surgeon d’intuitions plus profondes et plus sauvages, où l’art du sourcier, l’oniromancie, viennent irriguer la plénitude des formes du jour. Ce qui distingue l’art romanesque d’Henri Bosco, son poiein, sa pensée en action, n’est peut-être rien d’autre le sens des contiguïtés, et l’on pourrait presque dire de la consanguinité, du monde du rêve et du monde de la réalité. Ce qui unit les personnages et leurs ombres, qui parfois semblent leur échapper, n’est pas de l’ordre de la nécessité ou du déterminisme, disposé en discours, mais bien de celui d’une recouvrance. Si , comme dans l’œuvre de Gérard de Nerval, le songe et la réalité en sont pas séparés ce n’est point par artifice littéraire, mais parce que dans la vision et la pensée d’Henri Bosco, ils ne se distinguent qu’en se graduant. Le rêve est la réalité d’un autre rêve, et notre songe humain des songes du Pays reçoit ses messages. Nous ne commençons à habiter véritablement les lieux, c’est-à-dire que nous n’en devenons les hôtes que si hôtes à notre tour, nous recevons les légendes qui sont dans l’arbre des mots, comme l’envers argenté des feuilles.
Tel est peut-être un des secrets le mieux gardés de la littérature française, de sa tant et si mal vantée « clarté classique », de n’être, en sa beauté ordonnatrice, qu’un surgeon d’intuitions plus profondes et plus sauvages, où l’art du sourcier, l’oniromancie, viennent irriguer la plénitude des formes du jour. Ce qui distingue l’art romanesque d’Henri Bosco, son poiein, sa pensée en action, n’est peut-être rien d’autre le sens des contiguïtés, et l’on pourrait presque dire de la consanguinité, du monde du rêve et du monde de la réalité. Ce qui unit les personnages et leurs ombres, qui parfois semblent leur échapper, n’est pas de l’ordre de la nécessité ou du déterminisme, disposé en discours, mais bien de celui d’une recouvrance. Si , comme dans l’œuvre de Gérard de Nerval, le songe et la réalité en sont pas séparés ce n’est point par artifice littéraire, mais parce que dans la vision et la pensée d’Henri Bosco, ils ne se distinguent qu’en se graduant. Le rêve est la réalité d’un autre rêve, et notre songe humain des songes du Pays reçoit ses messages. Nous ne commençons à habiter véritablement les lieux, c’est-à-dire que nous n’en devenons les hôtes que si hôtes à notre tour, nous recevons les légendes qui sont dans l’arbre des mots, comme l’envers argenté des feuilles.
Cette grande part nocturne des romans d’Henri Bosco est une quête lumineuse qui semble se souvenir que, selon la formule de la théologie médiévale, « la lumière est l’ombre de Dieu », lux umbra dei. Un monde, dans son Pays, nous accueille, que nous recueillons en le nommant.
Luc-Olivier d’Algange
00:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri bosco, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, luc-olivier d'algange |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 05 décembre 2018
Le règne de la Quantité contre l'Éternité
19:15 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : règne de la quantité, luc-olivier d'algange, didier carette, philosophie, philosophie pérenne, philosophie traditionalisme, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 10 février 2018
Luc-Olivier d'Algange : Le réenchantement du monde - causerie autour de Jünger
19:22 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 octobre 2017
La gnose poétique d'Ernst Jünger
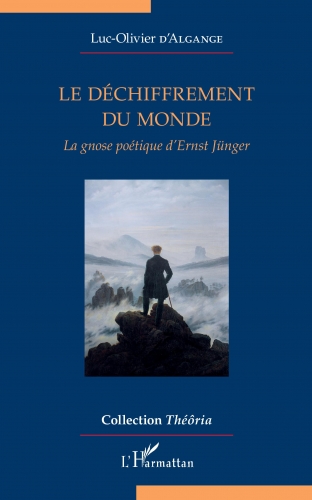
LE DÉCHIFFREMENT DU MONDE
La gnose poétique d'Ernst Jünger
Luc-Olivier D'Algange
L'oeuvre d'Ernst Jünger ne se réduit pas à ses récits et journaux de guerre. C'est une méditation originale sur le Temps, les dieux, les songes et symboles. Elle mène de l'art de l'interprétation au rapport des hommes au végétal et à la pierre, elle est aussi une rébellion contre l'uniformisation, incarnée dans la liberté supérieure de l'Anarque envers tous les totalitarismes. Cet ouvrage qui met en regard la pensée de Jünger et celles de ses maîtres, de Novalis à Heidegger, entend rendre compte de son dessein poétique et gnostique. Il donne à voir le monde visible comme l'empreinte d'un sceau invisible.
Poète et essayiste, co-fondateur avec F.J. Ossang de la revue "Cée" (Ed. C. Bourgois) et, avec André Murcie, de la revue "Style", collaborateur régulier de la "Place Royale", Luc-Olivier d'Algange est l'auteur de nombreux articles et chroniques parus dans diverses revues françaises et étrangères. Il a publié réemment "Lux Umbra Dei", "Apocalypse de la beauté" et "Métaphysique du dandysme".
Broché
ISBN : 978-2-343-13346-1 • novembre 2017 • 166 pages
EAN13 : 9782343133461
EAN PDF : 9782140050213
04:33 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, luc-olivier d'algange, livre, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, écologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 décembre 2016
«Des héros et des dieux»

Luc-Olivier d'Algange:
«Des héros et des dieux»
Ex: http://frontdelacontre-subversion.hautetfort.com
Toute science politique qui s'écarte ostensiblement de l'humanitas suscite en nous une juste aversion. Nous redoutons et nous repoussons les théories dont nous devinons qu'elles peuvent abonder dans le sens de la barbarie. Mais sommes-nous pour autant à même de comprendre ce qu'est au juste cette humanitas dont nous nous réclamons ? Pourrons-nous encore longtemps tirer les conséquences d'une idée dont l'origine s'assombrit dans un oubli de plus en plus profond ? Que savons-nous, par exemple, du dessein de la Grèce archaïque et classique qui fut à l'origine des sciences et des arts que l'on associe habituellement à la notion d'humanitas ?
Il est fort probable que cette notion d'humanitas, telle qu'elle fut comprise autrefois diffère bien davantage encore que nous ne pouvons l'imaginer de l'humanité, de l'humanitarisme voire de l'humanisme tels que nous les envisageons depuis deux siècles. Peut-être même notre « humanité » est-elle devenue plus étrangère à l'humanitas que ne le sont aux modernes occidentaux les chamanismes et les rites archaïques des peuplades étrangères. La médiocrité à laquelle nous consentons, le dédain que nous affichons à l'égard de notre littérature, de notre philosophie et de notre style, ne sont-ils point le signe d'une incompétence croissante à faire nôtre une notion telle que l'humanitas ? Quelques-uns d'entre nous, certes, font encore leurs humanités, d'autres entreprennent de louables actions « humanitaires » mais il n'est pas certain que les uns et les autres fussent encore fidèles, si peu que ce soit à l'humanitas.
Que fut au juste pour les Grecs des périodes archaïques et classiques, être humain ? Quel était le site propre de cette pensée de l'humain ? Était-ce, comme dans nos modernes sciences humaines, la réduction du monde à hauteur d'homme ? Certes non ! Il suffit de quelques vagues remémorations de l'épopée homérique pour convenir qu'il n'est de destinée humaine qu'orientée par l'exemplarité divine. Les dieux sont des modèles, quelquefois faillibles mais non moins impérieux et ils entraînent l'aventure humaine dans un jeu de ressemblance où le visible et l'invisible, le mortel et l'immortel s'entremêlent : et c'est ainsi qu'est formée la trame du monde.
L'humanitas pour les anciens n'excluait donc nullement quelque oubli de soi, en tant que pure existence immanente. S'il était donné à l'humain de côtoyer le monde divin et ses aléas prodigieux et parfois indéchiffrables, ce n'était certes point pour s'imaginer seul au monde ou réduit à quelque déterminisme subalterne. L’Épopée nous renseigne mieux que tout autre témoignage : l'aventure humaine, l'humanitas, obéit à la prédilection pour l'excellence conquise, au dépassement de soi-même, au défi lancé sous le regard des dieux, à la condition humaine. Être humain, dans l’Épopée, se mesure moins en termes d'acquis que de conquête. La conscience elle-même est pur dépassement. Cette verticalité seule, issue des hautes splendeurs divines, nous laisse une chance de comprendre le monde en sa profondeur, d'en déchiffrer la trame auguste.
Ulysse est l'exemple du héros car son âme songeuse, éprise de grandeur est à l'écoute des conseils et des prédictions de Pallas-Athéna. Âme orientée, l’Âme d'Ulysse est elle-même car elle ne se contente point du déterminisme humain. Elle discerne plus loin et plus haut les orées ardentes de l'invisible d'où les dieux nous font parvenir, si nous savons être attentifs, leurs messages diplomatiques.
Le Bouclier d'Achille, ─ sur lequel Héphaïstos a gravé la terre, la mer, le ciel et le soleil ─, est le miroir du monde exemplaire. Par lui, le héros qu'il défend sait comment orienter son attention. L'interprétation du monde est l'objet même du combat, car il n'est point de connaissance sans vertu héroïque. Toute Gnose est aristéia, récit d'un Exploit où le héros est en proie à des forces qui semblent le dépasser. La vertu héroïque est l’areté, la noblesse essentielle qui confère la maîtrise, celle-là même dont Homère donne l'exemple dans son récit. C'est aussi grâce à cette maîtrise, que, selon l'excellente formule de l'éminent helléniste Werner Jaeger, « Homère tourne le dos à l'histoire proprement dite, il dépouille l'événement de son enveloppe matérielle et factuelle, il le crée à nouveau. »
Cette recréation est l'essence même de l'art d'être. L'histoire n'est faite en beauté que par ceux qui ne se soumettent pas aux lois d'un plat réalisme. Il n'est rien de moins « naturaliste » que l'idéologie grecque. La Nature pour Homère témoigne d'un accord qui la dépasse, et le nom de cet accord n'est autre que l'Art. L'aristéia, l'éthique chevaleresque ne relèvent en aucune façon de cette morale naturelle à laquelle nos siècles modernes s'efforcent en vain de nous faire croire. « Pour Homère et pour les Grecs en général,poursuit Werner Jeager, les limites ultimes de l'éthique ne représentent pas de simples règles d'obligation morale : ce sont les lois fondamentales de l’Être. C'est à ce sens des réalités dernières, à cette conscience profonde de la signification du monde, ─ à côté de laquelle tout "réalisme" paraît mince et partiel ─ que la poésie homérique doit son extraordinaire pouvoir ».
Échappant au déterminisme de la nature par les profonds accords de l'Art qui dévoilent certains aspects des réalités dernières, le héros grec, figure d'exemplarité, confère aussi à sa propre humanité un sens tout autre que celui que nous lui donnons dans notre modernité positiviste. L'humanité, pour Homère, pas davantage que pour Platon, n'est une catégorie zoologique. L'homme n'est pas un animal amélioré. Il est infiniment plus ou infiniment moins selon la chance qu'il se donne d'entrer ou non dans le Songe de Pallas.
Il n'est pas certain que l'anthropologie moderne fût à même de saisir au vif de son éclat poétique et héroïque cette idée de l'humain dont l'âme est tournée vers un message divin. Cette idée récuse à la fois les théories de l'inné et les théories de l'acquis qui se partagent la sociologie moderne, ─ et ne sont que deux aspects d'un même déterminisme profane ─, pour ouvrir la conscience à de plus glorieux appels. L'homme n'est la mesure que par les hauteurs et les profondeurs qu'il conquiert et qui appartiennent à d'autres préoccupations que celles qui prévalent dans l'esprit bourgeois.
Or, celui qui ne règne que par la force brute de l'argent a fort intérêt à nier toute autre forme de supériorité et d'autorité. Nul ne profite mieux de la disparition des hiérarchies traditionnelles que l'homme qui exerce dans l'ordre du pouvoir de l'état de fait. Il n'en demeure pas moins que, dans la médiocratie, il y a d'une part ceux qui profitent de l'idéologie de la médiocrité et d'autre part ceux qui y consentent et la subissent, faute de mieux. Mais dans un cas comme dans l'autre chacun tient pour fondamentalement juste et moral de dénigrer toute autorité spirituelle, artistique ou poétique, tout en subissant de façon très-obséquieuse le pouvoir dont il dépend immédiatement. Il n'y a là au demeurant rien de surprenant ni de contradictoire, la soumission au pouvoir étant, par définition, inversement proportionnelle à la fidélité à l'autorité.

Soumis au pouvoir, jusqu'à idolâtrer ses représentations les plus dérisoires, le moderne se fait du même coup une idéologie dominante de son aversion pour l'autorité. Cette aversion n'est autre que l'expression de sa honte et de son ressentiment ; honte à subir sans révolte l'état de fait humiliant, ressentiment contre d'autres formes de liberté, plus hautes et plus dangereuses.
L'autorité légitime, légitimée par la vertu noble, l'areté au sens grec, est en effet l'apanage de celui qui s'avance le plus loin dans les lignes ennemies, le plus loin au-delà des sciences connues et des notions communément admises. Au goût de l'excellence dans le domaine du combat et des arts correspond l'audace inventive dans les sciences et dans la philosophie. Si nous voyons le moderne, ─ peu importe qu'il soit « libéral » ou « socialiste », « démocrate » ou « totalitaire », dévot de l'inné ou de l'acquis ─, si peu inventif, hormis dans le domaine des applications techniques et utilitaires, il faudra admettre que le modèle sur lequel il calque son idée d'humanité le prédispose à une certaine passivité et à une indigence certaine.
Le simple bon sens suffit à s'en convaincre : une idéologie déterministe ne peut que favoriser les comportements de passivité et de soumission chez les individus et entraîner la civilisation à laquelle ils appartiennent vers le déclin. L'individu qui se persuade que la destinée est essentiellement déterminée par le milieu dont il est issu ou par son code génétique se rend sourd aux vocations magnifiques. Il se condamne à la vie médiocre et par cela même se rend inapte à servir le Pays et sa tradition. Seule l'excellence profite à l'ensemble. Le médiocre, lui, ne satisfait que lui-même dans ses plus basses complaisances.
Les principes aristocratiques de la plus ancienne culture grecque nous donnent ainsi à comprendre en quoi nos alternatives, coutumières en sciences politiques, entre l'individualisme et le collectivisme ne valent que dans une science de l'homme qui ignore tout de l’au-delà du déterminisme, si familier aux héros de Homère dans leur exemplarité éducative et politique. Les Exploits, les actions qui témoignent de la grandeur d'âme rompent avec l'enchaînement des raisons médiocres et peuvent seuls assurer en ce monde une persistance du Beau, du Vrai et du Bien.
La Grèce archaïque et la Grèce classique, Homère et Platon, s'accordent sur cette question décisive : le Beau, le Vrai et le Bien sont indissociables. Les circonstances malheureuses qui prédisposaient Ulysse à faillir à l'honneur sont mises en échec par l'intervention de la déesse. Pallas-Athénée est, dans l'âme du héros, la liberté essentielle, héroïque, divine, qui échappe aux déterminismes, et guide sa conscience vers la gloire, vers l'ensoleillement intérieur.
Dans cette logique grecque archaïque l'individu ne s'oppose pas à la collectivité, de même que celle-ci n'est pas une menace pour l'individu (ce qui dans le monde moderne est presque devenu la règle). La valeur accordée à l'amour-propre et au désir de grandeur, la recherche de la gloire et de l'immortalisation du nom propres aux héros de la Grèce ancienne excluent toute possibilité de l'écrasement de l'individu par la collectivité, d'autant plus qu'inspirés par le monde des dieux, l'éclat et la gloire du héros le portent dans l'accomplissement même de ses plus hautes ambitions à être le plus diligent serviteur de la tradition dont il est l'élu.
L'Aède hausse la gloire humaine jusqu'à l'illustrer de clartés divines et lui forger une âme immortelle dont d'autres de ses semblables seront dépourvus, ─ mais dans cette inspiration heureuse, il honorera son Pays avec plus d'éclat et de façon plus durable que s'il se fût contenté d'un rôle subalterne ou indiscernable. L'individu ne sert avec bonheur sa communauté que s'il trouve en lui la connaissance qui lui permettra d'exceller en quelque domaine. Le rapide déclin des sociétés collectivistes modernes montre bien que l'individu conscient de lui-même en son propre dépassement est la source de toutes les richesses de la communauté. Mais le déclin des sociétés individualistes montre, quant à lui, que l'individu qui croit se suffire à lui-même, qui dédaigne le Songe de Pallas et ne conçoit plus même recevoir les biens subtils des anciens avec déférence, amène à un nivellement par le bas, une massification plus redoutable encore que ceux des sociétés dites « totalitaires ».
Ce monde moderne où nous vivons, ─ est-il seulement nécessaire de formuler quelque théorie pour en révéler l'aspect sinistre ? La médiocrité qui prévaut, hideux simulacre de la Juste Mesure, n'est pas seulement l'ennemie des aventures prodigieuses, elle est aussi, et de façon de plus en plus évidente, le principe d'une inhumanité auprès de laquelle les pires désastres de l'histoire antique paraissent anecdotiques et bénins. Si l'humanitas des anciens fut en effet une création de l'idéal aristocratique, tel que l'illustre l'épopée d'Homère, la médiocrité moderne, elle, engendre une inhumanité placée sous le signe de l'homme sans visage, de l'extermination de masse, du pouvoir absolu et de la haine absolue pour laquelle la fin justifie les moyens dans le déni permanent des fondements mêmes de toute morale chevaleresque. Au Dire, au Logos, et à l'areté qui en est l'expression humaine, le monde moderne oppose le Dédire universel.
De nos jours, les philosophes ne cherchent plus la sagesse ; ils « déconstruisent ». Les poètes ne hantent que les ruines d'un édifice d'où l'être a été chassé. Les « artistes » s'acharnent à ce que leurs œuvres ne fussent que « matière » et « travail » : et certes, elles ne sont plus en effet que cela. Et tout cela serait de peu d'importance si l'art de vivre et les sources mêmes de l'existence n'en étaient atteints, avec la grâce d'être.
Les œuvres grecques témoignent de cette grâce qui semble advenir à notre entendement comme dans une ivresse ou dans un rêve. Le royal Dionysos entraîné dans la précise légèreté de son embarcation, dans l'immobilité rayonnante d'un cosmos aux limites exactes, la Korê hautaine et rêveuse, l'intensité victorieuse du visage d'Athéna, nous donnent un pressentiment de ce que pourrait être une vie dévouée à la grandeur. Mais de même que le concept d'humanité diffère selon que l'envisage un poète homérique ou un sociologue moderne, l'idée de grandeur, lorsqu'elle en vient à prendre possession d'une destinée collective prend des formes radicalement différentes selon qu'elle exprime la démesure technocratique de l'agnostique ou la Sapience du visionnaire.
Les œuvres de la Grèce archaïque nous apprennent ainsi qu'il n'est de grâce que dans la grandeur : celle-ci étant avant tout la conscience des hauteurs, des profondeurs et des latitudes de l'entendement humain et du monde. Les actions et les œuvres des hommes atteignent à la grâce lorsqu'elles témoignent d'un accord qui les dépasse. Alors que le moderne ne croit qu'à la puissance colossale, à la pesanteur, à la masse, à la matière, la Grèce dont il se croit vainement l'héritier, nous donne l'exemple d'une fidélité à l'Autorité qui fonde la légitimité supérieure de la légèreté ouranienne, de la mesure vraie, musicale et mathématique, du Cosmos qui nous accueille dans une méditation sans fin. C'est par la grâce de la grandeur que nous pouvons être légers et aller d'aventure, avec cette désinvolture aristocratique qui prédispose l'âme aux plus belles inspirations de Pallas.
La lourdeur presque invraisemblable de la vie moderne, tant dans ses travaux que dans ses loisirs, la solitude absurde dans laquelle vivent nos contemporains entassés les uns sur les autres et dépourvus de toute initiative personnelle, l'évanouissement du sentiment de la réalité immanente, à laquelle se condamnent les peuples qui ne croient qu'en la matière, l'inertie hypnagogique devant les écrans à laquelle se soumettent les ennemis acharnés de toute déférence attentive, ne doit nous laisser ni amers ni indignés : il suffit que demeure en nous une claire résolution à inventer, d'abord pour quelques-uns, une autre civilisation.
 De quelle nature est cette claire résolution ? Aristocratique, certes, mais de façon originelle, c'est-à-dire n'excluant à priori personne de son aventure. La clarté où se déploie cette résolution ne l'exempte pas pour autant du mystère dont elle est issue, qui se confond avec les tonalités essentielles de la pensée grecque telle que sut la définir Nietzsche : le rêve et l'ivresse. Rien, jamais, en aucune façon ne saurait se faire sans l'intervention de l'Inspiratrice qui surgit des rêves les plus profonds et les plus lumineux et des ivresses les plus ardentes. Cet au-delà de l'humain, qui fonde l'humanitas aristocratique, en nous permettant d'échapper au déterminisme et au nihilisme, fait de nous, au sens propre des créateurs, des poètes ; et chacun voit bien qu'aujourd'hui, il ne saurait plus être de chance pour la France que de se rendre à nouveau créatrice en suivant une inspiration hautaine !
De quelle nature est cette claire résolution ? Aristocratique, certes, mais de façon originelle, c'est-à-dire n'excluant à priori personne de son aventure. La clarté où se déploie cette résolution ne l'exempte pas pour autant du mystère dont elle est issue, qui se confond avec les tonalités essentielles de la pensée grecque telle que sut la définir Nietzsche : le rêve et l'ivresse. Rien, jamais, en aucune façon ne saurait se faire sans l'intervention de l'Inspiratrice qui surgit des rêves les plus profonds et les plus lumineux et des ivresses les plus ardentes. Cet au-delà de l'humain, qui fonde l'humanitas aristocratique, en nous permettant d'échapper au déterminisme et au nihilisme, fait de nous, au sens propre des créateurs, des poètes ; et chacun voit bien qu'aujourd'hui, il ne saurait plus être de chance pour la France que de se rendre à nouveau créatrice en suivant une inspiration hautaine !
Grandeur d'âme et claires résolutions
Sur les ailes de l'ivresse et du rêve, Pallas est l'inspiratrice hautaine qui appelle en nous de claires résolutions.
Le Songe d'une nouvelle civilité naît à l'instant où nous cessons d'être emprisonnés dans la fausse alternative de l'individu et de la collectivité. Pallas-Athéna, qui délivre Ulysse de sa faiblesse, nous donne l'audace de concevoir la possibilité d'une existence plus légère, plus grande et plus gracieuse, ─ délivrée de la pesanteur dont le médiocre écrase toute chose belle et bonne.
L'Utilité, qui n'est ni vraie, ni belle, ni bonne, est l'idole à laquelle le médiocre dévoue son existence. L'utilitaire se moque de la recherche du Vrai et de l'Universel et, d'une façon plus générale, de toute métaphysique. Ce faisant, il s'avère aussi radicalement étranger au Beau et au Bien. Conformant son existence au modèle le plus mesquin, le médiocre est le principe du déclin des civilisations. La grandeur d'âme que chante Homère, l'ascendance philosophique vers l'Idée que suscite l'œuvre de Platon, ont pour dessein de délivrer l'homme de la soumission aux apparences et de le lancer à la conquête de l'excellence. L'idéal aristocratique de la Gloire, dont les Grecs étaient si farouchement épris, est devenu si étranger à l'immense majorité de nos contemporains que son sens même et sa vertu créatrice échappent au jugement, toujours dépréciateur, que l'on porte sur sa conquête.
Tel est pourtant, le secret même du génie grec d'avoir su, par la recherche de la gloire exalter la personne, lui donner la plus vaste aire d'accomplissements qui seront la richesse de la civilisation toute entière. Alors que le médiocre, subissant le déterminisme limite son existence à ses proches et n'apporte rien à quiconque d'autre, l'homme à la conquête de la gloire, à l'écoute des plus exigeantes injonctions de la déesse, va s'élever et, de sa pensée et de ses actions, être un dispensateur de bienfaits bien au-delà du cercle étroit auquel l'assignent les circonstances immanentes.
L'idéal aristocratique de la Grèce archaïque, ─ que la philosophie de la Grèce classique va universaliser ─, unit ainsi en un même dessein créateur les exigences de l'individu et celles de la communauté, dépassant ainsi la triste et coutumière alternative « politologique » des modernes. Cet idéal dépasse aussi, du même coup, l'opposition entre les tenants de l'universalisme et ceux de l'enracinement. La hauteur ou le faîte éblouissant de l'Universel qui se balance au vent garde mémoire des racines et de l'humus.
Nous reviendrons, dans la suite de notre ouvrage sur la question des racines et du droit du sol lorsque le moment sera venu d'établir la filiation entre l'idée grecque et la tradition française dans l'immense songe de Pallas qui les suscite avec le pressentiment d'une civilisation ouranienne et solaire. Pour lors, il importe de garder présente à l'esprit cette nécessaire amplitude du regard propre à la poésie homérique et sans laquelle tout dessein poétique et politique demeure incompréhensible. Quelques-uns hasarderont que ces considérations relèvent bien davantage de la poésie que du politique, sans voir qu'il n'est point de politique digne de ce nom, qui ne fût, pour l'ancienne Grèce, ordonnée à la poésie.
Dès lors que la politique prétend se suffire à elle-même et ne cherche plus dans la poésie la source de son dessein, elle se réduit, comme nous y assistons depuis des décennies, à n'être plus qu'une gestion d'un ensemble d'éléments qui relèvent eux-mêmes exclusivement du monde sensible. Gérer est le maître-mot de nos temps mesquins où l'esprit bourgeois est devenu sans rival, alors que le héros homérique, tout au contraire n'existe que par le refus de cette mesquinerie et l'audace fondatrice à se rebeller contre les « réalités », à se hausser et à hausser sa destinée dans la région resplendissante du Mythe et du Symbole. Alors que le moderne croit faire preuve de pertinence politique en se limitant à « gérer » une réalité dont il peut reconnaître le cas échéant, le caractère déplaisant, le héros d'Homère, obéissant à une autorité supérieure à tous les pouvoirs et toutes les réalités, va s'aventurer en d'imprévisibles épreuves et conquêtes. Tout se joue à la fois dans le visible et l'Invisible, celui-là n'étant que la répercussion esthétique de celui-ci. L'amplitude du regard épique ouvre l'angle de l'entendement jusqu'aux deux horizons humains et divins, qu'il embrasse, disposant ainsi l'âme à reconnaître la grandeur.
Nul ne méconnaît l'importance des modèles dans la formation des hommes. Le génie grec fut de proposer un modèle exaltant, toujours mis en péril par l’Éris qui nous incite à nous dépasser nous-même. Le moderne qui se fait de la médiocrité un modèle se condamne à devoir céder sans résistance à l’Éris malfaisante, la Querelle inutile, qui traduit toute puissance en moyen d'anéantissement, alors que l’Éris bienfaisante s'exprime en œuvres d'art, en civilités subtiles et ferventes apologies de la beauté.
Le moderne qui ne tarit pas en déclarations d'intention, pacifistes ou « humanitaires » ne connaît en matière d'expression de puissance que l'argent qui fait les armes et peut-être qu'en dernière analyse, au-delà des confusions nationales et idéologiques, les guerres modernes ne sont-elles rien d'autre que des guerres menées par des hommes armés contre des hommes, des femmes et des enfants désarmés, selon des finalités purement instinctives et commerciales. Telle est la conséquence de la négation de l'idéal chevaleresque, que l'on récusait naguère encore pour avoir partie liée à la violence ! Or, les codes d'honneur de l’Épopée et des Chansons de Geste furent précisément une tentative de subjuguer la brutalité à des fins plus nobles, de changer autant que possible l’Éris néfaste, destructrice, en Eris généreuse, prodigue de dons et de protections à l'égard des plus faibles. Nier cet idéal chevaleresque, sous prétexte qu'il traitât de la violence, revenait à se livrer à l'hybris de la violence pure.
La persistance à méconnaître cette erreur d'interprétation ne fut point sans verser les sciences humaines « démocratiques » dans l'ornière où nous les trouvons. La méditation de la source grecque nous préservera déjà d'interpréter les notions politiques à rebours de leur étymologie. La démocratie, que peut-elle être d'autre sinon très-exactement le pouvoir du Démos ? Le respect de la personne humaine, de ses libertés de penser et d'être, auxquels on associe, fort arbitrairement, le mot de démocratie n'est pas davantage inscrit dans l'étymologie que dans l'histoire de la démocratie. Croire que le pouvoir du plus grand nombre est par nature exempt d'abominations est une superstition ridicule que ne cesse de démentir, hélas, la terrible histoire du vingtième siècle. Mais les hommes en proie aux superstitions ont ceci de particulier que le plus éclatant démenti ne change en rien leur façon de voir, ou, plus exactement, de ne pas voir. La forme moderne de la superstition est l'opinion que l'on possède et que l'on exprime, entre collègues, au café ou le jour des élections un peu partout, et dont il va sans dire qu'elle est, du point de vue qui nous intéresse ici, sans aucune valeur.

Insignifiante par définition, l'opinion relève de la croyance mais d'une croyance imposée de l'extérieur et d'ordre presque mécanique. L'individu moderne possède l'opinion précise qui le dispensera le mieux d'être livré à l'exercice difficile de la pensée. Nous savons, ou nous devrions savoir, depuis Platon, qu'avoir ses opinions c'est ne pas penser. Ce n'est pas même commettre une erreur, se fourvoyer, succomber à quelque maladresse fatale, ─ c'est tout simplement consentir à ne pas tenter l'aventure de la pensée. On peut à bon droit reprocher à certaines formes de démocratie d'avoir favorisé de façon démesurée cette outrecuidance de l'opinion, cette prétention de la non-pensée à s'ériger en doctrine. Et il n'y a pas lieu de s'étonner outre mesure que la plus ancienne démocratie connue fît condamner Socrate, auteur de tant de subtiles maïeutiques ! Si la formulation, et la mesure quantitative des « opinions » suffisent à créer une légitimité, toute autre forme de pensée ne saurait en effet apparaître que rivale et dangereuse.
Le système parlementaire a ses vertus mais l'idéologie démocratique demeure, elle, singulièrement menaçante à l'endroit de toute pensée qui prétend à trouver sa légitimité non point en quelque fin utile mais dans son propre parcours infini. Le Voyage d'Ulysse accompagne dans l'invisible celui qui tente d'échapper à la tyrannie de l'Opinion. L'interprétation infinie du monde, héroïque et poétique, débute avec cette délivrance. L'idéologie démocratique se propose à travers ses sciences humaines, positivistes ou matérialistes, comme une explication totale du monde et de l'homme, ─ explication totale d'autant plus facile à formuler, et à promouvoir, qu'elle se fonde sur la négation du haut et du profond et réduit le monde à la platitude de quelques schémas. A cette outrecuidance de l'explication, l'épopée oppose le génie de l'interprétation infinie, la science d'Hermès-Thot : l'herméneutique. Il n'est pas vain de redonner à ce terme passablement galvaudé sa consonance mythique, sans quoi il se réduit à ne recouvrir que d'assez fastidieuses gloses universitaires ! Or, on ne saurait concevoir de philosophie politique dans la méconnaissance de la forme d'intelligence qu'elle tend à favoriser.
L'humanitas, en politique, consiste d'abord à tenir pour important ce qu'il advient de la nature humaine, quels types d'hommes tendent à apparaître ou disparaître et dans quelles circonstances. Autant de questions que les gestionnaires modernes refusent en général de se poser. Les modèles n'en demeurent pas moins opératoires, et particulièrement, les pires d'entre eux. Les modèles du moderne sont à la fois dérisoires et inaccessibles ; ils ne mobilisent son énergie que pour l'illusion : la copie d'une réalité sensible qui elle-même n'advient à l'entendement que sous la forme d'une opinion : d'où l'extraordinaire prolifération des écrans, avec leurs imageries publicitaires. A cet assujettissement au degré le plus inférieur du réel, à savoir la copie de l'immanence, l'areté homérique, tout comme l'Idée platonicienne, ─ qui n'est autre que sa formulation philosophique ─, oppose le désir du Haut, de l'Ardent et du Subtil. A ces grandes âmes le monde sensible ne suffit pas. Au-delà des représentations, des ombres, des copies, des simulacres, l'âme héroïque entrevoit une présence magnifique, victorieuse de toute temporalité et de tout déterminisme, et de laquelle elle désire amoureusement s'emparer.
La veulerie, la laideur, la lourdeur, ─ tout ce qui rend impossible la résistance au Mal ─, que sont-elles sinon ces qualités négatives qui indiquent l'absence de la grandeur d'âme ? Celui qui ne désire plus s'élever vers les régions resplendissantes de l'Idée, c'est à la lourdeur qu'il s'adonne. L'individualité vertigineusement égocentrique des modernes, dont témoigne la disparition de l'art de la conversation, ne change rien au fait que, par leur matérialisme, qui n'est rien d'autre qu'un abandon à la lourdeur, et leurs opinions qui ne considèrent que les représentations du monde sensible, ─ qu'ils s'abusent à croire « objectives » ─, les modernes s'éloignent de la possibilité même de l'Art.
Morose, brutal, mécanique et lourd, le moderne ne laisse d'autre choix à celui qui veut être de son temps qu'entre l'hybris technologique ou l'intégrisme religieux ou écologique qui ne sont que l'avers et l'envers d'un même nihilisme. Après avoir perdu toute foi et toute fidélité et, par voie de conséquence, la force créatrice nécessaire au dessein artistique, le moderne ressasse ses dévotions à l'idole morne de l'Utile. Que la personne humaine eût une vertu propre et qu'il fût de son devoir de l'illustrer en œuvres de beauté, ces notions-là sont devenues à tel point étrangères que toutes les idéologies récentes peuvent se lire comme des tentatives, à l'encontre de la philosophie platonicienne, de maintenir le plus grand éloignement possible entre la morale et l'esthétique. Tout conjure en cette fin de siècle pénombreux où nous nous trouvons à faire de nous de simples objets d'une volonté elle-même sans objet. L'idolâtrie de la prouesse technique, réduite à elle-même dans une souveraineté dérisoire n'est pas sans analogie avec la morale puritaine qui prétend se suffire à elle-même, en dehors de toute référence au Beau et au Vrai.

Le moralisme intégriste, dont l'expression directe est le crime, rejoint le moralisme technocratique qui profane le monde de fond en comble. Le monde moderne qui tant voulut confondre la juste mesure avec la tiédeur, se trouve désormais en proie au pouvoir exclusif des profanateurs. Loin d'être un quelconque retour aux temps anciens, l'intégrisme serait bien plutôt un des accomplissements ultimes de la modernité.
L'éloignement du Songe de Pallas et de l'idéal aristocratique, nous livre à ces irrationalités farouches. Certains s'effarent de l'extension, dans nos univers urbains et bourgeois, des superstitions les plus aberrantes. Le New-Age, les marabouts, les pratiques occultes les plus répugnantes, gagnent un nombre croissant d'adeptes dont les existences bourgeoises, impliquant l'usage quotidien de techniques dites « avancées » paraissent livrées sans défense à de monstrueuses déraisons. Telles sont quelques-unes des conséquences de la « déconstruction » du Logos platonicien. La haine de la métaphysique, quand bien même elle use à ses débuts d'arguments « rationalistes » a pour conséquence fatale la destruction de la Raison, ─ celle-ci n'étant qu'une réfraction de l'Idée et du Logos. La réfutation de toute hiérarchie métaphysique, la volonté acharnée de réduire l'angle de l'entendement humain au seul domaine du sensible, la négation de l'objectivité du monde métaphysique, la réduction des royaumes de l'âme à quelque « inconscient » psychanalytique contribuèrent de façon décisive à saper le fondement même de la Raison qui n'est jamais que l'instrument de la métaphysique en tant que science de l'Universel. Les généticiens nazis, les informaticiens qui font « marabouter » leurs entreprises expriment la déraison d'une modernité scientifique qui est à l'origine des plus abominables possibilités de manipulation de l'être humain. Désormais les Titans règnent sans partage. Mais à quelques-uns d'entre nous les dieux dissimulés dans les profondeurs vertigineuses et éblouissantes de l'Ether font signe.
Nous sommes de ceux qui croient qu'un Grand Songe peut seul nous sauver de cette terrible déraison qui envahit tout. Seule la célébration d'un Mystère nous rendra aux sagesses sereines du Logos, ─ et nous montrerons, dans la suite de cet ouvrage, que ce Mystère ne saurait plus être qu'un Mystère français. Que la philosophie politique, selon la terminologie française, fût d'étymologie grecque suffit à justifier notre déférence pieuse au Songe de Pallas. La « polis » grecque contient ces deux notions de Cité et d’État que la Monarchie saura concilier avec les bonheurs et les malheurs que l'on sait.
Pallas n'en doutons pas veille sur les beaux accomplissements de la Monarchie française. L'alliance du mystère et de la raison, la beauté propre à cette double clarté qui donne aux choses leur relief et leur profondeur me paraît du privilège des cultures grecques et françaises. Les exégètes modernes, qui vantent la clarté française et la raison grecque semblent ignorer avec application les prodigieuses arborescences métaphysiques dont elles sont issues. Ils ne veulent gloser que sur certains effets et dédaignent le rêve immense où ils prennent place.
Redisant l'importance de la beauté du geste et l'éternité irrécusable du plus fugace lorsqu'il illustre la fidélité à une souveraineté qui le dépasse, le Songe de Pallas nous rend la Raison en nous délivrant du rationalisme. La distinction entre la raison et le rationalisme paraîtra spécieuse à certains. Elle n'en tombe pas moins sous le sens. Car la raison digne de ce nom s'interroge sur elle-même : elle est Raison de la raison, quête infinie alors que le rationalisme n'est qu'un système qui soumet la pensée à une opinion. Le rationalisme est le sépulcre de la haute raison apollinienne qui ordonne les bienfaits, établit d'heureuses limites et œuvre en ce monde sensible selon la Norme intelligible. Or, Apollon qui, selon la thèse de Nietzsche est le dieu de la mesure est aussi le dieu de la sculpture et du rêve. La forme de la beauté qui s'inscrit dans le paysage qui définit l'espace par ses figures mythiques et ses orientations symboliques, affermit la raison alors même qu'elle invite au rêve.
Mais de quelle nature est au juste ce rêve qui nous délivre ? A quel règne appartient-il ? Quels sont ses privilèges et ses vertus ? Le consentement à une pensée qui n'exclut point les hiérarchies du visible et de l'Invisible, les imageries poétiques de la hauteur et les mathématiques subtiles des lois célestes nous inclinent à voir dans le sentiment qu'éveille en nous le Songe de Pallas, un assentiment primordial à la légèreté. Il serait bien vain de se référer aux mythologies anciennes si nous n'étions plus à même d'en éveiller en nous d'intimes résonances. Le seul nom de Pallas-Athéna intronise dans notre âme un règne victorieux de la pesanteur. L'exactitude intellectuelle que requiert la déesse nous ôte la possibilité de l'abandon à la veulerie de l'informe. Tel est sans doute le secret de l'euphorie rêveuse qu'éveille sa présence en nous. Car le Songe que Pallas éveille en nous est tout d'abord un envol, et de cet envol nous tiendrons, jusqu'aux étincelantes armes de la raison, la connaissance de la dimension verticale du monde qui est le principe même de toute connaissance métaphysique.

La limite du pouvoir qu'exercent les utilitaires et les puritains est la limite de tout pouvoir. Le pouvoir aussi hypertrophié soit-il n'a de pouvoir que sur le pouvoir : l'autorité lui échappe, qui incombe elle, de la résolution que suscite en nous l'intervention de Pallas. Autant dire, d'ores et déjà, que nous n'aurons de cesse d'avoir redonné à notre résolution les formes que lui mérite son inspiratrice ! Qu'il soit bien entendu qu'il ne sera plus jamais question de céder si peu que ce soit de ce qui nous appartient aux Barbares. Face à la permanente apologie de l'informe nous ne serons pas sans fierté de paraître quelquefois intolérants. Que l'on renonce à nous vouloir bienveillants à l'égard du vulgaire ou du lourd ou disposés à leur trouver quelque excuse ! Nous voyons en l'idéologie de l'équivalence du tout avec n'importe quoi le signe de cette confusion qui, si nous n'y prenons garde, nous asservira aux pires idoles.
C'est au plus bas que les choses bonnes et mauvaises se confondent et c'est au plus haut qu'elles s'unissent après être passées par l'équateur des plus nettes distinctions. Feindre de croire que les distractions de masse et la publicité puisse être équivalentes de quelque façon aux poèmes de Scève ou de Mallarmé revient à donner aux premières une insupportable éminence. L'état de fait qui, dans nos sociétés de masse revient à accorder plus d'importance aux expressions rudimentaires et barbares, est-il encore nécessaire de s'y soumettre au point de leur trouver, par surcroît quelque légitimation « intellectuelle » ? Faut-il toujours ajouter au pouvoir déjà abusif par lui-même l'abus incessant de nos obséquiosités de vaincus ? Telle est pourtant l'attitude d'une grande majorité de nos intellectuels qui assistent de leurs applaudissements l'extinction progressive de toute intellectualité. Nous sommes sans hésiter de ces élitistes affreux qui tiennent en mépris les amusements du plus grand nombre. Nous sommes avec enthousiasme les ennemis des « intellectuels », ─ que Péguy sut traiter comme il convient, ─ dont le parti pris démocratique n'est autre qu'une lâche approbation de la force effective du plus grand nombre.
Ces gens-là, ayant pris le parti de la force la plus massive s'imaginent à l'abri de tout revers et de toute vindicte, et il est vrai qu'en cet Age Noir où nous sommes, le cours des choses, que les cuistres nomment l'Histoire, semble en effet aller à leur avantage, ─ mais nous ne sommes pas non plus de ceux qui trouvent leur plus grande satisfaction à suivre le chemin le plus avantageux. Notre joie s'accroît à la conscience que nous prenons de la nécessité de résister ; telle est exactement la différence qui existe entre l'idéologie collaboratrice et l'idéologie résistante. L'une se targue du réalisme et du caractère irrécusable de l'état de fait, l'autre augure et s'aventure pour l'honneur, qui est fidélité au Bien et au Beau universels. Si les conditions immanentes sont défavorables au triomphe du Juste, ─ comment saurait-t-il être question, pour un homme d'honneur, de « s'adapter »?
Toute la ruse de la modernité consiste à faire en sorte que nous nous trompions de combat et que les sentiments nobles qui n'ont pu être anéantis fussent employés à mauvais escient, en des combats douteux et de fausses espérances. D'où l'importance de la remémoration religieuse des mythes et de la poésie fondatrice de la Cité. L'exercice du discernement et l'exercice de la poésie ne sont point exclusifs l'un de l'autre. Quiconque sut dévouer son attention à une œuvre de poésie au point d'y fondre ses propres intuitions et états d'âme, sait bien qu'une des vertus les moins rares du poème est d'ajouter à l'entendement des modes opératoires un discernement qui gagne en finesse à mesure que l'on s'abandonne à l'euphorie des rythmes et des rimes. Une politique radicalement séparée de la poésie, ainsi que l'envisagent les « démocrates » modernes, revient à assujettir la Cité à la dictature d'une science utilitaire dont les ressorts irrationnels, les soubassements de volonté de puissance ne peuvent nous entraîner que vers les désastres de l'Hybris.
Or, sinon la mesure musicale, l'attention portée aux nuances et la fervente exactitude de la pensée, que reste-t-il pour résister à l'Hybris ? La poésie seule est le recours. La poésie est la seule chance pour échapper aux parodies, mi-cléricales, mi-technocratiques, qui se substituent désormais aux défuntes autorités. Bientôt nous n'aurons plus le droit de dire un mot plus haut que l'autre. Et tout se joue dans la hauteur divine des mots, ─ qui certes les accorde en musique mais leur donne aussi une couleur différente selon leur élévation plus ou moins grande dans les secrets d'azur des états multiples de l'être. Selon leur hauteur sur la gamme des nues, les mots chantent et brillent de façon différente. Les divines gradations exaltent en nous le meilleur : le plus délié et le plus intemporel.
L'anamnésis, le seuil éblouissant, la Cité inspiratrice
La véritable anamnésis emporte ainsi le meilleur de nous-même sur les chevaux ailés de la poésie. Notre ressouvenir est l'essor. Il nous élève vers des nues de plus en plus transparentes : au sens exact, nous gagnons les hauteurs. Toute connaissance est élévation et réminiscence. « Ainsi, l’âme, est-il dit dans le Ménon, immortelle et plusieurs fois renaissante, ayant contemplé toutes choses, et sur la terre et dans l'Hadès, ne peut manquer d'avoir tout appris. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait, sur la vertu et le reste, des souvenirs de ce qu'elle en a su précédemment. La nature entière étant homogène et l'âme ayant tout appris, rien n'empêche qu'un seul ressouvenir (c’est ce que les hommes appellent savoir) lui fasse retrouver tous les autres, si l'on est courageux et tenace dans la recherche ; car la recherche et le savoir ne sont au total que réminiscence ». Tout dans le monde moderne conspire à nous livrer à l'oubli morose. Ceux que la réminiscence ne ravit plus sont condamnés à n'être que des écorces mortes. Il faut encore que l'expérience du ressouvenir soit en nous un ravissement intense pour que nous devenions dignes d'œuvrer aux retrouvailles avec les origines poétiques et politiques de notre civilisation.

Du poétique et du politique, aussi indissociables que l'âme et le corps qu'elle anime, la concordance fonde les hautes civilisations. Mais cette concordance est elle-même la preuve de l'advenue de la réminiscence sans laquelle ce qui unit le plus lointain et le plus proche tombe dans l'oubli. Ceux qui, dans notre triviale modernité, se distinguent par quelque inclinaison à l'héroïsme se caractérisent ainsi par leur vif désir d'aller en amont des idées dont il ne subsiste, en effet, de nos jours, que des formes vides. En amont des définitions scolaires, il y eut l'appel du Large, et les aventures prodigieuses, le voisinage des dieux, les enchantements et les dangers.
Les discussions vétilleuses qui supposent que le Bien, le Beau et le Vrai puissent être considérés séparément tombent à la seule évidence de l'areté grecque qui proclame que le Beau est mon seul Bien et qu'il ne saurait être de Vérité qui nous contraigne à subir la loi de la laideur. Chercher le Vrai au détriment du Beau et du Bien, le Beau au détriment du Vrai et Bien ou encore le Bien au détriment du Beau et Vrai procède d'une aberration semblable à celle qui chercherait à s'approprier la dureté du diamant au détriment de sa transparence. Le Vrai, le Beau et le Bien ne sont pas des réalités distinctes mais des aspects d'une vertu unique que l'on conquiert par un incessant dépassement de soi-même.
Dans le visible, ni dans l'invisible, il n'est rien d'acquis. Tout se joue, toujours, dans la mise en péril donatrice qui, privilégiant l'audace, nous éloigne de nos semblables et nous rapproche du seuil éblouissant que la raison corrobore. L'acte du raisonnement, loin d'y contredire, nous invite au voyage du dieu.
« Il faut en effet, écrit Platon, que l'homme saisisse le langage des Idées lequel part d'une multiplicité de sensations et trouve l'unité dans l'acte du raisonnement. Or, il s'agit là d'une réminiscence des réalités jadis vues par notre âme, quand elle suivait le voyage du dieu et que dédaignant ce que nous appelons à présent des êtres réels, elle levait la tête pour contempler l'être véritable. Aussi bien il est juste que seule la pensée du philosophe ait des ailes car les objets auxquels elle se cesse de s'appliquer par son souvenir, autant que ses forces le lui permettent, sont justement ceux auxquels un dieu, parce qu’il s'y applique doit sa divinité. »
Le plus haut modèle invite ainsi la divinité à se reconnaître elle-même, à trouver le secret de la source de toute divinité. Le plus haut modèle, que Platon nomme l'Idée, est la forme formatrice de toute poésie et de toute politique, et son ressouvenir, par la Source qu'elle désempierre en nous, nous montre la voie de la déification. Pour l'esprit héroïque, la condition humaine n'est point telle que nous devions nous y soumettre. Aux ailes de la pensée de nous porter au-delà de toute condition, au grand scandale des esclaves non-promus qui passeront leur vie à jalouser les esclaves promus. « L'homme, écrit Platon, qui se sert correctement de tels moyens de se souvenir, toujours parfaitement initié aux mystères parfaits, est seul à devenir vraiment parfait. Détaché des objets qui suscitent les passions humaines et occupé de ce qui est divin, il subit les remontrances de la foule, on dit qu'il a perdu la tête mais en fait la divinité l'inspire, et c'est cela qui échappe à la foule. »
« Initié aux mystères parfaits » est celui qui, au-delà des conditions humaines s'aventure dans l'espace de l'Inconditionné. L'areté grecque, à cet égard, ne diffère pas fondamentalement de la noblesse spirituelle telle qu'elle s'illustre dans le Vedanta ou la tradition chevaleresque soufie, au demeurant grandement influencée par les néoplatoniciens.
L'amour de la beauté, le consentement à être subjugué ou bouleversé par la beauté, unissent ces diverses branches d'une même Tradition dont l'origine se perd dans les profondeurs primordiales de l'Age d'Or. Mais de l'extase visionnaire qui accueille l'apparition de l'Idée dans l'entendement humain, encore faut-il pouvoir tirer un enseignement précis, ─ ce qui est précisément la fonction des œuvres. Distinctes, échappant dans une certaine mesure aux ravages du temps, les œuvres font servir le génie de l'illimité à concevoir des limites salutaires. Elles puisent à la source du Sans-limite la transparence intellectuelle par laquelle nous distinguerons les contours à bon escient.
La précision de l'Art reflète l'exactitude de la Loi, de même que l'harmonie des formes, leur élégance avenante présagent du bon cours de la justice. De nos jours où toute inégalité est perçue comme injuste, de telles notions sont devenues incompréhensibles, mais à quiconque s'abreuve à la Source grecque on ne saurait faire accroire la confusion passablement volontaire de l'équité et de l'égalité qui est devenue le véritable lieu commun de toutes les sociologies modernes. Il s'en faut de beaucoup, pourtant, que l'équitable et l'égalitaire se confondent. La juste mesure prescrit-elle de considérer également l'homme de mérite, qui œuvre avec talent pour le bien de la Cité, et l'accapareur abruti ? L'homme qui dédaigne les pouvoirs de l'argent n'a-t-il pas droit à quelque supériorité compensatrice ? Est-il équitable de tenir pour si peu les manifestations de l'excellence des individus qu'elles demeurent irrémédiablement sans recours devant les pouvoirs effectifs de l'or et du fer ? L'égalité et l'équité non seulement se confondent plus rarement qu'il n'y paraît ; elles ne cessent, dans les requêtes les plus pertinentes de l'intelligence politique, de s'opposer. Au vrai, dans le monde sans principes où nous vivons, l'égalité ne cesse de bafouer l'équité. Aussi bien nous revient-il désormais de prendre le droit d'en appeler à un principe d'équité contre les égalités qui nous oppriment et entravent dans notre Pays, l'advenue du meilleur.
La prétentieuse morale abstraite du moderne qui condamne les traditions de tous les peuples et de tous les temps, ne saurait plus davantage faire illusion face aux conséquences que nous lui voyons et qui nous privent, dans les faits, de cela même que cette morale nous offrit en théorie. La dignité de la personne humaine, la liberté individuelle, le bien partagé, l'éducation, le loisir, ─ on chercherait en vain, sous toutes les latitudes, un siècle qui, plus que le vingtième siècle leur fut cruel.
Lorsque les idéologues modernes inclinent vers la gauche et ne cèdent pas directement à l'odieuse morale darwiniste propre à l'idéologie dite « libérale », leur référence à l'antique se borne à la louange de la « république » sans bien voir que la France monarchique fut, au sens strict, bien davantage une « res publica » que les « républiques » numérotées qui s'ensuivirent de la Révolution. Une autre erreur, commise, elle, plus souvent par les gens de « droite » consiste à confondre la morale abstraite avec la morale transcendante et à récuser celle-ci au nom des vices de celle-là. Mais la morale abstraite se définit par sa prétention à se suffire à elle-même, et c'est précisément en quoi elle est abstraite, alors que la morale transcendante se relie, elle, verticalement, à l'esthétique et à la métaphysique : et c'est en quoi elle est transcendante. Favorable à l'égalité, la morale abstraite s'opposera à la morale transcendante qui, elle, en tient pour l'équité, laquelle, n'étant jamais atteinte dans sa perfection, demeure une quête infinie. Toujours au totalitaire de la morale abstraite s'opposera de façon plus ou moins clandestine, l'herméneutique infinie de la morale transcendante qui ne cesse de relier le visible et l'invisible dans l'embrasement matutinal de l'âme odysséenne.
Constructrice mais non « édifiante » au sens moralisateur, Pallas-Athéna définit par son rêve sculptural les limites imparties au génie de la Cité inspiratrice. Et là devrait être l'enjeu de toute politique digne de ce nom : faire en sorte que la Cité demeurât inspiratrice. Tout le génie des anciens se prodigue à cet aboutissement magnifique où l'individu doit bien reconnaître qu'il reçoit de la Cité infiniment plus qu'il ne peut lui apporter. Dans ces circonstances heureuses, l’Éris bienfaisante pousse l'individu à donner le meilleur de lui-même pour conquérir cette gloire personnelle qui ajoutera à la splendeur de la Cité. Telle est la Cité inspiratrice qu'elle s'enrichit de la force de l'amour-propre magnanime des individus au lieu d'en prendre ombrage. C'est bien que la Cité et sa morale propre ne se confondent point avec les sentiments de la foule, toujours envieuse et nivellatrice, et fort entraînée par ce fait à donner naissance aux tyrannies, étapes habituellement précédentes ou successives des démocraties. Faire de la Cité inspiratrice, née de la légèreté architecturale du Songe de Pallas, le principe poétique de toute philosophie politique, cette ambition, nous éloigne déjà, pour le moins, des travaux d'érudition. Aussi ces écrits sont-ils écrits de combats qui n'hésitent pas à donner au pessimisme lucide la part qui lui revient.

Il est vrai que la dictature du vulgaire triomphe sur tous les fronts, que toute chose est pensée en termes de gestion et de publicité, que le réalisme plat semble en tout domaine s'être substitué aux vocations un peu hardies. Le Pays se décompose en clans et factions qui ne revendiquent plus que des formes vides et il devient fort difficile de trouver encore quelque trace de civilité ancienne dans la sourde brutalité qui nous environne. La « nostalgie des origines » dont parlait Mircea Eliade existe bel et bien mais, par défaut de civilité, et dans le déclin de la Cité inspiratrice, elle prend des formes dérisoires ou monstrueuses. Engoncés dans leurs folklores ou livrés aux élucubrations du « New Age », les nostalgiques de l'Origine contribuent activement à la déroute des ultimes hiérarchies traditionnelles. L'Art de vivre, avec la politesse et la tempérance, n'est plus qu'un souvenir que l'on cultive pieusement dans quelques milieux universellement décriés ou moqués.
Tout cela porterait à la désespérance si notre caractère y était de quelque façon prédisposé ; ne l'étant pas, il ne peut s'agir là que d'un pessimiste état des lieux. Le pessimisme interdit de se réjouir en vain, il nous porte à ne pas détourner les yeux aux spectacles déplaisants ; il n'implique pas pour autant que nous cédions à quelque état d'âme défavorable au redressement. A la fois pessimistes, fidèles et actifs : tels nous veut la songeuse Pallas dont nous sommes les espoirs humains.
Luc-Olivier d'Algange ─ Extrait de Le Songe de Pallas, éditions Alexipharmaque
10:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc-olivier d'algange, hellénisme, dieux, héros, antiquité grecque, mythologie, mythologie grecque, tradition, traditions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 février 2016
Luc-Olivier d'Algange : « Discours contre l'uniformisation des êtres et des choses »

Luc-Olivier d'Algange :
« Discours contre l'uniformisation des êtres et des choses »
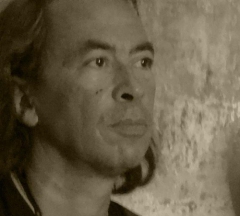 Longtemps les formes furent honorées en ce qui les différenciaient les unes des autres. Les hommes trouvaient un bonheur à la fois sensuel et intellectuel à rendre hommage à ce qui se distingue. La diversité et la variation plaisaient à leurs regards. Par une attention et des attentions dévouées, ils aimaient à servir ce qui leur donnait à penser des nuances, la polyphonie, le versicolore, la multiplicité des styles, des genres et des états de conscience et d'être. Les Yézidis, par exemple, depuis des temps antérieurs au monothéisme, adoraient l'Ange-Paon, le messager qui diffracte et déploie en couleurs la lumière primordiale, et leur fidélité dans cette adoration leur vaut aujourd’hui, avec et après tant d'autres, d'être l'objet du ressentiment le plus vil et de la haine la plus obscure.
Longtemps les formes furent honorées en ce qui les différenciaient les unes des autres. Les hommes trouvaient un bonheur à la fois sensuel et intellectuel à rendre hommage à ce qui se distingue. La diversité et la variation plaisaient à leurs regards. Par une attention et des attentions dévouées, ils aimaient à servir ce qui leur donnait à penser des nuances, la polyphonie, le versicolore, la multiplicité des styles, des genres et des états de conscience et d'être. Les Yézidis, par exemple, depuis des temps antérieurs au monothéisme, adoraient l'Ange-Paon, le messager qui diffracte et déploie en couleurs la lumière primordiale, et leur fidélité dans cette adoration leur vaut aujourd’hui, avec et après tant d'autres, d'être l'objet du ressentiment le plus vil et de la haine la plus obscure.
Notre monde n'est pas « mondialisé », il est globalisé, et cette globalisation est une extinction massive. Les langues, les peuples, les espèces, les paysages mêmes, disparaissent. Une architecture et des mœurs simplets et utilitaires se répandent partout, servis non par quelque fatalité de l'histoire mais par une âpre volonté vengeresse contre tout ce qui, dans les êtres et les choses, ne serait pas interchangeable.
L'interchangeable est non seulement la condition du fonctionnement du monde globalisé, mais, si l'on ose dire, en profanant un mot si noble, sa vocation. Ce monde fonctionne par l'interchangeable et pour l'interchangeable, c'est-à-dire contre le sentiment tragique qui accompagne la joie vivante du caractère irremplaçable des êtres et des choses, et cependant voués à la mort. Par la généralisation de l'interchangeable, les Modernes cultivent l'illusion de vaincre la mort en nous précipitant dans un monde à sa ressemblance. Ainsi veut triompher la sécurité fallacieuse de l'ennui, en se départissant d'un même mouvement du tragique et de la joie.
Je ne puis me défendre de l'idée que le sous-titre de ce discours, qui va au plus urgent, ne vaut que s'il découvre son avers logique. Ce discours contre l'uniformisation des êtres et des choses est d'abord, en amont, par essence, un éloge des formes des êtres et des choses. L'uniformisation à laquelle nous assistons n'est pas même la réduction des formes à une forme mais la destruction de la forme en soi, la poussée, la « ruée vers le bas », selon l’expression de Léon Bloy, vers un informe, une confusion morose, qui rendrait à jamais impossible l'essor vers l'au-delà de la forme, cette toute-possibilité de toutes les formes.
Notre temps est en proie à cette rage, à cet activisme planificateur qui emprunte tout autant à la technique et à la finance qu'au fondamentalisme religieux, au littéralisme obtus. Dans un cas comme dans l'autre, la surface uniformisatrice despotise au détriment de la profondeur d'où naissent les formes, c'est dire au détriment des êtres et des choses, au détriment de l'âme des hommes et de l'Âme du monde.
Notre civilisation est notre monde particulier, le point à partir duquel nous allons vers le monde en général, comme le monde va vers nous. Dans une civilisation morte ou moribonde, en proie aux affres pathologiques du reniement de soi-même et du dénigrement de son propre passé, ce n'est pas seulement une certaine forme de beauté qui est niée et détruite mais notre faculté de percevoir et d'aimer toute beauté, et à l'intérieur de cette faculté, un frémissement sensible, un vibrato, ─ cet accord entre les êtres et les choses qu'Hölderlin évoquait en écrivant: « L'homme habite en poète ».
Le reniement de sa civilisation, de son tradere n'est pas une ouverture à l'universel, mais, tout au contraire, enfermement dans la subjectivité et incarcération dans cette société de contrôle, cet individualisme de masse, qui réduit les êtres et les choses au plus petit dénominateur commun. Et qu'ont en commun tous les êtres et toutes les choses sinon de dépérir et de mourir ? La volonté uniformisatrice se révèle ainsi pour ce qu'elle est: une volonté de mort : « soumettre, selon la formule de Maurice Blanchot, à la toute-puissance de la mort ce qui ne se mesure pas en termes de pouvoir », ─ disons encore, en référence, et déférence, à René Guénon, ce qui ne se mesure pas selon le Règne de la Quantité.
Toute qualité, toute distinction, est résistance à cette usure programmée en accéléré, et cette distinction n'est pas seulement un « pour soi » ou un « pour les nôtres », elle n'est pas seulement un culte du Moi ou du Nous, mais la sauvegarde de la possibilité pour les hommes de n'être pas seulement des unités interchangeables, des monnaies d'échange, des choses destinées à disparaître une fois convertie en « croissance économique », dans l'indifférence générale.
Être attaché à sa langue, à son tradere, ─ qui rendra possible précisément toutes les traductions, ─ n'est pas une volonté restrictive mais un consentement à ce qui est, un éclore qui s'ouvre à d'autres éclosions, une voie vers l'universel qui emprunte des sentes réelles, parfois difficiles et escarpées, et non ces « autoroutes de l'information » parcourues par des hommes abstraits dans des espaces et des temporalités abstraites, devant des écrans, hors du monde.
Quiconque demeure fidèle à sa tradition se trouve accusé, s'il se trouve être français et européen, d'être nationaliste, européocentriste, voire xénophobe ou raciste. Cependant nous ne disons pas que notre tradition est au centre du monde, supérieure en vertu d'on ne sait quels critères, mais qu'elle est en notre cœur et que nous sommes dans son cœur, non par choix mais par ces grandes évidences méconnues, dont la première est que nous écrivons en français.
Les Modernes ont cette passion, nier l'évidence. Tout leur semble mieux que le donné, et c'est ainsi qu'ils veulent un monde où tout s'achète parce que tout est destiné à être mis en vente. Tout leur est préférable au réel, et c'est ainsi qu'ils se précipitent dans le monde virtuel. Tout leur est plus cher que ce qui est, et c'est ainsi qu'ils rêvent de devenir des machines, c'est-à-dire d'être à la fois morts et perpétuels, immortels et sans âme.
Il n'y a pas, comme le disent les imbéciles ou les faux naïfs, un bon ou un mauvais usage de la technique. La technique est, par essence, la mise en œuvre de cette volonté d'ôter l'âme du corps afin que celui-ci puisse devenir une machine immortelle, autrement dit une mécanique morte, et donc inusable, en parfait état de fonctionnement.
Ce qui vaut pour l'individu vaut pour le collectif. L'extinction des civilisations a cet horizon : le fonctionnement parfait, la transparence parfaite (sauf pour les affaires étrangères et financières!), le contrôle parfait enfin débarrassé de ces folklores, mythes, symboles, légendes, singularités, nuances et distinctions auxquels les hommes furent tant attachés depuis des millénaires et pour lesquels ils inventaient des formes dissemblables, des caractères irréductibles, des œuvres et des styles immédiatement reconnaissables.
Ce monde uniformisé est ce monde où plus rien ne sera reconnaissable, ─ un monde où il n'y aurait plus rien à reconnaître en amitié, en sapience ou en gratitude, un monde sans mystère, sans missions de reconnaissance, où il n'y aura plus rien à découvrir ou à dévoiler, un monde sans Eros et sans herméneutique, un monde pornographique et puritain, un monde non de recoins rêveurs et de dons impondérables, mais de grandes surfaces régies par la Loi du Marché, un monde où la flamme de la chandelle qu'évoquait Bachelard n'aura plus de sens ni de lueur pour personne.
Nous écrivons dans la pénombre, cette pénombre qui nous rend indistincts et presque indiscernables mais qui, cependant, laisse à nos regards le loisir d'apercevoir le tremblement des flammes lointaines ou oubliées qui portent les noms des dieux et des Muses et s'incline sous le souffle comme la salutation angélique que Dante reçut de Béatrice. Nos ressouvenirs sont des ressacs. Un Grand Large scintille du fond de nos mémoires, l'âme odysséenne nous revient dans cette épiphanie d'eau et de lumière qu'avive le cours de nos phrases françaises.
L'âme est une chose vague mais les formes où elle se manifeste sont précises, et cette précision, en retour, est au principe d'une songerie et d'une interprétation infinie. La plus infime, la plus fugitive apparence, dans l'instant exact où notre attention s'en saisit, tient en elle, distincte, un reflet d'éternité qui irise d'un insondable mystère les choses les plus familières : un paysage d'enfance, une rivière, un peuplier, un puit, une poignée de mûres, un scarabée ou un lézard, la buée sur une vitre. Notre âme s'éveille au contact de l'Ame du monde, là où elle se manifeste, chatoyante et versicolore, dans la nuance ou le contraste, délicate ou violente, ─ avivée.
L'inlassable discours du pédagogisme contre « l'élitisme intellectuel » censé perpétuer, par l'héritage, les inégalités sociales, est le principal moteur des inégalités dénoncées. Si l'on n'offre plus le meilleurs à tous, on le réserve à quelques-uns, non les meilleurs mais les mieux protégés, qui, au demeurant, n'en feront souvent rien de bien audacieux ni de bien créateur. On voit sans peine que cette idéologie a pour dessein premier d'abolir toute inégalité qui ne soit pas d'argent ; elle est au service de ce pouvoir ultime et exclusif qui voit d'un mauvais œil, pour le moins, toute excellence dont les origines et la fin lui échapperaient et dont surgiraient des formes individuelles et collectives irréductibles à la pure circulation monétaire qui permet aux malins de se servir au passage.
Ces jeunes gens ignorants de la culture dont ils héritent, ces connectés globaux, ces distraits perpétuels auxquels l'usage de leur propre langue n'est plus transmis, ne recevront jamais le secours d'Epictète ou de Marc-Aurèle pour échapper au pouvoir sur lequel ils ne peuvent rien ; jamais Hölderlin ou Nerval ne viendront leur dire l'enchantement et la profonde vertu d'habiter en poète ; jamais Nietzsche ou Artaud ne viendront briser la prison des signes et les dissuader d'être les parfaits agents de la Machine et de bien dociles consommateurs.
Disposés pour eux, voici un monde binaire, profondément déprimant, réduisant toute pensée en moraline inepte, l'affect au « pour » ou « contre » téléguidés, la sensation à l'agréable ou au désagréable primaires, toute poésie à la publicité et toute politique à la « force de vente ». La modification ainsi opérée n'est pas seulement politique mais intime au plus intime : la gratitude s'y tourne en ressentiment et le bonheur d'être en amertume. Les facultés cognitives et sensibles s'y étiolent, les paysages intérieurs s'amenuisent et le discours, s'il est encore possible, se rabougrit à des actes d'accusation contre les rares esprits demeurés, tant bien que mal, quelque peu libres et audacieux.
L'Universel lui-même, tant évoqué en prétexte à ces arasements, devient hors d'atteinte du seul fait qu'il ne peut se comprendre qu'à partir d'une forme mise en analogie avec d'autres formes, ─ la destruction des formes distinctes établissant non l'universalité mais la confusion des formes, leurs décombres, d'où surgissent comme des figures cauchemardesques, « zombifiées », si l'on ose dire, les caricatures des identités niées. Ainsi que l'écrivait Dominique de Roux « Nous en sommes là ».
L'uniformisation, qui est bien le contraire de l'universel, n'aboutit pas même à cette utopie triste d'une ressemblance pacifiée de tous les êtres humains sous l'éclairage exclusif de la Finance et de la Technique mais à un chaos qui délivre ce dont la Finance et la Technique sont les masques acceptables, ─ à savoir une régression vers le culte des Érinyes et le règne des Titans, ─ qui sera celui des hommes sans visage.
 Cependant, contre cet activisme planificateur, un recours existe bien, et se laisse dire en ce seul mot latin que nous évoquions, tradere, autre dit la Tradition en action, l'acte d'être de la Tradition, qui n'est pas, au contraire de la ressassante modernité, commémorative ou muséologique, mais variation, cours scintillant qui, à chaque instant, garde la mémoire de sa source, qui est hors du temps.
Cependant, contre cet activisme planificateur, un recours existe bien, et se laisse dire en ce seul mot latin que nous évoquions, tradere, autre dit la Tradition en action, l'acte d'être de la Tradition, qui n'est pas, au contraire de la ressassante modernité, commémorative ou muséologique, mais variation, cours scintillant qui, à chaque instant, garde la mémoire de sa source, qui est hors du temps.
L'hors du temps dans le Temps, la corolle qui s'ouvre amoureusement dans l'intime de l'instant, la perspective à perte de vue, le Grand Large soudain offert sur la rive conquise, précèdent la conscience que nous en avons et ce que nous pouvons en dire. Ils sont littéralement attente, attention, fraîcheur soleilleuse, éclatante, qui veille derrière les apparences ternies. Cet hors du temps revient en nous comme un ressac porté par le ressouvenir.
Une inimitié profonde et chargée de sens, l'une des rares à n'être ni vaine, ni circonstancielle, ni fallacieuse, est celle qui oppose, de tous temps et en toute contrée, les hommes de la planification et les hommes du ressouvenir. Ce n'est pas tant que les hommes de la planification ne se souviennent de rien mais ce dont ils se souviennent, et qui les encombre, ils veulent s'en venger, en détruire les traces dans le présent afin d'instaurer leur pouvoir sans conteste et sans rien qui demeurât dans les êtres et les choses pour voir de loin.
Le planificateur veut le tout du pouvoir sur ce « tout » qui doit être planifié pour que sa seule volonté puisse y régner. Rien ne lui semble plus détestable que ce qu'il nomme les « survivances » ou les « archaïsmes », ─ ces mots désignent ce qu'il y a pour lui de plus odieux, alors que, dans leur stricte acception, ils disent simplement ce qui survit et ce qui vient de l'origine.
Pour le planificateur, le monde doit être littéralement aplati, réduit à cette surface où bâtir de « grandes surfaces » désorientées. Son adversaire premier est la hiérarchie (au sens étymologique, hiéros et arché) qui ordonne le monde par le sacré et le principe, en gradations infinies, et d'abord en nous-mêmes.
La destruction de cette hiérarchie intérieure a pour première conséquence la prolifération des fausses hiérarchies extérieures : un monde de petits chefs, de guichetiers, d'escrocs où la Loi du Marché désigne ses exécuteurs préférés, c'est-à-dire, et là encore au sens étymologique, les plus ignobles. Là où les états, obéissant naguère encore aux logiques de la souveraineté, veillaient, par le Droit, à sauvegarder le bien public, ils cèdent désormais et font servir le Droit au secours de ceux qui nous volent et nous dépouillent, autrement dit ces chancres que sont les banques. La conséquence n'en est pas seulement macro-économique, mais intime, et profondément démoralisante. Ni l'héritage, ni le fruit du travail n'appartiennent plus vraiment aux individus et aux peuples mais à des instances anonymes, abstraites et incertaines.
Face à ces ennemis sans formes, les formes semblent devoir capituler, et jusqu'aux formes formatrices : celles de la langue. Entre les jargons financiers, juridiques ou universitaires, que l'on peut regrouper sous le terme générique d'enfumage, et le babil débilité commun où le vocabulaire s'est réduit en peau de chagrin au milieu d'une syntaxe effondrée, notre langue natale ne survit que par la fervente fidélité de quelques-uns.
Cette fidélité n'est pas seulement fidélité au parler de nos ancêtres, fidélité aux belles œuvres, fidélité « logocratique » pour reprendre la formule de George Steiner, mais encore fidélité aux êtres que nous écoutons et auxquels nous parlons, et déférence à l'égard des choses que nous nommons. Sauvegarder sa langue natale n'est pas seulement un projet linguistique mais ontologique : ce que nous sommes dans notre relation au monde, avec la toute-possibilité.
Il n'y a rien de bien surprenant à ce que la Machine de guerre uniformisatrice se soit d'abord appliquée à saper les fondements de l'usage poétique et sapientiel de notre langue, ─ laquelle contient en elle tous les recours et toutes les puissances de résistance et de rébellion. Telle phrase de Valery Larbaud dispose du pouvoir d'aller directement à l'âme française et à l'éveiller ; encore faut-il pouvoir l'entendre, encore faut-il porter en soi un assez vaste silence pour qu'elle nous advienne.
Naguère, les totalitaires pensaient ingénument se débarrasser des œuvres en brûlant des livres. Depuis, la méthode s'est perfectionnée à fabriquer les conditions où ces livres deviendront incompréhensibles, hors d'atteinte, dans une humanité à laquelle rien de ce qu'ils évoquent ne parlera plus, ni la vigueur ironique des héros de Stendhal, ni les mystères des filles du feu nervalienne, ni la liberté d'allure de Paul Morand, ni la gnose poétique de Henry Bosco qui roule dans les rivières de la nuit et dans les orages entre les arbres.
Ce qui est ôté à ceux qui sont réduits à ne plus jamais les entendre, ce ne sont pas des objets d'art, des témoignages du passé, une bibliothèque, mais des possibilités d'être, ─ qui sont autant de Châteaux Tournoyants qui élèvent les cœurs et résistent à l'uniformisation du monde.

Luc-Olivier d'Algange ─ Extrait de Intempestiva Sapientia suivi de L'Ange-Paon
Éditions Arma Artis, 2016.
11:02 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, luc-olivier d'algange |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook